|
|
Tous les passionnés de Rennes‑le‑Château le
savent, le 17 janvier est une date omniprésente
dans l'énigme et
l'ignorer est une erreur. Bien sûr, selon les
auteurs et selon les thèses défendues, cette date a plus ou moins d'importance. Certains même sont persuadés qu'il s'agit
d'un montage artificiel élaboré par on ne sait quelle
société secrète récente comme le
Prieuré de Sion de
Pierre Plantard. Cette date n'aurait alors aucun fondement
historique et serait le résultat de quelques illuminés
assoiffés d'ésotérisme de pacotille.
Si on se limite à cette analyse de l'affaire dans sa
période contemporaine, la conclusion est facile. Mais si
l'on s'aventure dans des temps plus anciens, le
17 janvier
revêt un sens très différent et
insaisissable.
Coïncidences ? Concours de circonstances ? Traditions ? Message
ésotérique ? Les questions sont multiples et il faut
les intégrer de même que les liens avec l'énigme de
Rennes‑le‑Château.
Bien sûr,
je laisse chacun juge de tirer ses conclusions.
|
|

Qui croit devoir fermer les yeux sur quelque chose
se voit bientôt forcé de les fermer sur tout
Jean‑Jacques Rousseau
|
|
Voici quelques évènements historiques
célèbres datés du
17 janvier. Bien sûr, ils n'ont aucun lien
entre eux et cet exercice pourrait être réalisé pour
n'importe quel autre jour de l'année. Mais si on y regarde
de plus près, quatre
personnages célèbres fortement liés à la nébuleuse de
Rennes‑le‑Château
apparaissent (en bleu ci‑dessous)
|
|
17 janvier 356 |
Mort d'Antoine le Grand
qui deviendra le fameux
Saint‑Antoine,
personnage classique dans l'affaire de
Rennes‑le‑Château. |
|
17 janvier 395 |
Mort de l'empereur romain
Théodose Ier le Grand à Milan, dernier empereur à
régner sur l'Empire romain unifié,
et
qui entraîna la scission définitive entre
l'Empire romain d'Orient et celui d'Occident |
|
17 janvier 647 |
Mort de
Saint Sulpice,
Archevêque de Bourges.
L'église Saint‑Sulpice
de Paris, très fortement liée à l'énigme
de
Rennes‑le‑Château, lui est dédiée. |
|
17 janvier 715 |
Mort de
Dagobert III, Roi
mérovingien de
Neustrie et de Bourgogne |
|
17 janvier 1329 |
Mort de
Sainte Roseline très
liée à Sainte Germaine de Pibrac que
l'on retrouve dans
l'église de Rennes‑le‑Château. |
|
17 janvier 1369 |
Mort de
Pierre Ier, Roi de
Chypre |
|
17 janvier 1377 |
Retour de la papauté à
Rome |
|
17 janvier 1504 |
Naissance du
Pape Pie V |
|
17 janvier 1562 |
Charles IX signe la
Paix de Saint‑Germain |
|
17 janvier 1566 |
Couronnement du
Pape
Pie V |
|
17 janvier 1579 |
Mort supposée de
Sainte Germaine de Pibrac
(1579‑1601).
On la fête le
17 janvier, mais le jour de sa mort n'est pas vérifié et on
le confond avec celui de
Sainte Roseline. |
|
17 janvier 1601 |
La France et le duché de Savoie signent le
Traité de Lyon |
|
17 janvier 1605 |
Naissance de
Don Quichotte
(Première publication du roman de Miguel de
Cervantès) |
|
17 janvier 1793 |
Le Roi
Louis XVI est condamné à mort. |
|
17 janvier 1871 |
Apparition de la Vierge de
Pontmain (Mayenne) qui eu lieu le
17 janvier de l'hiver 1871,
17 ans après la promulgation du dogme
de l'Immaculée Conception. L'apparition se
serait déroulée en
17 phases.
|
|
17 janvier 1949 |
Découverte du
virus de la grippe |
|
17 janvier 1991 |
Début de l'opération "Tempête du désert"
en Irak |
|
17 janvier 1994 |
Un important tremblement de terre eu lieu en
Californie
à Los Angeles.
Le séisme était
d’une magnitude de 6,6. Il a été ressenti
jusqu’à San Diego à 200 km au sud et jusqu’à Las
Vegas à 400 km au Nord‑Est. |
|
17 janvier 1995 |
Un important tremblement de terre eu lieu au
Japon à Kobe. Il fit plus de 5000 victimes,
300 000 sans‑logis et détruisit une grande
partie de la ville. |
|
Pour présenter les liens ésotériques
entre le 17 janvier et
Rennes‑le‑Château, il faut
au préalable rappeler l'histoire de
4 personnages incontournables qui se confondent avec
cette date.
Antoine le Grand alias Saint‑Antoine
|
|
Le mythe de
Saint‑Antoine est
bien connu des chercheurs de Rennes‑le‑Château. L'une
des premières raisons est qu'il est suggéré dans la sentence
issue du Grand parchemin :
"BERGERE PAS DE TENTATION QUE
POUSSIN TENIERS..."
Téniers le Jeune a effectivement peint
de très nombreuses tentations de Saint Antoine
ce qui a participé entre autres à la renommée du maître. La phrase
nous invite à choisir une toile
SANS TENTATION (Pas de
tentation), en clair une toile qui ressemble à une
tentation de Saint‑Antoine, mais qui n'en est pas une.
Cette peinture
existe et a été révélée : il s'agit des "7 péchés capitaux" de Téniers archivée au musée du Prado
à Madrid.
|

Antoine le Grand
par Francisco de Zurbarán
|
|

David Teniers Le Jeune – La
Tentation de Saint‑Antoine du Prado 1670
(Ref. 1618 – année 1849) Peinture sur cuivre dim 55 x 69
signé D. Teniers fec, en
réalité "Les 7 péchés
capitaux""
Peinture provenant de la
collection de Don Luis de Benavides, marquis de Caracena,
Gouverneur et capitaine général des Flandres
Collectionneur des Œuvres de David Teniers le Jeune |
|
Qui était réellement Saint‑Antoine ?
Antoine le Grand
ou Antoine d'Égypte aurait vécu de l'an 251 à
356. Il mourut à l'âge de
105 ans entre les bras de ses 2 disciples Macaire et
Amathas, le
17 janvier 356.
Sa vie est racontée par
Saint Athanase et
Saint Jérôme
pour être ensuite popularisée
par "La légende dorée". Né en 251 en Haute‑Égypte à Qeman (Fayoum), il
fut un fervent chrétien et dès l'âge de
20 ans, il
distribua tous ses biens aux pauvres puis partit vivre en
ermite dans le désert dans un fortin à
Pispir, près
de Qeman.
C'est à ce moment qu'il subit les tentations du
Diable (tout comme le Christ). Son calvaire dura très
longtemps, les démons n'hésitant pas à s'attaquer à sa vie.
Mais Antoine finit par résister à toutes les tentations. Il
accueillit des disciples venus le rejoindre et organisa au
désert la vie cénobitique.
En
312, il
s'enfonça dans le désert en direction de la mer Rouge pour
aller finir ses jours au désert de
Thébaïde, sur le mont Qolzum (où se trouve
aujourd'hui le monastère Saint‑Antoine). Le Diable lui
apparut encore de temps en temps, mais il ne le tourmentait
plus comme autrefois. Saint Antoine
bénéficiait d'une grande popularité et il prodiguait
sans cesse des conseils de sagesse et de non‑violence. |
|
Vers la fin de sa vie,
il rendit visite à Saint‑Paul Ermite, doyen des anachorètes
de Thébaïde. Nourri chaque jour par un corbeau, ce dernier
apporta miraculeusement deux pains au lieu d'un lors de la
visite de Saint‑Antoine. Plus tard, ayant appris la mort de
Saint‑Paul, Saint‑Antoine revint l'ensevelir avec l'aide de
deux lions.
A sa mort, Saint‑Antoine
demanda à ses deux disciples de l'enterrer dans un endroit
tenu absolument secret. |

Grotte de
Saint‑Antoine au mont Kolzum |
|
Sa tombe resta inviolée pendant 200 ans. Mais elle fut découverte par hasard en 561,
sous l'empereur Justinian. Ses os furent alors transférés
avec solennité à l’église de Saint Jean le Baptiste à
Alexandrie et plus tard à Constantinople.
Vers 1070, un seigneur local de retour de Terre Sainte
ramena les reliques de Constantinople en
Dauphiné. Le prince Jocelyn
prit les restes de Saint‑Antoine en France et les enterra
au village de La Motte aux Bois qui prit le nom de
Saint‑Antoine.
Les Bénédictins commencèrent alors la construction d'une
abbaye et d'un hôpital destiné à soigner les victimes du Mal
des Ardents. Au XIIIe siècle, le Pape confie les
lieux aux chanoines de l'Ordre de Saint‑Antoine. De grands
travaux d'extension sont ensuite menés du XIVe au
XVIe siècle, période faste pour l'Ordre et
l'Abbaye.
Depuis, ses restes
furent transférés
de Saint‑Antoine l'Abbaye à Saint Julien‑d'Arles.
En janvier 2006,
elles seront déplacées d'Arles (Bouches du Rhône) vers
l'Italie sur l'île d'Ischia, située à l'entrée du golfe de
Naples.
C'est Saint Athanase
qui, touché par la vie de Saint‑Antoine, devint son
biographe en
360 et permit de faire connaître aux
générations futures l'ermite.
L'église
de La Roque possède une petite relique de Saint‑Antoine
authentifiée par Mgr Hasley (1825‑1888), Archevêque
d'Avignon de 1880 à 1884. Le premier dimanche qui suit le 17
janvier, la paroisse de La Roque célèbre ce Saint.
|
|

Saint‑Antoine et Saint Paul de Thèbes
par Téniers le jeune
|
|
De
nombreux artistes et écrivains comme
Gustave Flaubert
ont puisé dans la vie de
Saint‑Antoine pour alimenter
leurs œuvres. L'artiste peintre le plus célèbre est bien
sûr
Téniers le Jeune qui déclina ce thème dans
plusieurs dizaines de toiles, mais on peut citer aussi
Dali,
Jérôme Bosch, Pieter
Bruegel, Max Ernst, Matthias Grünewald ou Vélasquez.
L'une des peintures célèbres
et certainement codée est la
représentation que fit
Téniers de
Saint‑Antoine
rencontrant Saint‑Paul de Thèbes, peu de temps avant
la mort des deux ermites.
Saint‑Antoine l'ermite est
considéré comme le fondateur de l'érémitisme chrétien.
Il est fêté le
17 janvier.
|
| Sa rencontre
avec Paul l'ermite dans le désert
Contrairement à une fausse idée courante, c'est Saint‑Antoine
qui vint rencontrer Saint Paul et non l'inverse. La vie
de Paul l'ermite nous est racontée dans l'ouvrage en latin de
Saint Jérôme vers 375‑376 (La vie de saint Paul le premier
ermite). Saint Athanase aurait également écrit une vie de
Paul, antérieure à celle de Jérôme.
Paul (235‑340) eut 15 ans à la mort de son père et suite à
un désaccord avec son frère aîné au sujet de l'héritage, il
renonça aux biens de ce monde et se rendit dans le désert
oriental intérieur. Il vécut à cet endroit seul durant 80 ans
dans une grotte près d'une source. Habillé de feuilles de
palmier et nourri d'un demi‑pain qu'un corbeau lui apportait
quotidiennement.
Peu
avant sa mort, Antoine le Grand, averti de la présence de Paul
par un ange, vint lui rendre visite. Ils s'embrassèrent,
prièrent et s'assirent.
Paul
demanda : " Le monde subsiste‑t‑il ?
L'injustice existe‑t‑elle encore sur la Terre ? Les
magistrats gouvernent‑ils avec l'erreur de Satan dans l'esprit,
en tyrannisant les faibles ? "
Saint‑Antoine
répondit : "Oui, il en est ainsi... "
Le
corbeau vint alors leur apporter un pain entier, pour la
première fois depuis 80 ans. Peu après cette visite, Paul décéda
et Antoine vit son âme monter au ciel dans la joie des anges. Il
alla retrouver le corps de Paul et l'enveloppa du manteau offert
par l'empereur Constantin à saint Athanase. Puis, aidé
par deux lions, il l'ensevelit au même endroit. Au IVe
siècle le monastère Saint‑Paul y sera érigé. Antoine offrit la
tunique de Paul, en feuilles de palmier, à Athanase, qui
la portait lors des grandes fêtes.
Sa représentation |
|
L'iconographie de
Saint‑Antoine est très variée. Il est souvent représenté âgé
et vêtu de l'habit des Antonins, une robe de bure munie d'un
capuchon. Il porte souvent avec lui un bâton se terminant
par un T,
le
Tau et une clochette. À ses
pieds, un cochon représente l'attribut le plus célèbre du
Saint.
Saint‑Antoine le Grand perdit un peu de sa
popularité au XVe siècle où une confusion
commença avec Saint‑Antoine de Padoue, fêté le 13 juin.
Le symbole du cochon
viendrait d'un Ordre religieux Hospitalier : "Les Antonins", fondé en
Dauphiné en 1095. À cette époque, les porcs n'avaient
pas le droit d'errer librement dans les rues à l'exception
de ceux des Antonins, reconnaissables à leur clochette. Pour
d'autres auteurs, le
cochon symboliserait l’esprit malin et ne
serait apparu dans l’iconographie qu’au XIIe siècle.
En fait un cochon aurait été laissé par l'un de ses
disciples dans le désert.
D'autres sources nous disent qu'à l'origine, il s'agissait
d'un sanglier diabolique et que Saint‑Antoine aurait
domestiqué.
|

Saint‑Antoine à l'église de
Rennes‑le‑Château
|
|
Le cochon était considéré comme impur au Moyen‑Orient
et représentait le diable en Occident. Dans l’art moyenâgeux, les peintres Tintoret
et Véronèse le représentaient comme un animal aux
pouvoirs démoniaques, l’incarnation de la cupidité, alors que dans la mythologie celte, le cochon était magique, paré de nombreux
pouvoirs. D’ailleurs le cochon se promenait toujours non loin des druides, près des chênes,
des arbres sacrés pour les Celtes. L’un des
surnoms du dieu Mercure dans la mythologie gauloise était Moccus, signifiant porc en langue celtique ! Les
saintes Écritures par contre rapportent qu’Antoine
fût guidé par un loup dans le désert pour retrouver Saint‑Paul,
puis par un faune aux pieds fourchus et queue en tire‑bouchon.
La rencontre du faune et d’Antoine fit l’objet d’une sculpture
sur le tympan d’une porte de l’église de St Paul de Varax dans
l’Ain. L’église date du XIIe siècle et le cochon ou sanglier
n’apparaît pas encore comme le compagnon de route de
Saint‑Antoine. Durant le Moyen‑âge (475‑1453), nous pouvons
constater que la truffe est méprisée, ayant une âme aussi noire que l’âme d’un damné. De plus, à cette
époque, ce qui venait du sol venait du diable. Le
porc ou le cochon, considéré comme impur par l’Église de Rome, est un animal luxuriant capable de
se
nourrir de n’importe quoi. Il peut déterrer la truffe
qui est donc impure et méprisée. Selon Saint Clément, le cochon et donc la truffe sont réservés à ceux qui
vivent sensuellement, c’est à dire comme des animaux. Ce n’est que vers le XVe siècle que
le cochon apparaît dans l’iconographie chrétienne de
Saint‑Antoine. Ce cochon fut associé plus tard à certains
privilèges des Frères Hospitaliers de Saint‑Antoine fondés
au XVIIe siècle. Cet Ordre venant en remplacement de l’Ordre de
Saint‑Antoine né en 1095, fut dissout dans l’Ordre de Malte au
XVIIIe siècle. Les Antonins (dont le Tau était un emblème) avaient, entre autres privilèges,
l’autorisation de laisser leurs cochons se nourrir des détritus et de se promener en toute liberté dans
les cités. Les éboueurs de l’époque ! Ces cochons étaient marqués d'un Tau et avaient une clochette à
l’oreille. Rappelons aussi que les Commanderies de Saint‑Antoine s’éparpillaient dans les campagnes,
de
préférence dans des lieux bien choisis et toujours
proches de forêts de chênes dans le Dauphiné, le
Périgord, le Sud‑Ouest ou en Provence. Par contre, il semblerait que fin du XVe siècle et
début du XVIe siècle, pour mieux identifier les Saints et les intégrer dans la vie quotidienne, l’Église
leur a donné «le costume» de ceux qui les honoraient.
Saint‑Antoine décharné par le jeûne et tanné par le soleil devint un Chanoine Antonin à la
barbe opulente, au manteau de bure brune marqué du Tau couleur bleu. Et comme il était de bon ton que les
corporations se mettent sous la protection de l’Eglise et de ses Saints, les charcutiers trouvèrent
naturel de prendre Saint‑Antoine et son cochon comme saint Patron. Ils créèrent en 1475 la Confrérie des
Chevaliers de Saint‑Antoine, disparue puis remise à l’honneur en 1966. Les couleurs du médaillon sont bleues et dorées, bleues pour la couleur du fond de l’écusson donné par Louis XII aux charcutiers lors de la
déclaration de leurs patentes. Les papetiers des Vosges le prirent aussi pour Patron
parce que l’outil qui sert à sortir le papier des cuves est en forme du T de Tau. Les Vanniers parce que les Antonins tressaient des
corbeilles pour occuper leur solitude et aider les pauvres. Et naturellement, Saint‑Antoine est devenu patron des
trufficulteurs quand la truffe ne fût plus considérée comme manifestation du malin, mais comme « met de
choix » tant sur les tables royales que papales. Le cochon permettait non seulement de bien se nourrir,
mais aussi d’avoir des réserves pour l’hiver. Il fut réhabilité, son odorat puissant permettait le cavage
des truffes. Nos lointains descendants verront peut‑être le cochon de
Saint‑Antoine se transformer en
chien truffier et un esprit malin verra dans le T du Tau, la lettre magique du T de
Truffes. |
|
Dans
le
statuaire
de l'église de Rennes‑le‑Château, cette symbolique est
détournée en y représentant un sanglier habilement identifié
par l'ajout de petites défenses très caractéristiques. Car il faut
savoir que si les premières iconographies montrent un
sanglier ou un cochon sauvage, les suivantes et
surtout celles du 19e siècle montrent un cochon domestique
sans défense. Ce symbole du
sanglier fut certainement ajouté pour suggérer un autre
message, celui de
Boudet et de sa
chasse au sanglier citée dans
La Vraie Langue
Celtique...
Saint‑Antoine est le patron
des personnes amputées, des animaux, des bouchers, des
éleveurs de porcs, des personnes épileptiques, des ermites,
des fabricants de paniers et de brosses, des fossoyeurs et
des moines. Il est invoqué pour lutter contre les maladies
de peau.
Plus de
50 saints
portèrent le nom d'Antoine, et parmi eux
Saint‑Antoine de Padoue
(1195‑1231). Ce dernier fut élevé à la dignité de docteur de
l’Église, sept siècles après sa mort par le pape
Pie XII en
1946. Il est le saint patron des
faïenciers et du Portugal, mais aussi des objets perdus.
Saint‑Antoine de Padoue est représenté
dans
l'église Marie‑Madeleine
à Rennes‑le‑Château et
à Notre Dame de Marceille.
|
|
Saint Sulpice
Saint Sulpice naquit en
570 à Vatan dans le
Berry. D'origine gallo‑romaine, il voulut très
vite devenir moine.
Il soulagea les mendiants, les pauvres
et les prisonniers jusqu'à l'âge de
40 ans.
Un
évêque de Bourges,
Saint Outrille, qui l'avait connu
au palais royal, le nomma en
612
"archidiacre". Sa mission devint l'assistance aux pauvres
et la direction de la cathédrale de Bourges.
Devenu prêtre en
618, il rejoignit le roi
Clotaire II, neveu de
Gontran, où il fut chargé de devenir aumônier
des armées.
En
624, l'évêque de
Bourges
décéda et la ville ainsi que le clergé réclamèrent
Saint Sulpice comme nouvel évêque.
Saint Sulpice dit le pieux
mourut le
17 janvier 647 et il fut enterré à
Notre Dame de la Nef près de
Bourges.
|

Saint Sulpice
|
|
Le mystère de Sainte Roseline
Sainte Roseline
est associée à un réel mystère. Elle naquit à
Arcs sur
Argens dans le Var au
château de Villeneuve, le
27 janvier 1263. Son père était
Giraud II, alors
seigneur du château. Vers l'âge de
12 ans, elle prit
l'habitude d'aller voir les pauvres du village avec du pain
dans son tablier. Mais un jour, elle fut surprise par son
père qu'il lui ordonna de montrer ce qu'elle
cachait dans son tablier. Une brassée de roses en fleurs
apparue à la place.
Après ce miracle, elle se consacra
essentiellement aux pauvres. Elle entra
à la chartreuse de Saint André de
Ramières près du Mont Ventoux, puis à la chartreuse de
Bertaud dans les Hautes‑Alpes, et enfin à
l'abbaye de la
Celle‑Roubaud en
1285, près du château des Arcs.
|
|
Elle mourut le
17 janvier 1329 à l'âge de
66 ans et on l'enterra
dans le cloître de l'abbaye.
Mais cinq
ans plus tard, le
11
juin 1334,
Jean XXII
fit exhumer le corps pour le transporter dans la
chapelle.
Lors de l’exhumation, le mystère était à son
comble. Le corps de Roseline était resté intact ainsi que
ses yeux pleins de vie. Ces derniers furent retirés sur
l’ordre du neveu de Roseline, Elzéar de Villeneuve et il les
plaça dans un reliquaire.
|

Sainte Roseline sous sa châsse
de verre
dans l'église Sainte Roseline
|
|
Entre
1334 et 1614, le corps
disparut, probablement caché, et on le retrouva en
1614 dans un même état de conservation.
En
1660,
Louis XIV
dépêcha un médecin pour vérifier le miracle et ce
dernier perça un oeil à l'aide d'une aiguille qui le creva.
Le miracle était prouvé. Le
5 juillet 1894, puis en
1996, son corps fut conditionné et placé dans
un reliquaire visible aujourd'hui dans la chapelle
Sainte
Roseline.
Le prénom
Roseline rappelle bien sûr dans la langue des
oiseaux, la fameuse "Rose Line" ou "Ligne rose",
apparentée à la ligne de cuivre marquant le méridien que l'on peut voir
au sol dans l'église Saint‑Sulpice à Paris.
Sainte Roseline est la patronne des
alchimistes.
|

La méridienne de l'église
Saint‑Sulpice de Paris
|
|
Le mystère de Sainte Germaine de Pibrac
Sainte Germaine de Pibrac
naquit vers 1579 dans le petit village de
Pibrac,
près de Toulouse. Infirme dès sa naissance (sa main droite
était atrophiée atteinte d'écrouelles), Germaine était
orpheline et issue d'une famille pauvre. Elle devint
bergère, mais un jour, alors qu'elle prit discrètement du
pain dans son tablier pour le redistribuer aux pauvres, elle
fut accusée de vol. Obligée de montrer son tablier, le pain
se changea miraculeusement en roses. Elle mourut à
22 ans
en
1643,
et son corps fut
retrouvé intact. Elle est aujourd'hui enterrée dans l'église
de Pibrac, en face de la chaire. On la fête le
17
janvier, mais le jour de sa mort n'est pas vérifié et on
le confond avec celui de
Sainte Roseline.
Sainte Germaine de Pibrac est
visible également dans le statuaire de l'église de
Rennes‑le‑Château. De plus on retrouve une allégorie de ce
mythe dans le
Mucha de la
Villa Béthania. Il est
aussi étonnant d'observer la ressemblance de son histoire
avec
Sainte Roseline.
|
|
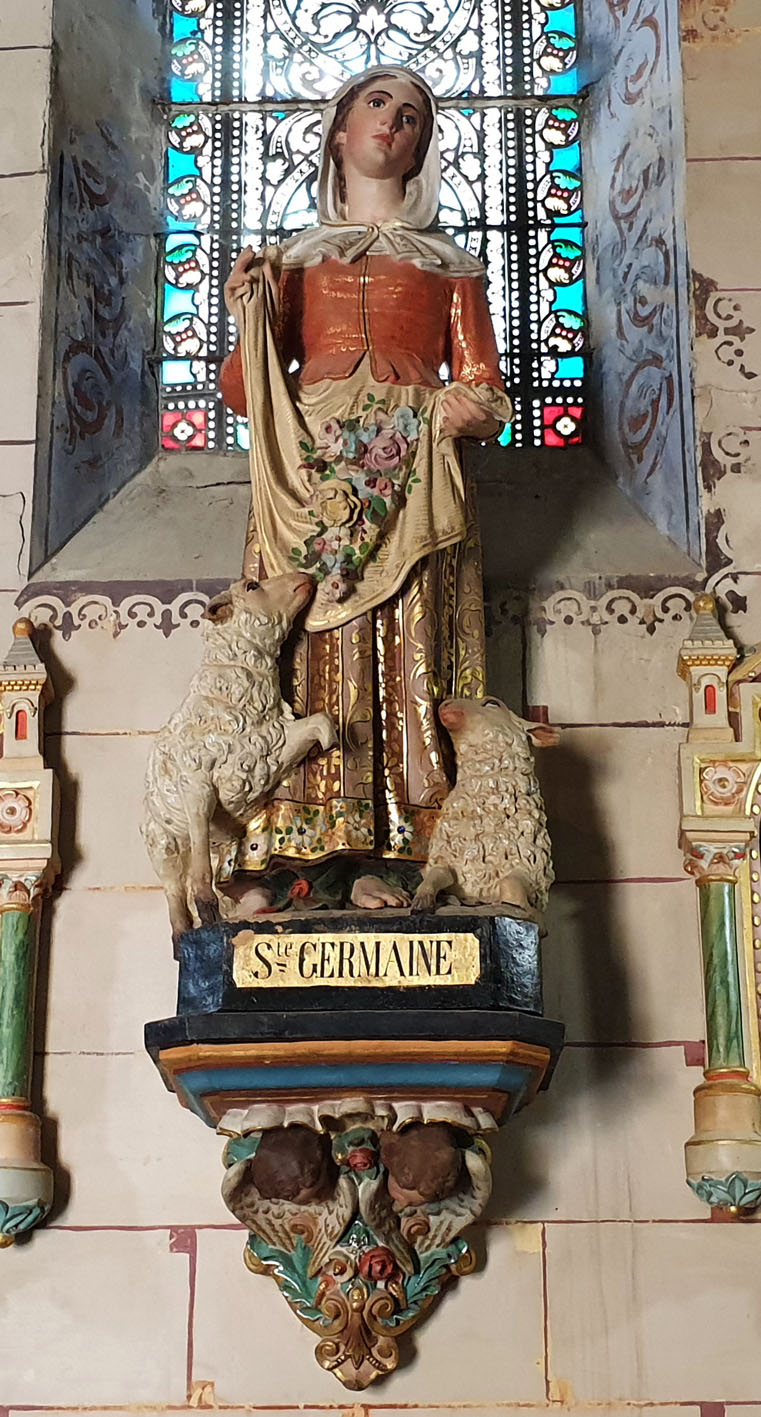
Sainte Germaine de Pibrac
Eglise de Rennes‑le‑Château
|

"L'Esprit du Printemps"
par Alphonse Mucha
était exposé dans la Villa Béthania |
|
Avant d'aborder les fameux
17 janvier liés à Rennes‑le‑Château il est intéressant de
voir que tout chose à une origine. Le
17 janvier est
sans doute né du nombre 17
qui a revêtu au cours de l'Histoire des symboles
ésotériques variés. Voici une liste des références les plus
connues :
|
17
est le numéro atomique du
Chlore Cl, élément sans lequel "la Grande
Œuvre" serait impossible. Il est le symbole de
la transmutation alchimique. |
|
Pour les alchimistes,
17 est la forme de toute chose, le tout, et
la
Résurrection. |
|
17
est l'étoile dans les arcanes du tarot,
symbolisant l'espérance et la confiance. |
|
17
est un nombre très souvent utilisé par les
rituels des sociétés secrètes |
|
Le 24 juin
1717,
la Grande Loge de Londres a été créée par quatre
confréries maçonniques unifiées. Anthony Sayer
est élu Grand Maître de cette Loge. |
|
La somme des carrés
des nombres premiers jusqu'à
17
donne
666 qui est un nombre hautement
symbolique (Nombre de la bête). Ainsi :
2² + 3² + 5² + 7² + 11² + 13² + 17² =
666 |
|
Dans la bible, le
Déluge
commença un 17
(Gen.7,11) et
l'Arche de Noé se posa
sur le mont Ararat (altitude
17
000 pieds). |
|
Les 10 Commandements
de Dieu ont été donnés en
17 versets au vingtième chapitre
du
livre de l'Exode. |
|
Les
Tables de la Loi
furent rompues un
17
du mois de Tamuz. |
|
Seth,
divinité guerrière de la mythologie égyptienne,
enferma son frère
Osiris dans une arche cercueil le
17 du mois de Athyr |
|
17
est le nombre d'années de mariage qu'il faut
avoir pour pouvoir célébrer les noces de
Rose... |
|
La momie du
Roi
Toutankhamon fut enveloppée dans
17 draps |
|
Les Italiens ont
horreur du 17, car il s'écrit
XVII
en chiffres romains, ce qui correspond à
l'anagramme
VIXI et qui veut dire "j'ai vécu" ou "je
suis mort". En Italie, il n'y a pas de
17ème
étage, les hôtels n'ont pas de chambre 17,
les avions n'ont pas de place 17... |
|
Les Grecs anciens
connaissaient le nombre particulier
17 et
que l'on retrouve au
Parthénon avec
17 colonnes sur sa
longueur. |
|
|
Les 17 janvier et l'énigme de Rennes‑le‑Château |
|
Voici enfin les
17 janvier
reliés de près ou de loin à l'affaire de Rennes‑le‑Château.
Certains sont évidents pour les connaisseurs, d'autres sont plus
discrets. Mais cette liste prouve qu'une tradition hermétique
s'est propagée au cours de l'Histoire et dont l'origine reste
obscure. Bien sûr, l'inventaire n'est certainement pas
exhaustif... |
|
17 janvier 356 ‑
Saint‑Antoine
Mort d'Antoine le Grand, dit
Saint Antoine l'ermite. Depuis, le
17 janvier est la fête de Saint Antoine.
Son lien avec Rennes‑le‑Château est
indiscutable au travers de la phrase codée déduite de la
stèle de Blanchefort et du
grand
parchemin :
"BERGERE PAS DE TENTATION
QUE
POUSSIN TENIERS ..."
C'est aussi par extension la fête de
Saint‑Antoine de Padoue, patron des objets perdus.
|

Saint‑Antoine à l'église de
Rennes‑le‑Château
|
|
17 janvier 647 ‑ Saint
Sulpice
Mort de
Saint Sulpicius,
ancien archevêque de la cathédrale de
Bourges
vers 624. Depuis, le
17 janvier est la
fête de Saint Sulpice.
La renommée de Saint
Sulpice a été telle que de nombreuses églises portent
aujourd'hui son nom. Il faut aussi signaler que
Bourges est traversée par la méridienne 0°
que l'on appelle aussi le méridien
de Paris.
D'ailleurs,
une ligne de cuivre datant de
1757
traverse la cathédrale de Bourges et servit de
cadran solaire. On retrouve cette ligne rouge (ou rose) dans
l'église Saint-Sulpice à
Paris, près du Gnomon. Cette fameuse méridienne coupe
également le Haut Razès au tombeau des Pontils, liant
Saint Sulpice à l'énigme de Rennes‑le‑Château.
|

Saint Sulpicius
|
|
Il faut aussi signaler que
Bourges fut la capitale des
Bituriges Cubi, un peuple gaulois. Ce nom
"Biturige" est en fait une confédération de peuples
regroupant les Bituriges Cubi, les
Bituriges Segalauns, et les Bituriges Vivisci. Leurs richesses
étaient immenses et ils
dominèrent politiquement et économiquement la Gaule
celtique. Les Bituriges Cubi prirent pour chef
des Arvernes,
Vercingétorix. et ils se disaient "Rois du monde" |
|
Notons que la page 2 du
Serpent Rouge contient
un court extrait du livre "L'Alchimie Moderne" écrit par
l'abbé Th. Moreux,
directeur de l'observatoire de
Bourges. Ceci montre un autre lien entre
l'église Saint Sulpice et Bourges... |
|
17 janvier 681 ‑ Sigisbert IV
Selon la légende, c'est le 17 janvier 681 qu'une
lignée mérovingienne, avec
Sigisbert IV fils
de
Dagobert II, serait arrivée à Rhedae,
l'ancien nom de Rennes‑le‑Château. Le
jeune enfant aurait eu 3 ans juste
après l'assassinat de son père. Le Razès était en ce temps‑là wisigoth. Sigisbert IV prit selon le
Prieuré de Sion le nom "Plant‑Ard"
dit "Le Rejeton Ardent" et eut une descendance.
C'est à cette descendance que Pierre Plantard
prétendait appartenir.
|

Dagobert II
|
|
17 janvier 1329 ‑ Sainte
Roseline
Décès de
Sainte Roseline,
célèbre pour la légende de son tablier aux roses, mais aussi
pour la parfaite conservation de son corps.
Patronne des alchimistes, son nom est
intimement lié à la "Ligne Rose" dont les racines
commencent à Saint Sulpice.
Enfin, la légende de
Sainte Roseline est curieusement similaire à celle de
Sainte Germaine de Pibrac
|

Sainte Roseline
Église de Belgentier
|
|
17 janvier 1382 ‑ Nicolas
Flamel
Nicolas Flamel réalisa
selon la légende le Grand Œuvre alchimique
en produisant de l'or le 17 janvier 1382. C'est dans
ses textes que le célèbre alchimiste raconte sa
transmutation :
"La première fois que je fis la
projection, ce fust sur du mercure, dont j'en converti
demy‑livre ou environ en pur argent, meilleur que celuy de
la minière, comme j'ay essayé et faict plusieurs fois."
Selon lui, il découvrit l'élixir
blanc, le petit magistère, qui transmute le mercure en
argent. Il se sait proche du Grand Œuvre, proche de l'or.
Nicolas Flamel est le
8ème
Grand Maître du
Prieuré de Sion après 1188
|
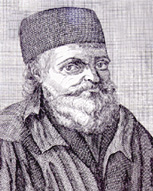
Nicolas Flamel
|
|
17 janvier 1601
Sainte Germaine de Pibrac
Décès de
Sainte Germaine de Pibrac,
célèbre pour la légende de son tablier aux roses, mais aussi
pour la parfaite conservation de son corps.
Son histoire ressemble étonnamment à celle
de
Sainte Roseline.
Sa statue est présente
dans l'église de Rennes‑le‑Château.
Sainte Germaine de Pibrac est
fêtée le
17 janvier
Sainte
Germaine de Pibrac dans l'église de Rennes‑le‑Château
|
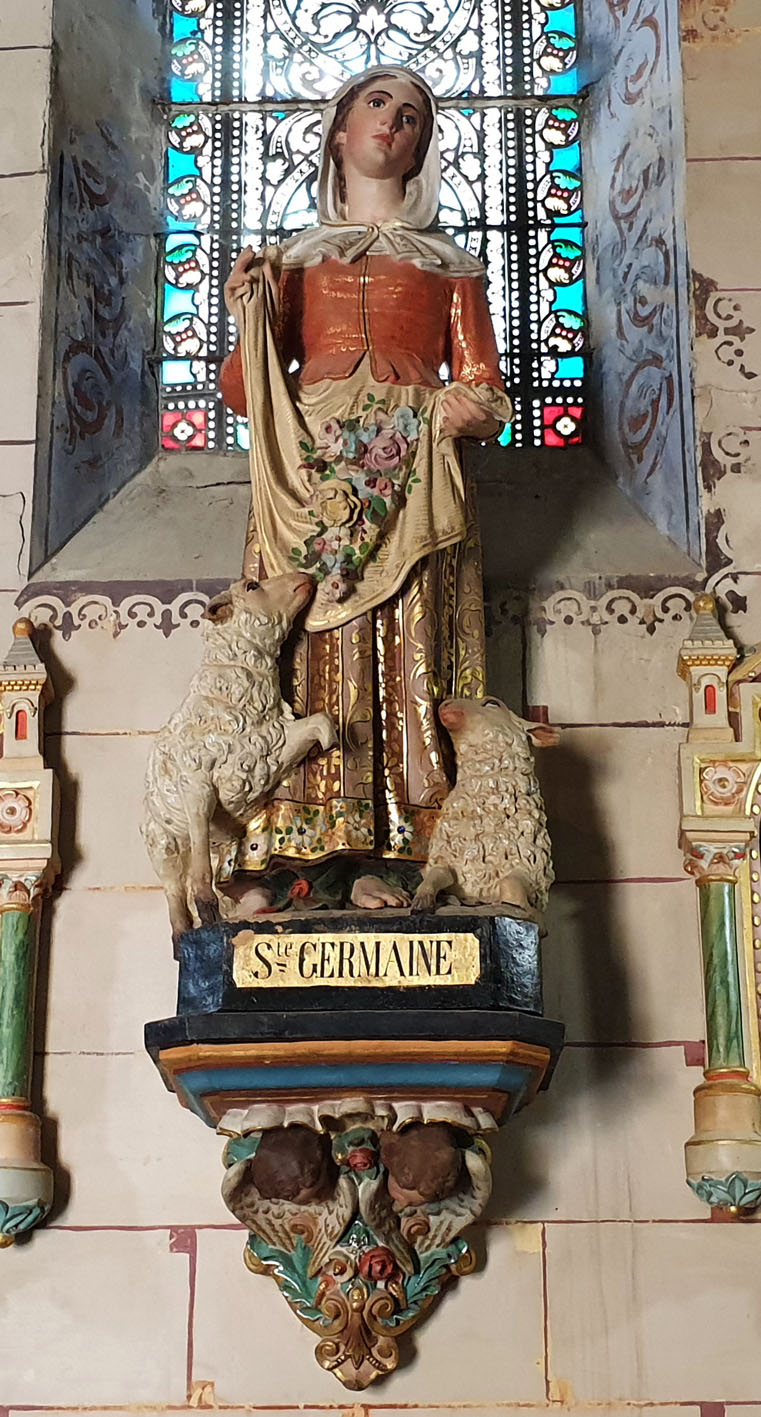
|
|
17 janvier ‑ La Vierge
Noire
Le 17 janvier fut la date du dépôt
par Claude Perrault (1613‑1688) médecin et
architecte, et Jean‑Dominique Cassini (1625‑1712)
astronome, d'une statue de Vierge Noire dans
l'oratoire,
au fond des souterrains de
l’Observatoire
de Paris.
Il faut rappeler que l’Observatoire
de Paris fut construit sous
Louis XIV
entre
1668
et 1672, et
les plans furent dressés par
Claude Perrault, architecte du
Roi et frère du célèbre écrivain
de contes pour enfants.
|
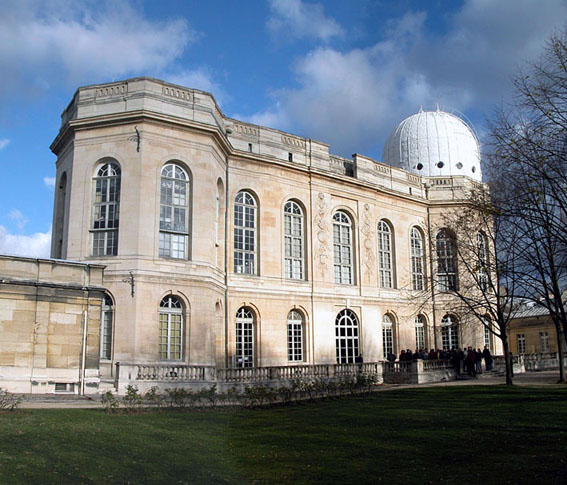
L'Observatoire de Paris
sur le méridien
|
|
Le
21 juin 1667,
jour du solstice d'été, les mathématiciens de l'Académie
tracèrent sur le terrain, à l'emplacement actuel du bâtiment, un
méridien qui devint le méridien de
Paris, ainsi que les autres directions nécessaires à
l'implantation exacte de l'édifice. Le plan médian de celui‑ci
permit de définir le fameux méridien origine pour la France, à la place
de celui de
Saint Sulpice
(La Ligne Rose). |
|
17 janvier 1776 ‑ Coudenberg
La pose de la première pierre de l'église
Saint‑Jacques de Coudenberg
à Bruxelles eut lieu le 17 janvier 1776. Une
médaille de
Charles‑Alexandre de Lorraine portant le bijou
et la plaque de l'Ordre Teutonique
célèbre d'ailleurs l'évènement.
Il faut rappeler que d'après les
dossiers secrets de Pierre Plantard,
Charles‑Alexandre de Lorraine
serait le
23ème
Grand Maître du
sulfureux
Prieuré de Sion après 1188 et que l'église
Saint‑Jacques sur Coudenberg se
situe sur la
Place Royale où s'élève maintenant la
statue équestre de Godefroi de Bouillon.
|

L'église Saint‑Jacques de Coudenberg
à Bruxelles avec la statue de Godefroi de Bouillon,
place royale
|
|

La date du
17 janvier est
lisible sur l'envers de la médaille
|
|
17 janvier 1781
Comme indiqué sur
la stèle
de sa tombe,
Marie de Négri d'Ables,
Marquise de Blanchefort, est décédée le
17 janvier 1781
à l'âge de 67 ans.
Cette stèle aurait été burinée par
Bérenger Saunière et il
ne nous resterait qu'une reproduction.
Elle est
aussi l'anagramme de la phrase codée :
"BERGÈRE, PAS DE TENTATION QUE
POUSSIN, TENIERS, ...",
ce qui la lie aussi au
Grand parchemin.
|

La stèle reconstituée (musée de
Rhédae)
|
|
17 janvier 1872
Parmi tous les
17 janvier
connus, voici certainement le plus célèbre dans l'affaire des
deux
Rennes. Il se devine
sur la
stèle de l'abbé Jean Vié
dans le petit cimetière de
l'église de Rennes‑les‑Bains.
La stèle indique :
|
ICI REPOSE
Jean VIE
né en 1808
Nommé Curé en 1870
Mort le 1er
7bre 1872
‑
PRIEZ POUR LUI |
|

La stèle de Jean Vié
église de
Rennes‑les‑Bains
|
|
La
calligraphie est d'ailleurs très importante, car on voit
nettement que les tailles du
1 et du
7
sont exagérées par rapport aux autres chiffres, comme
pour attirer l'attention. Seul un initié peut deviner le
très astucieux jeu de mots :
"17 Jean VIÉ", probablement mis en place par
Boudet
ou Jourde. |
|
17 janvier 1893
Coïncidence ou non, la vente du
domaine de ND de Marceille
eut lieu le
17 janvier 1893. Ceci est rapporté par le livre
de G. Migault page 82 :
"Suite à de nombreux problèmes
juridiques la mise en vente en un seul lot
de tout le domaine a lieu le mardi
17 janvier 1893"
|

ND de Marceille à Limoux
|
|
Il faut rappeler qu'une étape importante
dans l'histoire de
ND de Marceille et de
Mgr Billard face à Mr Bourrel a été
cette vente aux enchères
qui permit sans aucun doute de conserver aux mains des Hommes
d'Eglise un ou plusieurs secrets inestimables. |
|
17 janvier 1917
On a longtemps confondu cette
date avec le décès de
Bérenger Saunière qui survint en fait le
22 janvier 1917.
Il reste que ce fut le
17
janvier 1917
que
Marie Dénarnaud
retrouva Bérenger Saunière inconscient devant la porte
de la Tour Magdala, apparemment
victime d'une congestion cérébrale. Il devait mourir cinq
jours plus tard.
|

Bérenger Saunière dans son fauteuil
mortuaire
|
|
17 janvier 1967
Le Serpent Rouge est une
prose allégorique et initiatique intimement liée à Rennes‑le‑Château. Le
personnage qui parle à la première personne commence son
voyage au Verseau et le termine au Capricorne. Son voyage
culmine à la dernière strophe le
17 janvier,
date hautement symbolique :
|
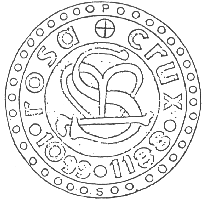 |
|
Mon émotion fut grande, "RETIRE MOI DE
LA BOUE" disais‑je, et mon réveil fut immédiat. J'ai omis de
vous dire en effet que c'était un songe que j'avais fait ce
17 JANVIER, fête de Saint SULPICE. Par la suite mon
trouble persistant, j'ai voulu après réflexions d'usage vous
le relater un conte de PERRAULT. Voici donc Ami Lecteur,
dans les pages qui suivent le résultat d'un rêve m'ayant
bercé dans le monde de l'étrange à l'inconnu. A celui qui
PASSE de FAIRE LE BIEN !
(extrait du Serpent Rouge)
|
|
Ce n'est pas tout. La page de
garde du Serpent Rouge
actuel
est datée du 17 janvier 1967 indiquant qu'il pourrait
s'agir de la date d'édition. Le Serpent Rouge fut en fait
déposé à la bibliothèque nationale un mois plus tard,
le 15 février 1967 |
|
17 janvier 1975
C'est à cette date que l'Archiduc
Rodolphe
de
Habsbourg
visita la "colline envoûtée" de
Rhedae (Rennes‑le‑Château).
Cette visite peut être vue comme un pèlerinage
initiatique à propos de
son
cousin, Jean Salvator de Habsbourg, mort en
1910,
et qui aurait fréquenté l'abbé
Saunière sous le nom de "L'étranger".
|
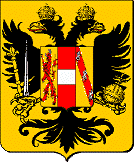
Le blason de la famille des
Habsbourg‑Lorraine
|
|
17 janvier 1981
C'est le
17
janvier
1981 que se réunissait à Blois une société secrète,
mieux connue depuis peu :
le Prieuré de Sion, afin d'y tenir son
assemblée. Les médias relayèrent cette information,
probablement à l'initiative du
Prieuré.
C'est ainsi que le grand public découvrit un Ordre
qualifié par la presse de "véritable société secrète de
121 dignitaires". Lors de cette assemblée de Blois,
Pierre Plantard de Saint‑Clair fut élu
Grand Maître
du Prieuré de Sion et
27e nautonier de l'Arche‑Royale,
par 83 voix sur
92 votants, au 3ème
tour de scrutin. Pierre Plantard
devint donc Grand Maître le
17 janvier 1981
|
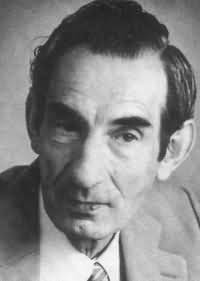
Pierre Plantard
|
|
17 janvier Pommes bleues
Pendant longtemps les chercheurs ont
imaginé une explication à propos des fameuses
Pommes Bleues
citées dans la phrase :
BERGÈRE, PAS DE TENTATION QUE
POUSSIN, TENIERS, GARDENT LA CLEF PAX DCLXXXI
PAR LA CROIX ET
CE CHEVAL DE DIEU,
J'ACHÈVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI
POMMES BLEUES
Il se trouve que le
17 janvier
à midi heure solaire, un rayon de soleil traverse un
vitrail de l'église de Rennes‑Le‑Château et projette des
taches de couleurs, dont le bleu, sur le mur nord. C'est le
phénomène dit : "Pommes Bleues".
Il est a noter
qu'un phénomène comparable se déroule aussi le
17 janvier
à l'église de
Saint Sulpice.
|
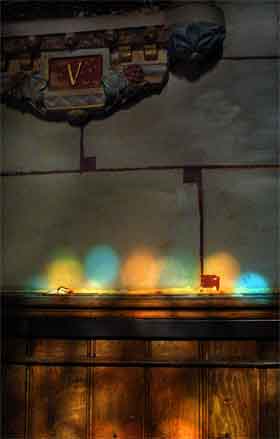
Les pommes bleues
dans l'église de Rennes‑Le‑Château
Photo : Jean Brunelin ©
|
|
En réalité l'église de Rennes‑le‑Château
est parcourue par les
Pommes bleues
plusieurs jours avant et après le
17 janvier. La trajectoire des
faisceaux lumineux est aussi très difficile à interpréter,
allant des fonds baptismaux au chœur, en passant par la
chaire. Le vitrail responsable de ce jeu de couleur se
trouve au‑dessus de
la statue de Saint Roch.
Enfin, si on prend pour hypothèse que
Saunière ou
Boudet sont à l'origine de ce code
lumineux, il faut aussi tenir compte de la déclinaison
magnétique à raison de
0,07° par an depuis
110 ans. On peut aussi
imaginer que le phénomène est plus ancien, ce qui rend alors
l'interprétation encore plus difficile.
|
|
17 janvier ‑ Église Saint
Sulpice
Le
17 janvier, entre
12 h 50
et 13 h 10, à midi vrai, un phénomène équivalent à
celui de l'église de Rennes‑le‑Château se produit dans
l'église Saint Sulpice de
Paris.
Plusieurs tâches de lumières peuvent
être observées sur le Gnomon et suivent le méridien
de cuivre appelé aussi "La Ligne Rose"...
|

Le Gnomon de l'église Saint Sulpice à
Paris
|
|
17 janvier ‑ Saint Genou
D'origine bien mystérieuse, Le
17 janvier
est aussi la fête de
Saint Genou qui reste peu
connue.
Ce personnage était en fait
Saint Genulfe,
premier
évêque de Cahors mort en
256. Peu connu,
il répandit sa foi en pleine Gaule dans le diocèse de Bourges.
Mais quel est le lien avec
Rennes‑le‑Château ? Il faut peut‑être y voir une
allusion au 17 janvier au travers du "Genou".
Il se trouve que le "Genou gauche découvert" est un
signe de reconnaissance pour la réception des jeunes initiés
chez les Francs Maçons.
|

Héliodore chassé du Temple
par
Eugène Delacroix
|
|
Or il existe dans
la chapelle des Saint Anges
(allusion aux sociétés secrètes angéliques ?), dans
l'église Saint Sulpice,
une fresque d'Eugène Delacroix,
"Héliodore chassé du Temple" et dans lequel
cinq
personnages ont le genou découvert. Mais cette allusion, si
elle a été voulue par le peintre, va plus loin puisqu'il
choisit de peindre 5 genoux droits et non gauches, peut être
pour exprimer ce même souci d'inversion.
Ceci nous amène dans la langue des
Oiseaux à
Saint Genou = 5 genoux d'où
le 17 janvier.
Un autre indice nous est peut‑être
donné par la statue d'Asmodée dans l'église de
Rennes‑le‑Château. Il a aussi le genou droit découvert et sa
main droite montre clairement
5 doigts, autre
allusion possible à Saint Genou.
|

Asmodée à l'entrée de l'église de
Rennes‑le‑Château
|
|
17 janvier... sortie de films cultes
On ne peut terminer cette liste des
17 janvier sans faire un clin d'œil au cinéma et
rappeler que le célèbre film de
Jean‑Jacques Annaud "Le Nom de la Rose", adapté du roman d'Umberto Eco, fut dévoilé le
17 janvier 1986,
et sortit le
17 décembre 1986.
Et que le film "Da Vinci Code" sortit
au cinéma le 17 mai 2006
à la place du 17 janvier du
fait du
procès Dan Brown...
|

|
|
|



