|
|

L'église Saint‑Sulpice de Paris et la fontaine des quatre cardinaux |
|
Pour beaucoup,
l'église Saint‑Sulpice de Paris est devenue
médiatiquement célèbre grâce à l'auteur
Dan Brown devenu célèbre avec son Best‑Seller
DA VINCI CODE. Pour le grand
public,
Saint‑Sulpice serait soit le symbole d'un
ordre secret et mystérieux, soit une simple église que
l'écrivain aurait exagérément utilisée pour le bien de son
roman, et ceci jusqu'à énoncer des erreurs historiques.
Il est vrai que le DA VINCI CODE n'est qu'un roman...
Tout ceci aura finalement nui à la beauté
historique, artistique et architecturale du site, la
majorité du public n'y voyant aujourd'hui qu'un formidable
montage publicitaire au service du livre le plus vendu au
monde. Il était d'ailleurs amusant d'apercevoir durant la
visite de l'église quelques panneaux indiquant aux visiteurs
qu'il convient de distinguer les écrits de Dan Brown et de son
DA VINCI CODE avec les vérités
historiques de Saint‑Sulpice.
Pourtant
l'église Saint‑Sulpice
mérite bien autre chose. Cette paroisse monumentale,
richement décorée dans un style jésuite, a nécessité durant
plusieurs siècles des efforts artistiques considérables.
Surtout, et les
chercheurs de Rennes le savent bien, ce
majestueux monument est depuis longtemps fortement lié aux
secrets du Razès, et ceci pour de multiples raisons.
Et pour comprendre les liens et les indices qui unissent cette église avec l'énigme, il faut au
préalable connaître les fondements de l'affaire et surtout le
Serpent Rouge qui
fournit un fil d'Ariane. Car c'est dans cet ordre que l'on
pourra apprécier le plongeon initiatique. Pour qui sait
observer, tout y est symbole et allégorie. Comme dans le cas
du
Prieuré de Sion, il y a ceux qui n'y
verront que des coïncidences fortuites ou une manipulation
de l'esprit, ceux qui s'en tiendront à l'Histoire
officielle, et ceux qui pensent qu'il n'y a
jamais de fumée sans feu...

|
|
C'est au Moyen‑Âge, en pleine période mérovingienne, que
l'église Saint‑Sulpice est née. Son emplacement est situé près d'une ancienne
abbaye, Saint‑Germain‑des‑Prés, construite à
l'époque sur les prairies du bord de Seine, et dont ses
origines remonteraient à l'an 542 sous le règne du
roi mérovingien
Childebert, fils de Clovis. Ce bourg
Saint‑Germain qui abritait des villageois et des paysans était
doté d'une chapelle dédiée à Saint Pierre devenue
ensuite une église paroissiale. Ce sont les reconstructions
successives au cours des siècles qui donneront à l'église
Saint‑Sulpice son apparence actuelle.
|
|

La crypte actuelle témoigne de
l'ancienne église
|
|
Les cryptes qui peuvent
aujourd'hui se visiter sont les restes de l'ancienne
église "Saint‑Sulpice des champs" construite
au XIIe siècle.
La paroisse fut ensuite agrandie successivement
et embellie au XIVe,
XVIe et
XVIIe siècle...
Le plan ci‑contre montre la situation
de l'église en 1552 dans son aspect
ancien.
|
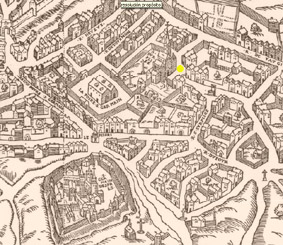
Église Saint‑Sulpice ‑ Plan de Bâle 1552
|
|

Ancienne église
Saint‑Sulpice‑des‑Prés par Matthys Schoevaerdts vers 1665
|
|
L'église est dédiée à
Saint‑Sulpicius, archevêque de
Bourges au
VIe siècle, et qui mourut le
17 janvier 647.
C'est pourquoi sa fête se déroule le
17 janvier
, un jour de l'année hautement
symbolique dans l'énigme de Rennes... |
|
Qui était Saint‑Sulpice ?
Saint‑Sulpice naquit en
570 à Vatan dans le
Berry. D'origine gallo‑romaine, il voulut très
vite devenir moine, mais ses parents l'envoyèrent
durant six ans comme page au palais royal du roi franc Gontran,
le petit fils de
Clovis.
De retour à 16 ans, il confirma
son désir de rejoindre la vie des moines, mais son père le
força à travailler sur les terres agricoles familiales.
Sa foi ne cessa de progresser,
soulageant les mendiants, les pauvres, et les prisonniers,
ceci jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais un évêque de
Bourges, Saint Outrille, qui l'avait connu au
palais royal, le nomma en 612 archidiacre. Sa
mission fut l'assistance aux pauvres et la direction de la
cathédrale de Bourges. Il devint prêtre en
618 puis rejoignit le roi
Clotaire II, neveu de
Gontran où il fut chargé de devenir aumônier
des armées.
|

Saint‑Sulpice
|
|
En
624, l'évêque de
Bourges
décéda et la ville ainsi que le clergé réclamèrent
Saint‑Sulpice comme nouvel évêque.
Son pouvoir était alors important puisqu'il
dirigeait plusieurs diocèses : Clermont, Limoges, Cahors,
Albi, Mende, Le Puy et Rodez.
Son souci permanent des pauvres
et des malades lui permit d'obtenir du roi
Dagobert,
successeur de Clotaire II,
l'abolition de certaines taxes. Il s'occupa aussi de
convertir à la foi les hérétiques. Sa vie était très austère,
n'hésitant pas à jeûner ou à dormir dans un lit sommaire.
Affable et hospitalier, sa charité fut exemplaire.
Saint‑Sulpice dit le pieux
disparut le
17 janvier
647
et enterré à
ND de la Nef près de
Bourges. Cette église devint ensuite un
lieu de pèlerinage célèbre
(elle est aujourd'hui la maison des Petites Sœurs des Pauvres à Bourges).
Il existe au moins
350 paroisses en France, en Belgique et en Suisse dédiées à Saint‑Sulpice. La région du Berry compte à elle seule
22 paroisses ou chapelles.
Saint‑Sulpice fut évêque sous le
règne de
Dagobert I et
Dagobert II, mais surtout il
servit toute sa vie le long
règne mérovingien. C'est ainsi que l'ancienne
église
Saint‑Sulpice de Paris, bâtie dans l'enceinte de
l'église Saint‑Germain‑des‑Prés d'origine
mérovingienne, ne pouvait qu'être dédiée à cet
évêque.
|
|
1642 ‑ 1678
Période de reconstruction |
|
La période du XVIIe siècle ‑
L'essor culturel
C'est en 1642 que le curé
Jean‑Jacques Olier
prit en charge la cure de Saint‑Sulpice. Quelques mois plus tard, il décida de reconstruire la
paroisse. La petite église était devenue trop
vétuste, s'accordant mal avec les nouvelles constructions
parisiennes entreprises à cette époque par Marie de Médicis. De plus,
la paroisse de
Saint‑Germain‑des‑Près
devenait importante grâce à ses reliques, un morceau de la Vraie Croix et la tunique de Saint Vincent.
La proposition de
reconstruction fut adoptée dans une assemblée tenue le
16 mars 1643 sous la présidence du
prince de Condé.
À partir de 1646, Saint‑Sulpice fut
donc continuellement reconstruit et agrandi pour recevoir
une population locale à la fois plus nombreuse et plus
aisée.
Le 15 août 1645, les plans furent
adoptés et c'est Anne d'Autriche, régente et veuve
de Louis XIII qui posa la première pierre le 20 février 1646, accompagnée de Louis XIV
âgé de 8 ans.
Le premier architecte et concepteur des
plans fut Christophe Gamard
qui travailla dans l'ancienne église. Il
mourut en
1649 et ce fut Louis Le Vau (1612‑1670),
premier architecte du roi, qui prit le relais.
Malheureusement, la charge de Versailles et de
Vaux Le Vicomte lui laissait peu
de temps. Il se contenta de modifier légèrement les plans et
de construire la chapelle de la Vierge.
Trop absorbé par d'autres chantiers, Louis Le Vau ne pouvait se consacrer pleinement à
Saint‑Sulpice. Ce fut
Daniel Gittard
(1625‑1686)
qui continua et termina les travaux, excepté pour la façade.
On peut donc considérer qu'il fut le principal architecte de
Saint‑Sulpice.
Curieusement, en
1678 les travaux s'interrompirent durant
4
ans pour cessation de paiement. La reconstruction avait
déjà duré 70 ans et le chœur était encore inachevé.
Il faut dire qu'Olier avait vu grand. La nouvelle église devra
avoir 119 m de long sur
57 m de large (5 fois
plus grande que l'ancienne) et sa taille est comparable à Notre Dame de
Paris.
Le projet était sans aucun doute très ambitieux. Le corps du
bâtiment respecte les traditions moyenâgeuses françaises, la
nef est entourée de chapelles, et le transept se termine par un
chœur en hémicycle. Yves Boiret, l'architecte en chef
des monuments historiques dira : "Le décor a été conçu
par des architectes recherchant la sobriété liée aux grandes
lignes de l'édifice (...). On a construit en pierre et on a
voulu que l'ornement fasse corps avec la structure même ".
Sur une période de 136 ans, pas moins de 6 architectes se succédèrent pour mener à bien le projet,
et chacun
voulut innover en respectant la
tradition. Gittard alla jusqu'à concevoir un nouveau
chapiteau corinthien.
|
|
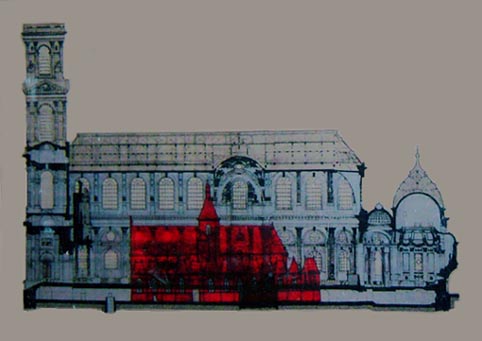
Comparaison entre l'ancienne église
Saint‑Sulpice en rouge et celle d'aujourd'hui en bleu
L'exercice montre l'ambition du projet pour l'époque
|
|
A ce stade, il est intéressant de poser la
question sur l'origine du financement des travaux. Nous
savons qu'ils furent arrêtés pendant
4 ans
faute de ressources, mais
d'où venaient les fonds ? Une chose est sûre : au fur et à mesure que les
années passaient, l'œuvre de reconstruction devenait immense et
le nombre d'artistes de grandes renommées qui défilèrent dans
l'église devenait impressionnant... |
|
Entre
1670 et
1678, la construction fut au point mort,
juste après la pose d'immenses vitraux qui furent installés
dans le chœur.
À cette époque, les tendances étaient
d'amener le plus de lumière possible dans les lieux saints. C'est aussi
sur ces vitraux que l'on peut apprécier l'invention de la
technique du jaune d'argent faite au
XIVe siècle.
Les thèmes religieux abordés dans ces
verrières dénotent la volonté de célébrer le Sacré Cœur de
Jésus et le Saint Sacrement, en réaction au protestantisme et
au jansénisme en vigueur à l'époque.
|

Les vitraux
du XVIIe
siècle
au‑dessus du chœur (Saint‑Sulpice)
|
|

Vitrail de 1622
(des croix templières sont visibles)
|

Vitrail central 1672
Un bel exemple du style saint‑sulpicien
|
|
Qui était Jean Jacques Olier ?
Jean‑Jacques Olier naquit à Paris le
20 septembre
1608. Entre 1617 et
1624, il séjourna à
Lyon pour ses études au collège des Jésuites, et entre
1625 et 1629, il étudia la philosophie et
la théologie au collège d'Harcourt, puis à la Sorbonne à
Paris. Après s'être rendu à Rome en 1630, il
tomba gravement malade et faillit perdre la vue. Il
découvrit alors sa foi lors d'un pèlerinage dans le
sanctuaire de ND de Lorette en Italie, et durant lequel
il trouva la guérison.
De retour à
Paris sous la direction de
Saint Vincent de Paul, il fut ordonné prêtre le 21 mai 1633. Pur exemple de la vie chrétienne, il se
sentit investi d'une mission : créer les fondements des
grands séminaires en France.
|

Jean‑Jacques Olier
(1608‑1657)
|
|
Vers
1639,
Olier tomba dans la dépression et dans la
détresse spirituelle. La disparition de son directeur, le
père de Condren, l'affecta certainement et son état
dura
deux ans. Il ressortit guéri de cette épreuve en
1641
et sa foi fut encore plus
intense.
Dès
1642, il créa à
Vaugirard
une petite communauté destinée à l'éducation de quelques
ecclésiastiques qui se développera très vite.
Olier voulait former de véritables prêtres et
non des savants théologiens issus de la Sorbonne. C'est
aussi cette année que Jean‑Jacques Olier commença sa
cure à Saint‑Sulpice.
|
|
Il accepta donc de travailler avec
l'abbé de
Saint‑Germain‑des‑Prés et prit en charge
tout le faubourg qui avait en ce temps‑là une triste
réputation. C'est donc avec l'aide de sa communauté qu'il
entreprit un énorme travail spirituel, ceci malgré les
fermes oppositions et les immoralités qui régnaient dans le
quartier.
Prédications, offices liturgiques, culte du Saint
Sacrement, soins des malades et des pauvres furent organisés
pour rétablir l'ordre religieux et la foi des paroissiens.
Toutes ces initiatives à réformer sa paroisse le rendirent
vite célèbre.
Mais le succès de sa réforme eut un
prix. En effet, les paroissiens devinrent nombreux et il
était urgent d'agrandir la paroisse. C'est ainsi qu'il conçut
les plans d'une nouvelle église majestueuse avec
l'architecte Christophe Gamard.
|
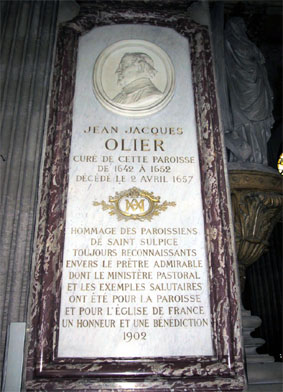 Mémoire à Jean‑Jacques Olier |
|
Curieusement,
Jean‑Jacques Olier
s'occupa aussi d'évangéliser le
Canada.
Il fonda la société
Notre Dame de Montréal
avec
Jérôme le Royer de la Dauversière, et la
Ville‑Marie devint
Montréal
en 1642.
Ce travail lui permettra d'être
considéré comme le bienfaiteur de la ville. Il gardera de
nombreux contacts avec le
Canada et continuera à envoyer des sulpiciens.
C'est ainsi que le 29 juillet de cette même année,
les premiers sulpiciens débarquèrent au
Canada pour assurer le service de la colonie de
Montréal.
Cette opération d'évangélisation fut
aussi à l'origine d'une curieuse légende :
celle du
Grand Monarque.
Olier avait aussi de grands projets.
Il voulait que Saint‑Sulpice devienne un séminaire
modèle pour tous les évêques de France et ainsi les aider à
fonder leur séminaire selon le
Concile de Trente.
Mais l'énorme chantier de la reconstruction l'épuisa et il
donna sa démission en
1652. Frappé d'une attaque, il mourut le
2 avril 1657 sous les yeux de
Saint Vincent de Paul.
Sa mémoire resta à Paris, mais également au
Canada, aux
États‑Unis et en
Angleterre.
La légende du Grand Monarque
En Nouvelle‑France, le Québec actuel,
Saint Vincent de Paul
et
la Compagnie du Saint‑Sacrement,
société secrète, auraient emmené un trésor précieux,
spirituel, un enfant: un garçon de 4 ans, de sang royal, qui
descendrait du roi David et de Jésus. Était‑il le grand monarque ? Y
aurait‑il une descendance de Jésus actuellement au Québec ?
La légende est en tout cas très vivante...
|
|
Qu'est‑ce que la
Compagnie du Saint‑Sacrement ?
La Compagnie du Saint Sacrement appelée
aussi "la compagnie des prêtres de Saint‑Sulpice" trouve ses
origines durant la période d'évangélisation et de rénovation
chrétienne dans la France du
XVIIe siècle.
C'est
Jean‑Jacques Olier qui favorisa ce mouvement en prenant
part à des missions organisées en Auvergne et à Chartres,
mais il se heurta très vite au problème de la formation des
prêtres. Cette formation ne pouvait passer sans une réforme
du clergé et sans l'application des décisions du
Concile de Trente.
Plusieurs tentatives avant Olier eurent lieu et de nombreux évêques voulurent fonder des séminaires, mais ce fut un échec.
|
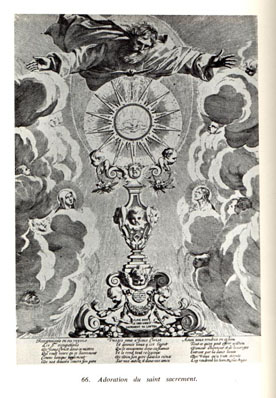
Gravure représentant la Confrérie du
Saint‑Sacrement, 1643
|
|
Vers
1642,
Vincent de Paul,
Jean Eudes et
Jean‑Jacques Olier eurent l'idée de créer un
nouveau style de séminaire basé sur des retraites organisées
pour les ordinands. C'est ainsi qu'Olier
fonda en décembre 1641 un séminaire à
Vaugirard près de Paris.
Quelques mois plus tard,
Olier
devint curé de Saint‑Sulpice et y installa la
communauté à Paris, près du presbytère. D'autres prêtres se
joignirent à lui, ce qui constitua la
Compagnie des prêtres du séminaire de Saint‑Sulpice.
Jean‑Jacques Olier ne désirait pas
fonder une congrégation avec ses maisons propres. Son
idée était plutôt de créer un regroupement de prêtres au
service de l'Église de France. Il formerait ainsi les
candidats au sacerdoce que les évêques lui enverraient. De
plus, les prêtres attachés au séminaire de Saint‑Sulpice
seraient mis à la disposition des évêques pour
travailler à la fondation et à la direction des séminaires
diocésains.
Le développement de la Compagnie s'opéra
à partir du séminaire de Saint‑Sulpice et des Évêques de
France firent appel à ses membres pour prendre en charge
leur séminaire. Ce fut Louis Tronson, Supérieur
général de 1676 à 1700, qui donna à la Compagnie son
organisation.
Juste avant la Révolution française, la
Compagnie géra 15 séminaires et le nombre de ses membres
passa de 70 en
1704
à 140 en
1789. Mais cette période
trouble gêna la Compagnie qui commençait à s'implanter dans
d'autres pays.
Entre
1782 et
1811, la Compagnie accepta la charge de
10
séminaires, mais elle fut supprimée par
Napoléon en
1811,
puis rétablie et approuvée par
Louis XVIII en
1816
comme "congrégation autorisée". Le
nombre de ses membres ne cessa de croître régulièrement et
peu à peu elle prit en charge
20 séminaires en France.
La Compagnie au
Canada
Dès
1657, année de la mort de son fondateur
Olier, elle assura le service spirituel de
Ville‑Marie qui deviendra
Montréal. La Compagnie
commença par guider la paroisse Notre‑Dame et l'aumônerie de
plusieurs communautés religieuses. Plusieurs collèges furent
fondés et en
1840, le séminaire de
Montréal obtint le statut d'université pontificale.
La Compagnie aux États‑Unis
En
1791, en réponse à Mgr Carroll,
premier Évêque des
États‑Unis, monsieur
Emery envoya
4 sulpiciens à
Baltimore
en vue de la fondation d'un séminaire. Aux
États‑Unis, la Compagnie connut un large
rayonnement. Son implantation difficile au début rassembla
de nombreux étudiants de
Baltimore et un sulpicien créa une communauté
de religieuses noires. La Compagnie finit par créer 4
séminaires hors de Baltimore.
La Compagnie en Asie
Plusieurs sulpiciens furent envoyés en mission : deux Français au
Viêt Nam
en 1929,
deux Canadiens au Japon en
1933,
deux Français en
Chine en
1934. Les séminaires de Hanoi, Fukuoka et
Kumming furent fondés.
À partir de
1950, la Compagnie prit
en charge plusieurs séminaires en
Amérique latine et
en Afrique... Le moins que l'on puisse dire est que
la petite idée d'Olier fit son chemin et que le
courant sulpicien voyagea dans le mode entier... Le séminaire et la congrégation qui le dirige
ont aujourd'hui une existence officielle. Le séminaire de
Saint‑Sulpice est le séminaire du diocèse métropolitain de
Paris. Il comprend, sous l'autorité de l'archevêque, la
maison de Paris dirigée par un vicaire général de
Saint‑Sulpice et la maison d'Issy. La congrégation de
Saint‑Sulpice dirige en outre le séminaire de l'Institut
catholique de Paris.
|
|
Qui était Saint Vincent de Paul ?
Vincent de Paul naquit en France en
1581 et
fit ses études à Dax puis à
Toulouse. En 1600,
il fut ordonné prêtre, mais un évènement très curieux le
rendra célèbre : selon ses dires, capturé par des pirates au cours d'une
navigation, il aurait été vendu à un alchimiste de Tunis, puis il aurait réussi à s'enfuir
2 ans plus tard après avoir converti
son maître. Cette escapade ne fut jamais confirmée ni prouvée historiquement.
Il est
clair que cette obscure péripétie de sa vie présente
un réel mystère. Curieusement, à son retour le
28 juin
1607, au lieu de rejoindre sa famille, il préféra aller directement à
Avignon, puis à
Rome, où il eut une entrevue avec le pape.
|

Saint Vincent de Paul
(1581‑1660)
|
|
Le fait est tout de même surprenant,
puisqu'il préféra rejoindre en priorité ses instances hiérarchiques,
plutôt que prévenir ses proches de sa libération et de sa bonne santé. Car il faut rappeler que pendant cette absence, il était
tout simplement passé pour mort.
Qu'avait‑il de si important à confier au pape ?
De retour à
Paris, il se consacra entièrement aux pauvres gens, aux
mendiants, aux forçats, aux enfants, aux vieillards et aux
malades. Il devint l'aumônier de la reine Margot et
renonça plus tard à tous ses privilèges. En
1617, il créa la première confrérie de la
Charité et de retour chez le
comte de Gondi, il se fit missionnaire sur ses
terres. Il rencontra
ensuite
Saint François de Sales et fut nommé
aumônier général des galères en 1619.
En
1633, il fonda avec
Louise de Marillac, la
Congrégation des "Filles de la Charité" après avoir fondé l'année précédente celle des
lazaristes.
Usé et fatigué, il mourut le
27 septembre 1660.
Remarque importante : Jean‑Jacques Olier
et Nicolas Pavillon
furent les élèves de
Saint Vincent de Paul.
|
|
1719 ‑ 1732 La reconstruction
se termine |
|
Il fallut attendre
40 ans pour
que de nouvelles ressources financières soient trouvées.
Ce
fut Jean Baptiste Languet de Gergy (1675‑1750) qui
devint curé de
Saint‑Sulpice en
1714, soit 1 an avant la
mort de Louis XIV. Il quitta sa cure en
1748,
34 ans plus tard.
Une explication officielle de ce nouveau
financement est que
Languet de Gergy eut le droit d'organiser
une loterie
accordée par Louis XV en
1721.
Cette loterie sera proposée aux riches paroissiens près de
Saint‑Germain‑des‑Prés.
Il est malgré tout difficile de croire qu'une simple loterie ait pu financer la suite
des travaux compte tenu de son importance et de sa durée...
|

Jean‑Baptiste Languet de Gergy
(Mausolée par M. A. Slodtz)
|
|

Détail du transept
|

La nef et le chœur au fond de l'église
|
|
C'est un architecte décorateur, élève de
Mansart, Gilles Marie Oppenord (1675‑1742) qui
reprit les travaux. Quant à l'ornementation, elle fut confiée aux frères
Slodtz. Le sculpteur
Edme Bouchardon
réalisa les statues
qui furent commandées par
Languet
de Gergy en
1734. Elles
entourent aujourd'hui le chœur.
Peu à peu l'ancienne église
disparut, laissant place à un ouvrage gigantesque. Les
portails sud et nord furent terminés en
1724, la
coupole en 1727, la voûte de la nef et la décoration
en
1731.
Mais les travaux eurent de temps en
temps quelques accrocs. La tour clocher construite par
l'architecte
Oppenord dut être démolie, car elle était trop
lourde pour l'édifice.
Les travaux furent pratiquement
achevés en
1733, excepté la façade.
Il faut remarquer que
la nouvelle église a été
réorientée
|
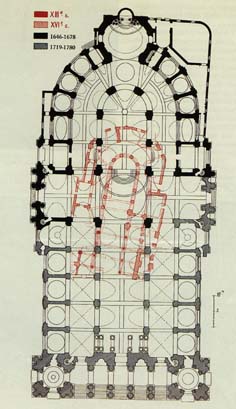
Les constructions successives
|
|
L'église de Saint‑Sulpice
à Paris possède de
nombreuses richesses architecturales et artistiques amenées
entre le XVIIe siècle
et le
XVIIIe
siècle.
La croisée du transept est mise en
valeur par de somptueux reliefs dans la pierre. Quant au chœur,
il
est fermé par une magnifique balustrade
où dix
statues de Bouchardon
représentant 10 apôtres gardent le
lieu.
|

La croisée du transept
|
|

Le chœur entouré des 10 apôtres
(et non 12) de Bouchardon
|

La Chapelle des Âmes du Purgatoire |
|
La commande de
Bouchardon comprenait
14
statues : les 12 apôtres, le Christ et la Vierge.
Malheureusement l'artiste mourut en
1762 et
ne fit que 10 apôtres visibles aujourd'hui. |
|
1732 ‑ 1789 Les premiers embellissements |
|
Si les travaux furent considérés
comme pratiquement achevés en
1733, ce n'est pas pour
autant qu'il n'y eut plus aucun projet. À l'intérieur, de
nombreux embellissements devaient encore trouver leur place.
Enfin, il manquait toujours la façade extérieure.
La façade extérieure
En
1729,
Languet de Gergy désigna un nouvel architecte
italien, Jean Nicolas Servandoni (1695‑1766) qui
décora la chapelle de la Vierge. Et en
1732, ce dernier
remporta le concours pour le projet de la façade extérieure.
Il construisit les deux premiers étages, mais le projet fut
arrêté, car le dernier étage qui devait être formé
d'un fronton triangulaire fut fortement contesté. Pendant
20 ans la façade extérieure était donc limitée au
second étage.
|
|
Les projets de façade ne manquèrent
pas...
|
|
Le portail de
la façade fut finalement achevé en
1749. Il se compose de deux portiques superposés : le
rez‑de‑chaussée d'ordre dorique, et le supérieur d'ordre ionique
percés de sept arcades. |
|

La tour nord est aujourd'hui
en cours de restauration
|

Le second étage de la façade en style
ionique
|
|
Après la mort de Jean Nicolas Servandoni en
1766,
un nouveau concours désigna Oudot de Maclaurin qui
construisit deux tours jumelles de
70 m (4 m de plus que les
tours de Notre‑Dame de Paris) et 4 socles entre elles pour y poser 4 statues.
Un autre architecte,
Jean‑François Chalgrin
(1739‑1811), célèbre pour sa construction de l'Arc de Triomphe, fut chargé en
1776 d'agrandir les tours pour les harmoniser avec
le reste. Il commença ses travaux sur la tour gauche (Nord), ce
qui fut fait. Mais la Révolution l'empêcha de terminer la tour
droite.
Ceci explique sa hauteur plus réduite de
5 m et son décor inachevé. Elle est utilisée aujourd'hui pour
nicher des faucons... |
|
La tour droite (Sud) inachevée |
|
Les deux tours se composent d'un
pavillon carré accompagné de colonnes corinthiennes et d'un
fronton triangulaire. Au‑dessus du pavillon carré se dresse la
tour circulaire. La tour nord renferme les cloches. Elle fut
aussi utilisée pour recevoir un télégraphe aérien dont les bras
noirs s'agitèrent au‑dessus de la rue des Aveugles jusqu'à
l'installation de la télégraphie électrique à Paris en
1852. |
|
La chapelle de la Vierge
Outre les sculptures, les peintures et
les boiseries qui vinrent petit à petit décorer les
différentes chapelles, la chapelle de la Vierge
derrière le maître‑autel fut l'un des éléments clés de cette
période. Achevée en 1777, elle fut construite par
Gamard pour sa forme elliptique,
Le Vau pour les
murs, et Servandoni pour la décoration.
La niche et la coupole ouverte sont de
Charles de Wailly
et datent de
1774.
Vanloo a peint les panneaux et
les frères Slodtz en ont modelé les ornements de
marbre, de bronze et d'or. Derrière l'autel, une étroite
ouverture au fond de la coupole laisse filtrer depuis l'extérieur un rayon
lumineux sur le marbre blanc de la statue de la Vierge, un chef‑d'œuvre de
Pajou. Le plafond a été décoré par
Lemoine
dans le même style que le plafond d'Hercule peint par lui au
château de Versailles.
|
|

La chapelle de la Vierge
|
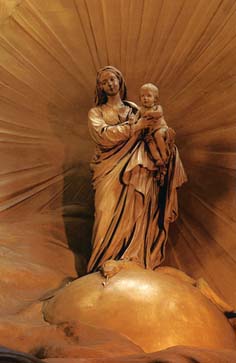
La Vierge et l'Enfant écrasant un serpent,
symbole lazariste
|
|
On trouve dans cette chapelle ne
nombreux thèmes bibliques comme la Genèse, l'Évangile de
Jean et les noces de Cana, l'Apocalypse avec le livre aux
7 sceaux, l'agneau immolé ou les 7 lampes brûlant devant
l'éternel.
Un détail surprenant est celui de la
Vierge écrasant un serpent, symbole lazariste. Cette image provient des apparitions de la Vierge à une jeune
novice des
Filles de la Charité en
1830. On retrouve d'ailleurs ce symbole à
Notre Dame de Marceille
dans le parc.
Une statue de
la Vierge et l'Enfant
écrasant un serpent est effectivement dressée au
milieu de la fontaine.
Il faut rappeler que
depuis la fondation de l'église
Saint‑Sulpice par
Olier, disciple de
Saint Vincent de Paul et affilié à la
Congrégation du Saint Sacrement, cette église a toujours été
lazariste, et que c'est
Saint Vincent de Paul qui fonda
la Congrégation des "Filles de la
Charité"...
|
|
La chaire
Autre élément important installé juste
avant la Révolution, une superbe chaire donnée par le
maréchal
Duc de Richelieu et réalisée par
Charles de Vailly en 1788. La finesse de ses ciselures et la
précision des dorures ne peuvent échapper aux visiteurs. Le
corps principal repose sur deux escaliers de marbre,
le tout surmonté d'un groupe en bois sculpté représentant la
Charité entourée d'enfants.
|
|

La chaire date de 1788
|
|
Le gnomon astronomique
Afin de déterminer la date et l'heure
exacte des équinoxes et des solstices, un gnomon
astronomique fut installé en
1737 par le curé
Languet de Gergy.
Le
gnomon de Saint‑Sulpice est en réalité un
cadran
solaire annuel qui fait évoluer un
rayon de soleil le long d'une bande de cuivre insérée dans
le sol. Au cours de l'année, quand le Soleil est à son
zénith, le rayon pénètre dans l'édifice par un trou situé
dans une fenêtre du transept nord et se déplace dans la
largeur de l'église jusqu'au sommet de l'obélisque.
Son objectif premier était de servir à indiquer l'équinoxe vernal
pour déterminer exactement la date de Pâques, mais
comme nous le verrons dans le thème suivant, le gnomon revêt
aussi un aspect ésotérique évident du fait de son lien
étroit avec l'ancien méridien de Paris.
|

Le gnomon
|
|
Le grand orgue
Au fond de la nef, au‑dessus de la
porte principale, un immense buffet d'orgue fut installé et
inauguré en 1781. Il fut réalisé par
François‑Henri Clicquot (1732‑1790)
Les boiseries sont en chêne et
représentent avec ses colonnes corinthiennes un temple
antique en forme d'hémicycle. Au centre, une statue du
roi David
chante des psaumes à l'aide d'une harpe entourée de
chérubins.
|

L'orgue inauguré en 1781
|
|
Le grand orgue fut restauré en
1861
par
Cavaillé‑Coll. Il possède pas moins de 5 claviers complets
et un pédalier, 118 registres, 20 pédales de Coulmans et
environ 7000 tuyaux de 5 mm à 10 m de longueur. L'étendue des
sons est de 10 octaves.
Mû par des moteurs pneumatiques, il
est le plus important d'Europe.
Un détail insolite : dans un recoin des 7 étages de l'orgue se cache un
instrument mondain et profane, le clavecin de
Marie‑Antoinette, Reine de France.
L'orgue majestueux repose sur une
tribune portée par des colonnes composites de style
corinthien et réalisées par
Servandoni.
|
 L'orgue inauguré en 1781 |
|
Les deux bénitiers
Lorsque l'on entre dans l'église par la façade, il est impossible de ne pas remarquer deux
immenses bénitiers largement séparés à gauche et à
droite de la nef. Leur originalité réside dans le fait
qu'ils sont la représentation d'un énorme coquillage de
l'espèce nommée tridachne gigas. Ces sculptures
furent données par la République de
Venise à
François Ier. Elles ont été réalisées par
J.B. Pigalle.
Comme nous le verrons par la suite, l'une d'elles
est fortement liée au
Serpent Rouge
|
|

Le bénitier gauche
|

Le bénitier droit
|
|
1789 ‑ 1802
La Révolution politise Saint‑Sulpice |
|
Le déclenchement de la
Révolution
française interrompit tous les travaux et la tour droite
de la façade resta dans l'état. Mais c'est aussi durant
cette période que l'activité religieuse de Saint‑Sulpice
prit part aux troubles politiques.
Camille Desmoulins
fut le premier à semer la discorde en voulant s'y
marier. Et
Antoine‑Xavier Mayneaud de Pancemont (1756‑1807),
curé de Saint‑Sulpice, s'y opposa en déclarant qu'il était
contre une célébration de mariage envers quelqu'un qui
rejetait dans ses écrits l'Église. Le mariage se fit tout
de même sur ordre du comité ecclésiastique de l'Assemblée
Nationale.
Un curé constitutionnel remplaça
M.
de Pancemont en
1791 et l'église de Saint‑Sulpice
devint un lieu de réunions publiques, favorisé par son
emplacement au chœur de Paris.
Le
2 septembre 1792, la section
du Luxembourg de
la commune de Paris reçut dans l'église
Saint‑Sulpice et par intimidation, l'ordre d'assassiner
tous les prêtres "insermentés" contenus autour de
Saint‑Germain‑des‑Prés. On dénombra
114 victimes.
|
|

L'église Saint‑Sulpice au 18e
siècle
|
|
En
1793, l'église Saint‑Sulpice fut rebaptisée
Temple de la
Victoire
et devint le lieu de séance des théophilanthropes, sous la
présidence de La Revellière‑Lepeaux. On y donna aussi
le 9 novembre 1799 un banquet au général
Bonaparte.
Enfin en 1802, elle fut rendue au culte et devint
la paroisse du XIe (aujourd'hui VIe arrondissement).
La Révolution fit aussi des
saccages importants dans l'héritage historique. Entre
1797 et
1801, les dégradations et les
profanations ne se comptaient plus. Le maître d'autel fut
détruit. Les statues, les cloches, les tableaux et les
autels des chapelles furent enlevés. Tous les objets de
valeurs furent pillés. Les sépultures des cryptes furent
violées et on retrouva des milliers d'ossements répandus sur
le sol. Seuls les objets inamovibles furent préservés
comme l'orgue, le gnomon, les vitraux et certaines
sculptures.
|
|
Le concordat fut signé en
1802 et
c'est Charles de Pierre (1762‑1836) qui devint le
nouveau curé de Saint‑Sulpice. Sa première tâche fut de
remettre en état l'église. Pour cela, il dut procéder à une
véritable enquête pour retrouver les différents objets
éparpillés durant la Révolution. Il put ainsi
retrouver certains tableaux et des statues. Il dut aussi
racheter des boiseries et certains objets qu'il repérait
chez les brocanteurs.
Une restauration plus complète fut
toutefois décidée en 1815. Charles de Pierre resta curé de Saint‑Sulpice jusqu'à
sa mort.
|
|

L'église Saint‑Sulpice en 1900 à
l'époque de Bérenger Saunière et de Boudet
|
|
17 artistes
La municipalité de Paris commanda
entre 1820
et
1875 la décoration des murs du
transept et de toutes les chapelles à
17 artistes
renommés (on retrouve le
fameux
nombre
17).
C'est ainsi que l'on peut
admirer aujourd'hui les peintures d'Eugène Delacroix
(1798‑1863) dans
la chapelle des Saints Anges et qui ont un lien
indéniable avec l'histoire de Rennes‑le‑Château.
|
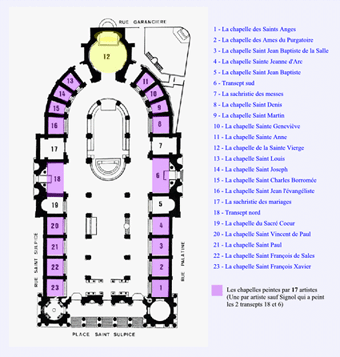
Les différentes chapelles de
Saint‑Sulpice
|
|
Cette initiative de la municipalité permit de décorer les chapelles de la nef et du chœur par les
maîtres de ce siècle, formant ainsi un riche musée
de peintures religieuses.
Les 17 artistes qui ont laissé leur signature
 (1)
Eugène Delacroix a
peint (1849‑1861) pour la chapelle des Saints Anges
(1)
Eugène Delacroix a
peint (1849‑1861) pour la chapelle des Saints Anges
 (2) Heim a peint (1868) pour la
chapelle des Âmes du Purgatoire (2) Heim a peint (1868) pour la
chapelle des Âmes du Purgatoire
 (3) Abel de Pujol a peint (1845) pour la
chapelle Saint Jean Baptiste de la Salle (3) Abel de Pujol a peint (1845) pour la
chapelle Saint Jean Baptiste de la Salle
 (4) Vinchon a peint (1822) pour la
chapelle Sainte Jeanne d'Arc (4) Vinchon a peint (1822) pour la
chapelle Sainte Jeanne d'Arc
 (5)
Signol
a peint (1872) pour les transepts sud et nord (5)
Signol
a peint (1872) pour les transepts sud et nord
 (6)
Jobbé‑Duval a peint (1859) pour la
chapelle Saint Denis (6)
Jobbé‑Duval a peint (1859) pour la
chapelle Saint Denis
 (7)
Mottez a peint (1862) pour la chapelle
Saint Martin (7)
Mottez a peint (1862) pour la chapelle
Saint Martin
 (8)
Timbal a peint (1864) pour la chapelle
Sainte Geneviève (8)
Timbal a peint (1864) pour la chapelle
Sainte Geneviève
 (9) Lenepveu a peint (1864) pour la
chapelle Sainte Anne (9) Lenepveu a peint (1864) pour la
chapelle Sainte Anne
 (10)
Matout a peint (1870) pour la chapelle
Saint Louis (10)
Matout a peint (1870) pour la chapelle
Saint Louis
 (11)
Charles Landelle a peint (1875) pour la
chapelle Saint Joseph (11)
Charles Landelle a peint (1875) pour la
chapelle Saint Joseph
 (12) Pichon a peint (1867) pour la
chapelle Saint Charles Borromée (et St Antoine de Padoue) (12) Pichon a peint (1867) pour la
chapelle Saint Charles Borromée (et St Antoine de Padoue)
 (13) Glaize a peint (1859) pour la
chapelle Saint Jean l'Évangéliste
(13) Glaize a peint (1859) pour la
chapelle Saint Jean l'Évangéliste
 (14)
Guillemot a peint (1824) pour la chapelle
Saint Vincent de Paul (14)
Guillemot a peint (1824) pour la chapelle
Saint Vincent de Paul
 (15) Drolling a peint (1850) pour la
chapelle Saint Paul
(15) Drolling a peint (1850) pour la
chapelle Saint Paul
 (16)
Alexandre Hesse a peint (1860) pour la
chapelle Saint François de Sales (16)
Alexandre Hesse a peint (1860) pour la
chapelle Saint François de Sales
 (17) Emile
Lafon a peint (1859) pour la chapelle
Saint François Xavier (17) Emile
Lafon a peint (1859) pour la chapelle
Saint François Xavier
|
|
La fontaine des 4 évêques
Pour mettre en valeur l'architecture du portail,
un grand espace fut aménagé devant l'église en
1754, prolongeant le
parvis. Au centre, une
fontaine fut construite en
1847
par l'architecte
Louis Visconti (1791–1853).
Ses quatre côtés sont ornés des statues
représentant les évêques prédicateurs de l'époque
Louis XIV :
Bossuet,
Fénelon,
Fléchier et
Massillon.
Cette fontaine est aussi appelée "fontaine des 4 points cardinaux", les 4 évêques
n'ayant jamais obtenu le titre de cardinal...
|
 La fontaine des 4
cardinaux |
|
Quelques personnages célèbres à
Saint‑Sulpice
Charles Baudelaire, poète
français, naquit à Paris le 9 avril 1821 et fut
baptisé à
Saint‑Sulpice. Il fut aussi un ami et un grand
admirateur d'Eugène Delacroix.
Il mourut le 31 août 1867
Le
marquis de Sade naquit à Paris le
2 juin 1740
et fut
baptisé à
Saint‑Sulpice.
Victor Hugo
se maria à
Saint‑Sulpice pour épouser Adèle Fouché le
12 octobre 1822.
Les témoins du marié furent
Alfred de Vigny et
Félix Biscarrat.
|
|

La nef
|

Les voûtes et l'orgue
|
|
Prenons de la hauteur
Avant d'aborder les mystères
de Saint‑Sulpice, il faut admirer sa vue
aérienne.
On devine de gauche à droite, la
fontaine des 4 évêques, la tour gauche en cours de
restauration et la chapelle de la Vierge, nettement visible
complètement à droite.
|
|

Saint‑Sulpice et sa place vue de haut
(photo Google 2005, orientée plein Nord)
|
|
D'autres images...
À découvrir, le transept
et les
fresques d'Émile Signol, la somptueuse
chapelle de
l'Assomption, les nombreux détails dans les boiseries
précieuses de la sacristie, la chapelle
souterraine et
la crypte...
|
|

La sacristie |

La chapelle de l'Assomption |
|

La chapelle de la Vierge écrasant le
serpent
|

Le transept, le gnomon et
une
fresques de Emile Signol |
|

Une magnifique vue de haut de la nef |

La crypte |
|

La suite page suivante |
|
|



