|
Inévitablement, lorsque l'on entre dans les
mystères de Rennes‑le‑Château et que l'on étudie ses racines
historiques, on est confronté à la dynastie des
Mérovingiens. Ce sujet est incontournable, et pour comprendre
les liens complexes qui unissent,
Prieuré de Sion,
descendance mérovingienne,
lignée christique, et
Rennes‑le‑Château, il est important de rappeler
cette page de notre histoire de France et les légendes qui
l'entourent...
La dynastie des Mérovingiens
était‑elle porteuse d'un secret merveilleux ?
|
|
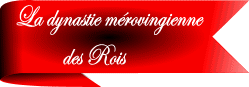
La lignée des rois
mérovingiens
est
disponible ci‑contre
|
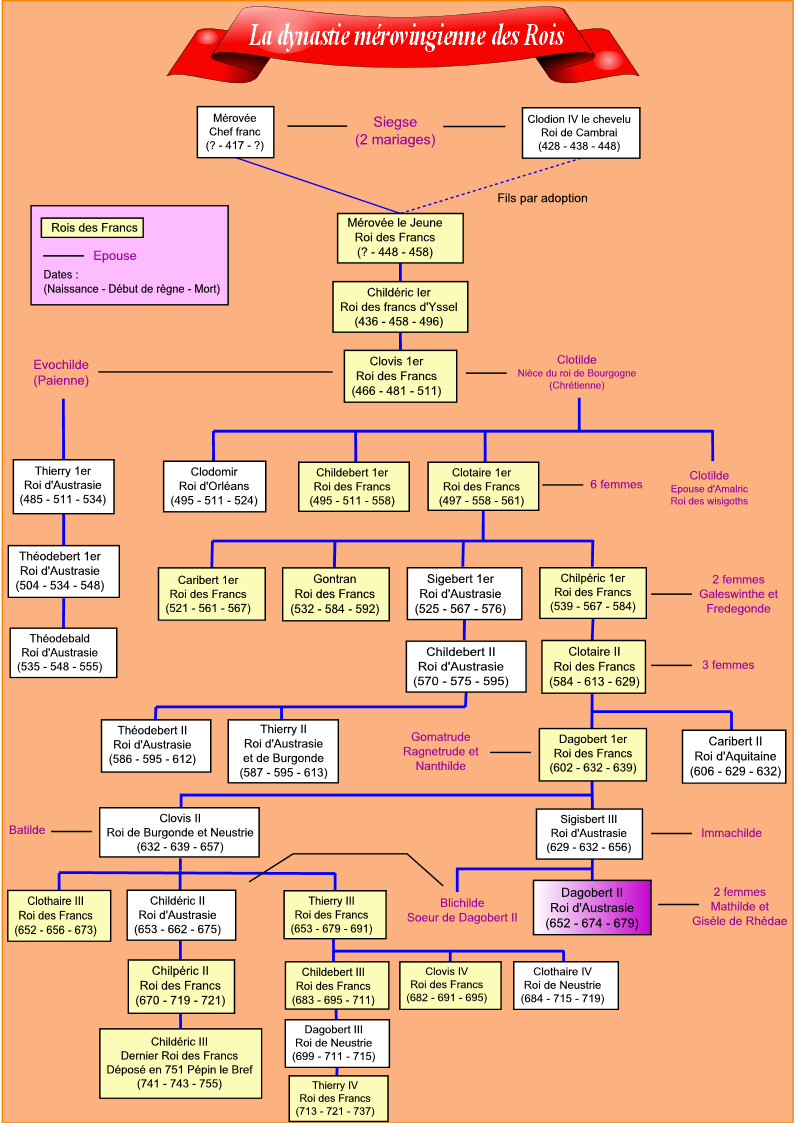
|
|
Qui étaient les Mérovingiens ? |
|
Quelques caractéristiques
Les Mérovingiens régnèrent de 447 à
750 ap. J.‑C. sur un royaume qui s'étendait de part et
d'autre du Rhin et donc sur des terres de la France et de
l'Allemagne actuelle. Ils sont issus de peuples barbares
venus de Germanie et s'installèrent aux frontières de
l'Empire romain. Ce sont les Francs et les
Goths. Ces nouveaux arrivants s'intégrèrent
très facilement avec les Gaulois et participèrent à
l'offensive pour repousser les Huns d'Attila.
Le règne des Mérovingiens est aussi
associé à de nombreuses légendes qui trouvent leurs racines
dans des récits fantastiques comme le Roi Arthur, les
Chevaliers de la Table ronde, ou le Graal. |
|
La dynastie
trouve l'origine de son nom dans
Mérovée qui, d'après la légende, naquit de deux
pères : le roi Clodion et une créature "La bête de
Neptune".
Mérovée hérita de nombreux pouvoirs magiques
et surnaturels qu'il transmit ensuite à ses descendants.
C'est ainsi que les Mérovingiens se croyaient investis de pouvoirs
surnaturels. Ils guérissaient avec les mains et parlaient avec
la nature. Comme pour tracer la lignée, les nouveau‑nés
étaient marqués d'une croix rouge sur le cœur ou sur le dos,
symbole que l'on retrouvera plus tard chez les Templiers.
Les pièces de monnaie sont gravées avec la croix des
croisés de Jérusalem. |

Mérovée |
|
Mérovée est considéré
comme le premier roi des Francs. Ce personnage mal connu est le
fils présumé de Chlodion le Chevelu et semble reprendre la
succession du pacte effectué avec les Romains par Clodion. Le 20
septembre 451, il participa avec le général romain Aetius à la
bataille des champs Catalauniques contre Attila. Il donna son
nom à la première dynastie des rois de France (son nom
Mérowig, signifie
éminent guerrier). Il épousa Chlodeswinthe vers 446 (?) et eut un fils Childéric Ier. |
|
De la même façon que les Romains, les Mérovingiens se
dotèrent d'une loi : la loi salique (du nom des francs saliens,
peuple de Clovis). Cette loi, qui est une des bases de la monarchie, oblige la transmission du pouvoir royal par les fils
exclusivement. Cette loi qui causera leur perte est à
l'origine du partage du royaume entre les héritiers à de
nombreuses occasions. En trois siècles, le territoire de Clovis
se trouvera découpé maintes fois de façon désordonnée.
C'est à l'âge de
12 ans que le futur souverain obtient le titre de roi. Il devient alors un symbole et l'important est de paraître et non de diriger. Le pouvoir
monarchique est relayé par le "maire du palais" qui
gouverne directement la région qui lui est attribuée.
Les rois mérovingiens sont
polygames et possèdent des harems. L'objectif est de
préserver le sang royal et donc ne pas le mélanger à
d'autres lignées pour des raisons politiques ou pécuniaires.
La vertu mérovingienne vient du sang et la sauvegarde de la
race en dépend.
Les rois mérovingiens sont également
appelés "Les rois aux cheveux longs", car leur
chevelure était un symbole de pouvoir magique. La pire
condamnation pour un Mérovingien était d'être tondu, ce qui
était souvent pratiqué.
Le crâne des
rois défunts était trépané
pour permettre à l'âme de quitter le corps. L'incision
est très visible sur
le
crâne de Dagobert II. C'est cette
coutume qui permit par exemple de supposer que la sculpture
du "Cap de l'Hom" sauvegardée par
Boudet
était d'origine mérovingienne. Un
trou est en effet visible au sommet du crâne.
Les rois mérovingiens sont réputés pour leur cruauté et leur
fourberie. Ils n'hésitaient pas à trahir leurs proches ou
leur famille et à les assassiner.
|
|
La jalousie et la soif de pouvoir engendraient les
conspirations et les complots. Les reines n'étaient
d'ailleurs pas épargnées :
La
Reine
Frédégonde est restée célèbre pour sa cruauté et sa
brutalité envers ses proches. Elle n'hésitait pas à utiliser
l'arme blanche ou le poison pour arriver à ses fins. Une
anecdote est celle de sa fille Rigonthe qui lui réclamait
les trésors de Chilpéric. Frédégonde accepta, mais alors que Rigonthe puisait dans le coffre, sa mère abattit le
couvercle sur la tête de sa fille et pesa de toutes ses
forces. Une servante qui passait par là appela au secours et
l’on vint juste à temps pour sauver Rigonthe de son
supplice… |
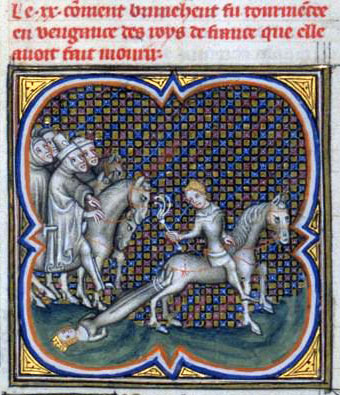
Le supplice de
Brunehaut, enluminure issue des
Grandes Chroniques de France,
XIV°
Bibliothèque Nationale |
|

Le supplice de Brunehaut
par
François Guizot 1875 |
Un autre fait célèbre qui marque la brutalité de l'époque
est celui de la mort de
Brunehaut en 613.
Reine et régente
d’Austrasie, fille du roi wisigoth Athanagild, Brunehaut épousa en
567, le roi franc d’Austrasie Sigebert 1er,
mort assassiné.
En 597, Brunehaut voulut unifier le monde
franc, mais elle se heurta à l’aristocratie austrasienne.
Les leudes ne virent pas d’un bon œil le fait que Brunehaut
prenne le pouvoir et un parti se forma contre elle. Les leudes
austrasiens préférèrent offrir les royaumes d’Austrasie et de
Bourgogne à Clotaire II plutôt que d’obéir à Brunehaut.
|
|
En
613, Clotaire II envahit l’Austrasie. Brunehaut
préféra fuir jusque dans les montagnes du Jura. Mais elle fut
faite prisonnière et livrée au roi de Neustrie. La vieille reine
comparut devant le tribunal de son neveu, Clotaire II, qui n’eut
aucune pitié pour elle. Brunehaut fut accusée d’un demi‑siècle
de crimes, dont la plupart avaient été commis par la reine
Frédégonde. Brunehaut fut torturée 3 jours durant, puis le
roi ordonna qu’elle soit liée par les cheveux à la queue d’un
cheval indompté. La malheureuse fut mise en pièces par
l’animal...
Son
cadavre fut brûlé.
La dynastie royale comprend
40 souverains, et leur généalogie est complexe du
fait de la polygamie et de plusieurs mariages entre
Mérovingiens.
Il est d'ailleurs intéressant de remarquer
que le site de
l'église Saint‑Sulpice et de
l'abbaye de Saint Germain des
prés à Paris représentaient un lieu mérovingien très
important. Des fouilles archéologiques effectuées en 1919
mirent en lumière de nombreux vestiges, dont
le célèbre tombeau
de la reine sorcière Frédégonde. Pierre Plantard fut
d'ailleurs le premier chercheur de Rennes à s'intéresser d'aussi
près à cette dynastie surprenante. |
|
La liste des Rois
mérovingiens
précédés de leur date de règne
428 à 447 CLODION le
chevelu (Roi des Francs Saliens)
447 à 457 MEROVEE (Roi des Francs)
457 à 481 CHILDERIC 1er (Roi des Francs Saliens)
481 à 511 CLOVIS 1er (Roi des Francs)
511 à 524 CLODOMIR (Roi d'Orléans)
511 à 558 CHILDEBERT 1er (Roi de Paris)
511 à 534 THIERRY 1er (Reims et Metz)
511 à 561 CLOTHAIRE 1er le Vieux (Soissons)
534 à 548 THIBERT 1er (Metz, Austrasie)
548 à 555 THIBAUD (Metz)
558 à 561 CLOTHAIRE 1er le Vieux (Roi des Francs)
561 à 568 CARIBERT 1er
(Roi de Paris)
561 à 575 SIGEBERT 1er (Metz, Austrasie)
561 à 584 CHILPERIC 1er
(Soissons, Neustrie)
561 à 593 GONTRAND (Roi d'Orléans, Bourgogne)
568 à 584 CHILPERIC 1er (Roi de Paris, Soissons,
Neustrie)
584 à 592 GONTRAND (Roi de Paris)
584 à 629 CLOTHAIRE II le Jeune (Roi de Neustrie)
586 à 612 THIBERT II (Roi d'Austrasie)
592 à 595 CHILDEBERT II (Paris,
Austrasie, Bourgogne)
595 à 613 THIERRY II (Bourgogne, Roi de Paris,
Austrasie)
613 à 629 CLOTHAIRE II le Jeune (Roi des Francs)
629 à 639 DAGOBERT 1er (Roi des
Francs, Austrasie)
634 à 656 ST SIGEBERT III (Roi d'Austrasie)
635 à 657 CLOVIS II (Roi de Neustrie, Paris,
Bourgogne)
656 à 675 CHILDERIC II (Roi d'Austrasie)
657 à 673 CLOVIS II (Roi des Francs)
657 à 673 CLOTHAIRE III (Roi des Francs, Neustrie,
Bourgogne)
673 à 675
CHILDERIC II (Roi des Francs)
673 à 691 THIERRY III (Neustrie, Roi des Francs,
Bourgogne)
675 à 676 CLOVIS III (Roi d'Austrasie)
676 à 678 ST DAGOBERT II (Roi d'Austrasie)
687 à 691 THIERRY III (Roi des Francs)
691 à 695 CLOVIS IV (Roi des Francs et Austrasie)
695 à 711 CHILDEBERT III (Roi des Francs,
Neustrie,Bourgogne)
711 à 715 DAGOBERT III (Roi des Francs, Neustrie)
715 à 721 CHILPERIC II (Roi des Francs et Neustrie)
716 à 719 CLOTHAIRE IV (Roi de Neustrie)
720 à 737 THIERRY IV de CHELLES (Roi des Francs)
737 à 743 (inter règne)
743 à 751 CHILDERIC III le Fainéant (Roi des Francs
et Neustrie) |
|
Les débuts de la dynastie
La lignée mérovingienne démarra par
Mérovée, chef franc en 417, puis par son
fils
Mérovée le Jeune, roi des francs de 448 à
458.
Vint ensuite sur le trône
Childéric Ier de 458 à 496. À cette
époque, le royaume est prospère et aussi bien le commerce que
l'agriculture se développent rapidement. Les souverains
étaient d'ailleurs très riches. Une importante fabrique
royale se trouvait à
SION en Suisse.
La tombe de Childéric Ier
fut découverte le 27 mai 1653 à Tournai,
à quelques
kilomètres de la frontière française. Celle‑ci était
entourée de fosses rayonnantes, à une vingtaine de mètres de
distance de la sépulture, renfermant plusieurs dizaines
d'étalons sacrifiés lors des funérailles.
On retrouva dans le tombeau
300 abeilles en
or, l'abeille étant un symbole sacré mérovingien. Elles furent
confiées à Léopold Guillaume de Habsbourg, et
récupérées par Napoléon qui en fit le principal ornement de
ses habits.
Outre les abeilles d'or que Bonaparte s'appropria,
Childéric Ier portait
au doigt un anneau sigillaire représentant sa tête coiffée
d'une longue chevelure tressée.
|
|
Clovis, un règne charnière
En 481, l'année fut cruciale pour
la dynastie mérovingienne.
Clovis devint le premier roi franc de la lignée
et étendit son royaume du nord de la Gaule jusqu'à la Loire.
Il se maria à Clotilde, fervente catholique romaine. Ceci le décida à se convertir au catholicisme. Ce fut fait à Reims en
l'an 496.
Pour Rome et le
pape, ce pacte assurait l'implantation de l'Église en
Occident. En échange, il obtint l'autorisation de régner sur
l'ancien Empire romain sans durée limitée.
C'est le pacte de
Clovis et son héritage qui sera transmis à la
descendance mérovingienne.
Le roi franc Clovis étendit
son domaine par de multiples conquêtes et construisit son
royaume sur les frontières de l’actuelle France et du
catholicisme. La dynastie des Mérovingiens pouvait commencer.
|

Le baptême de Clovis à Reims
Peinture de St Gilles
|
|
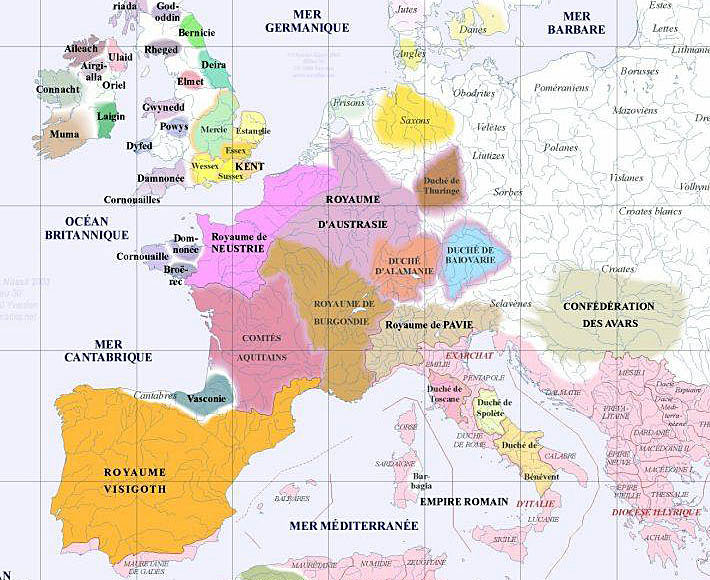
L'Europe en l'an 600 ‑ Ce qui deviendra la
France est morcelé en plusieurs royaumes
Les Wisigoths occupent l'Espagne, les Pyrénées et la côte
narbonnaise
Carte extraite de l'Atlas historique périodique de
l'Europe
© 2003, Christos Nüssli, Euratlas ‑
www.euratlas.com |
|
Clovis fit imposer par tous les moyens la foi
catholique et étendit son royaume vers l'Est et le sud de
la Gaule.
Il fit de Paris la capitale.
Il repoussa également ses ennemis jurés, les
Wisigoths, en
507, hors d'Aquitaine. Les Wisigoths se retranchèrent
alors à Carcassonne, puis à Rhedae (Rennes‑le‑Château) où
ils firent leur capitale.
Clovis est un personnage historique essentiel, car il traça
les premières frontières d’un royaume qui deviendra
l’actuelle France et imposa le Christianisme comme religion
officielle dans cette partie de l’Europe.
Mais à sa mort en 511,
son pouvoir se divisa parmi ces 4 fils, ce qui provoqua des
rivalités et le chaos. Le royaume fut partagé
progressivement en 3 régions : Neustrie (la Normandie),
Austrasie (la Lorraine) et Burgonde (la
Bourgogne).
|
|
C'est à partir de cette époque que le
pouvoir des Mérovingiens devint confus, naviguant entre
l'autorité d'un roi et la souveraineté des maires du palais
qui gouvernaient les régions. Les rivalités et les
affrontements devinrent alors nombreux.
À partir de
639, le pouvoir des
Mérovingiens s'affaiblit et les maires de palais prirent le
dessus. Les rois sont alors nommés "Rois fainéants". Régnèrent
ensuite dans l'ordre:
Chilpéric Ier,
Clotaire II,
Dagobert Ier, et
Sigisbert III.
Sigisbert III fut
assassiné en 676 sur ordre du maire du palais
Grimoald qui veut installer sur le trône d'Austrasie son
fils Childebert.
Il faut alors attendre
Dagobert II, fils unique de Sigisbert III pour
que la dynastie mérovingienne connaisse un nouveau
rebondissement.
|

Le gisant de Clovis à
la basilique Saint Denis (Paris)
|
|
Dagobert II
ou la connexion avec Rennes‑le‑Château |
|
Dagobert II est né en 652
de Sigisbert III et d'Immachilde
Il est le
petit‑fils de Dagobert Ier
Il devient roi à 24 ans de 676 à 679
Il épouse Mathilde en 666,
puis Gisèle de Razès en 671,
princesse
wisigothe
on lui prête au total 6 enfants
Il meurt
assassiné à 27 ans,
le 23 décembre 679
à Stenay et son règne
ne dura
que 3 ans...
|

Dagobert II (652‑679) |
|

Dagobert II ‑ Détail d'un vitrail à
l'église de Mouzay près de Stenay |
|
Son histoire
Né en 652, fils unique de
Sigisbert III et d'Immachilde, il est le petit‑fils de Dagobert Ier. Avant que naisse Dagobert II,
le maire du palais Grimoald adopta son propre fils
Childebert qu'il voulait faire roi.
Et à la mort de Sigisbert III en
656, il confia à Grimoald son fils Dagobert II. Mais
le maire du palais, voyant en lui un futur roi potentiel,
l'écarta du trône. Pour cela, il le fit tondre (ce qui symboliquement
enlève tous ses droits) et le confia
à l'évêque de Poitiers Didon qui l'exila en Irlande avec sa mère
au monastère de Slane situé au nord d'une cité, l'actuel Dublin. Dagobert II avait alors 4 ans et
cette opération le raya littéralement de la dynastie.
Childebert prit ainsi sa place et devint
Childebert III l'adopté.
Ce fait provoqua la révolte des Grands
d'Austrasie, et Childebert III, livré aux Neustriens, fut mis
à mort ainsi que son père Grimoald. Les Neustriens
imposèrent alors sur le trône d'Austrasie Childéric II. Mais
à la mort de Clotaire III en
673, le maire du palais
de Neustrie, Ébroïn, choisit
Thierry III
comme
successeur.
Les Grands d'Austrasie se révoltèrent et
réclamèrent
Childéric II comme roi. Et pour marquer sa prise
de pouvoir, ce dernier fit tondre Ébroïn et Thierry III, puis
il les enferma dans un monastère. C'était sans compter sur
les amis d'Ébroïn qui l'assassinèrent avec sa femme
enceinte.
Pendant ce temps‑là,
Dagobert II fut recueilli par Saint Wilfrid, le futur évêque
d'York qui le protègera en Angleterre durant 15 ans. Wilfrid remarqua le jeune Dagobert et comprit vite qu'il était le
successeur légitime du trône d'Austrasie. Il s'occupa alors de
lui assurer son éducation en tant que conseiller pour
faciliter son retour en France. En
666,
Dagobert II épousa une princesse celte,
Mathilde, en Irlande et
ils s'installèrent à York en Angleterre. Ils auraient eu 3
enfants.
Selon la
légende, Mathilde mourut en
670, et Wilfrid orchestra un nouveau
mariage en 671
(Dagobert avait alors 21 ans) avec
Gisèle de Rhedae, fille
de Béra II, comte de Razès de
sang wisigoth,
et
de sa mère Gislica de Wisigothie.
Toujours selon la légende, Dagobert II quitta l'Angleterre
pour la Septimanie dans le Languedoc où il se cacha. La
région était sous domination wisigothe et le mariage eut lieu à
Rhedae. L'histoire est souvent
faite de contradiction. Voici qu'un Mérovingien, dont la
tradition est de préserver le sang de sa race, se marie à
une Wisigothe, peuple ennemi juré de Clovis. De ce mariage
serait né Sigisbert IV (Le rejeton ardent) en 676. Ce fait, comme
nous le verrons par la suite, est contesté, car il ne repose
sur aucune preuve historique.
Après l'assassinat de
Childéric II,
les Grands d'Austrasie eurent alors un seul objectif :
remettre Dagobert II sur le trône.
Wulfoad, le
maire du palais d'Austrasie et successeur de Grimoald
organisa alors son retour dans les Ardennes. Dagobert fut proclamé Roi
d'Austrasie en 674 avec la complicité de Wilfrid et
de
l'évêque de SION en Suisse.
Devenu roi, Dagobert II s'imposa très vite en supprimant
l'anarchie. Il fut accepté par de nombreuses provinces, mais
pas par la Neustrie. Il reconquit
l'Aquitaine en
679
grâce à l'appui financier de Rhedae.
Dagobert II possédait une forte
personnalité, et il voulut rapidement restaurer l'autorité
mérovingienne en s'opposant violemment contre les Maires et
notamment
Pépin de Herstal (635‑714), maire carolingien
d'Austrasie à qui il supprima le droit de gouverner à sa
place.
|
|
Dagobert II mit aussi un frein à l'expansion de l'Église de Rome et
s'opposa aux nobles désireux d'indépendances.
Il s'attacha
aussi à combattre le pouvoir de ceux qui assassinèrent son
prédécesseur Childéric II, un Mérovingien. Il implanta
également la capitale mérovingienne à
Stenay.
Ces prises de position dure signèrent sa perte, et
un complot organisé par Pépin de Herstal (sur ordre
de Ébroïn pour certains historiens), fut monté avec la
complicité du pape.
|

Dagobert II
|
|
Son assassinat
en 679
Nous sommes le 23 décembre 679. Alors
que Dagobert II chasse dans la forêt de Woëvre près de
Stenay
(au nord de Verdun près de la frontière), il s'arrête
près d'une fontaine pour se détendre et s'endort. Mais sa garde
s'est imprudemment éloignée sur son ordre. Isolé, Dagobert II
est alors assassiné par l'un de ses serviteurs. Il est tué
d'un coup de lance dans l'œil et on le retrouve cloué à un
arbre. Il avait 27 ans.
Son escorte ramena son corps à
Charmoy et il fut enterré dans la basilique
Saint Rémi de Stenay. Jouissant d'une renommée très populaire,
Dagobert II fut proclamé saint et martyr.
|

L'assassinat de Dagobert II
dans la forêt de Woëvre près de Stenay
|
|
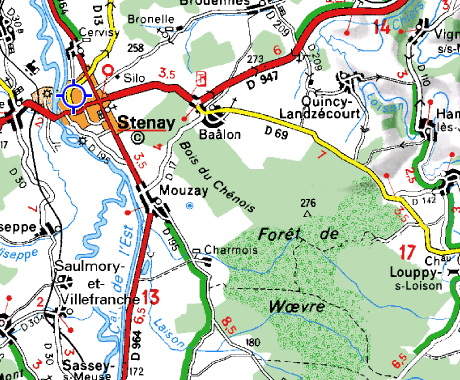
Stenay, capitale des Mérovingiens, Charmois, et la forêt de
Woevre |
|
Le 10 septembre 872,
on retrouva par hasard, sous le chœur de la basilique, le
tombeau de Dagobert II.
Le Roi
Charles II le Chauve exhuma le corps et le transporta
à Douzy où il fut
mystérieusement canonisé le 10 septembre 872 par le
concile métropolitain.
Charles II fit construire une plus grande
église à Stenay,
la basilique Saint Dagobert. Une châsse d'or et
d'argent fut construite pour l'occasion. On y conservera les reliques dont
une partie alla à l'abbaye de Juvigny.
L'église Saint
Dagobert devint la propriété d'un seigneur de la région.
|

Dagobert II mort assassiné
|
|
Plus tard, en 1093, un certain
Godefroi de Bouillon,
descendant mérovingien, siégea Stenay pour récupérer le
sanctuaire. En
1789, la Révolution détruisit l'église et les reliques
furent dispersées. Seul, son crâne fut récupéré
par
les sœurs noires de Mons en Belgique. |
|

Sarcophages mérovingiens |
|
Après la mort de Dagobert II
Après la mort de
Dagobert II, et n'ayant pas de descendance, le Maire du Palais
Ébroïn, proposa de
placer Thierry III
sur le trône d'Austrasie. Pépin de Herstal refusa et
l'Austrasie resta sans roi, laissant ainsi le pouvoir au
maire pour gouverner la province. C'est la période des "rois
fainéants" durant laquelle les souverains trop jeunes
furent écrasés par le pouvoir des maires.
Pépin de Herstal dit Pépin le
Jeune, devint
roi des francs de Neustrie et d'Austrasie. Il mourut
le 16 décembre 714,
et ce fut son fils unique illégitime qui lui succéda :
Charles Martel. Il a
tout juste
26 ans.
Célèbre pour avoir arrêté l'invasion arabe en
732 à Poitiers, Charles Martel dut se battre pour régner sur le
royaume franc, la noblesse neustrienne voulant se soulever.
Il
dut combattre la monarchie mérovingienne et prit peu à peu du
pouvoir. |
|

Le gisant de Charles Martel
à la Basilique Saint Denis (Paris) |
|

Charles Martel à Poitiers en 732 et repoussant l'invasion arabe |
|
Charles Martel mourut le 22 octobre 741, et
malgré le fait qu'il ne fut jamais roi des francs, on l'inhuma
à la
basilique Saint Denis avec les autres rois, une distinction exceptionnelle. La succession fut
assurée par ses deux fils, Carloman et Pépin le Bref, le père de
Charlemagne. |
|
Un fait peu connu est celui‑ci : Pépin le Bref usurpa le trône
avec l'accord du pape Zacharie en destituant
Childéric III, le neveu de Dagobert II et
le dernier Mérovingien connu. Pour ajouter à l'humiliation,
Pépin le Bref le fit tondre.
Ayant alors la voie libre, Pépin le Bref put être sacré roi des Francs le
27 juillet 754 à la place de Childéric III. La
dynastie des Carolingiens pouvait alors commencer, remplaçant celle des Mérovingiens.
En résumé, l'assassinat de Dagobert II, dernier
roi mérovingien se prétendant d'ascendance davidique, fut
l'évènement qui permit l'usurpation du trône du royaume
des francs par Pépin le Bref de dynastie carolingienne.
|

Pépin le Bref (751‑768)
|
|

L'éviction du dernier roi mérovingien
Childéric III qui fut tondu |
|
La fontaine
Saint Dagobert |
|
La fontaine Saint Dagobert
ou "la fontaine d'Arphays"
est l'une
des deux sources de la forêt de Woëvre. Il s'agit de l'endroit exact où fut
assassiné Dagobert II en 679 alors qu'il était roi mérovingien.
L'histoire
raconte que c'est au cours d'une partie de chasse à cheval,
qu'il fut mortellement frappé en traître sur ordre de
Ebroin, le maire du palais de Neustrie et de Burgonde
(Bourgogne actuelle)
|

La fontaine Saint Dagobert ou d'Arphays
dans les Ardennes,
là où fut assassiné Dagobert II
|
|
Mais pourquoi ce fait historique est‑il
aussi important ? Simplement parce que cet assassinat marque la
fin de la dynastie mérovingienne. En effet, Dagobert II n'ayant
officiellement aucune descendance, la lignée mérovingienne
s'éteignit définitivement. Compte tenu de la très haute
importance que cette lignée représentait à leurs yeux, cet
évènement fut sans aucun doute ressenti comme la fin d'un règne
de plus de trois siècles.
La fontaine Saint Dagobert est devenue aujourd'hui
un lieu de pèlerinage initiatique. De nombreux visiteurs tentent par la
randonnée pédestre (6 km à partir du château de Charmois) de
retrouver la trace de Dagobert II il y a 1500 ans,
de même que l'atmosphère oppressante du lieu. Des reliques du Roi y sont même présentées à cette occasion. Il faut
souligner que la forêt de Woëvre a conservé son aspect
de l'époque, verdoyante et épaisse dans les belles saisons,
froide et neigeuse en hiver, ce qui ajoute certainement à la lourdeur et à l'ambiance de
ce
lieu chargé d'Histoire. |
|
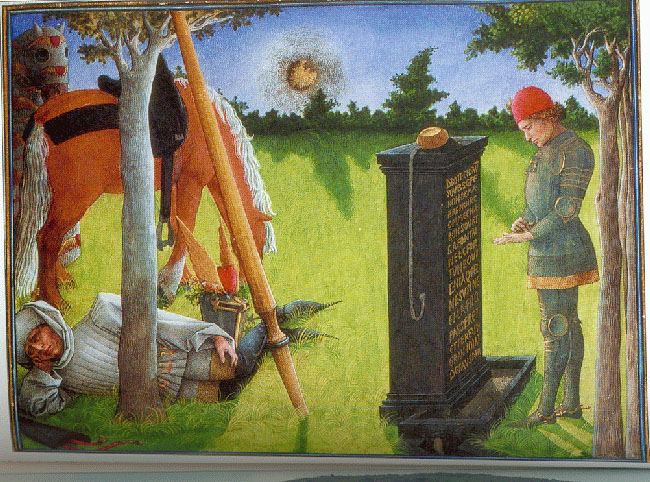
"La Fontaine de Fortune" par René d'Anjou
(1457) |
|
C'est aussi cet assassinat historique que l'on
retrouve suggéré dans une enluminure célèbre et étrange de René d'Anjou "La Fontaine de Fortune" et qui cache
certainement un secret dans sa composition. On y voit deux
personnages, un chevalier et son écuyer particulièrement attristés.
Le chevalier est intrigué devant une stèle en forme
de fontaine. On peut aussi remarquer une lance,
allusion sans doute à celle
qui servit à assassiner Dagobert II. Il faut aussi noter le casque ailé du chevalier que ce dernier a ôté avant de se
recueillir devant la fontaine. Des erreurs
grossières dans la projection des ombres sont également à signaler... |
|
La légende de Sigisbert IV, fils de Dagobert II |
|
Ce sont les mystères de
Rennes‑le‑Château et
la Dalle des Chevaliers
trouvée par Bérenger Saunière qui firent remonter à la
lumière une certaine lecture de la descendance mérovingienne.
Dagobert II aurait eu selon la légende un fils, Sigisbert IV en 676
avec Gisèle de Rhedae († 678).
Pour certains, il serait mort avec lui dans la forêt de
Woëvre, pour d'autres il aurait survécu, puis aurait été caché afin
qu'il ne subisse pas le même sort que son père.
L'histoire officielle nous dit que
Dagobert II n'eut pas de fils, et en effet aucun
élément ne permet d'affirmer le contraire.
On ne peut donc procéder que par faisceaux
de présomption, telle une enquête policière.
La légende du Rejeton Ardent
Après l'assassinat de Dagobert II par le maire du Palais,
Ebroin, ce dernier aurait voulu également en finir avec le
fils
Sigisbert IV, roi potentiel. Il déploya alors tous
les moyens pour parvenir à ses fins. Consciente du danger,
Gisèle de Rhedae, la mère du jeune futur roi, décida de le protéger et
de le cacher en l'éloignant de la région de Stenay. Il
fallait non seulement le faire disparaître discrètement aux
yeux des auteurs du complot, mais aussi le mettre à l'abri
dans un lieu sûr et distant. Ebroin
chercha alors Sigisbert IV dans toute la région,
en vain.
Gisèle, aidée d'hommes dévoués à sa cause, organisa
le voyage de son fils. Ce fut alors un véritable tour de
passe‑passe pour déjouer la surveillance des révoltés et
brouiller les pistes.
Sigisbert IV fut envoyé à un endroit diamétralement
opposé à Stenay, dans le Comté du Razès, province du sud de
la Gaule... à Rhedae
(Rennes‑le‑Château).
À cette époque, Rennes‑le‑Château
était une place forte wisigothe. La citadelle de la cité
située au sommet d'une colline et qui est le seul
témoignage visible aujourd'hui, était réputée
imprenable. Du sommet, la vue permet de surveiller toute la
vallée de l'Aude et de la Sals. Les historiens semblent d'accord sur un point : Rhedae était certainement aussi importante que
Carcassonne et Narbonne. Dans ce contexte, il est évident que
Sigisbert IV, mis au secret, aurait pu avoir une descendance.
Ainsi, le fils de Dagobert II, dit
le Rejeton Ardent, aurait permis d'assurer cette précieuse lignée
mérovingienne à Rennes‑Le‑Château. C'est en tout cas ce que nous rapporte la
légende et l'une des thèses. Bien sûr, il n'existe aujourd'hui
aucune preuve historique de ceci.
|
|
Résumons la
généalogie de Dagobert II
Dagobert II
(652‑ † 679) se maria en
666
et eut 3 enfants
de sa première épouse Mathilde
(† 670) :
 Sigebert
(†
678), décédé un an avant l'assassinat de son père et qu'il ne faut pas
confondre avec Sigisbert IV le Rejeton Ardent Sigebert
(†
678), décédé un an avant l'assassinat de son père et qu'il ne faut pas
confondre avec Sigisbert IV le Rejeton Ardent
 Rotilde
qui fut sourde et muette. Elle aurait été guérie par
saint Florent Rotilde
qui fut sourde et muette. Elle aurait été guérie par
saint Florent
 Ragnetrude
(† 678)
dont on ignore tout. Elle est aussi connue sous
le nom de Ragentrude de Bavière ou Regintrude Ragnetrude
(† 678)
dont on ignore tout. Elle est aussi connue sous
le nom de Ragentrude de Bavière ou Regintrude
Dagobert II
se maria une seconde fois en 671 avec
Gisèle de Razès
(653‑678) fille de Berae II comte de Razès, et eut
officiellement
2 filles :
 Sainte Irmine
(† 726) qui fut la première abbesse du monastère
d'Oeren en
708
qu'elle fonda
près de Trèves (Allemagne). Sainte Irmine
(† 726) qui fut la première abbesse du monastère
d'Oeren en
708
qu'elle fonda
près de Trèves (Allemagne).
 Sainte Adèle
(675‑735) qui fonda l'abbaye de Pfalzel dans le diocèse de Trèves.
Elle fut mariée à Aberic et mère d’un fils.
Lorsqu’elle devint veuve, elle fut sollicitée par de
nombreux prétendants, mais elle préféra entrer en religion.
Elle devint alors disciple de Saint‑Boniface et fonda le
monastère Palatiole (aujourd’hui Pfalzel), non loin de
Trèves (Allemagne), dont elle devint une abbesse réputée et
respectée. Elle est aussi la grand‑mère de Saint Grégoire
d’Utrecht qui fut l'un des plus dynamiques disciples de
saint Boniface, l'évangélisateur de la Germanie. Sainte Adèle
(675‑735) qui fonda l'abbaye de Pfalzel dans le diocèse de Trèves.
Elle fut mariée à Aberic et mère d’un fils.
Lorsqu’elle devint veuve, elle fut sollicitée par de
nombreux prétendants, mais elle préféra entrer en religion.
Elle devint alors disciple de Saint‑Boniface et fonda le
monastère Palatiole (aujourd’hui Pfalzel), non loin de
Trèves (Allemagne), dont elle devint une abbesse réputée et
respectée. Elle est aussi la grand‑mère de Saint Grégoire
d’Utrecht qui fut l'un des plus dynamiques disciples de
saint Boniface, l'évangélisateur de la Germanie.
|
|
Des éléments qui confirmeraient la
légende
Plusieurs éléments
convergents tendraient à montrer que cette légende est la
mémoire d'un fait historique bien réel :
 A cette époque, l'espérance de vie
d'un homme était d'environ 30 ans et
Dagobert II, bien qu'assassiné à
l'âge de 27 ans, avait presque atteint ce
seuil. Il est donc tout à fait imaginable
que Dagobert II soit le père d'un fils. Autre élément, en
ce temps on se mariait à l'âge de 7 ans et
les jeunes filles devenaient mères vers 14 ans. Il existe d'ailleurs une étrange affaire : l'existence d'un parchemin de la
main de la fille de Dagobert II et de
Gisèle :
Saint Irmine,
abbesse d'Oeren en 708 A cette époque, l'espérance de vie
d'un homme était d'environ 30 ans et
Dagobert II, bien qu'assassiné à
l'âge de 27 ans, avait presque atteint ce
seuil. Il est donc tout à fait imaginable
que Dagobert II soit le père d'un fils. Autre élément, en
ce temps on se mariait à l'âge de 7 ans et
les jeunes filles devenaient mères vers 14 ans. Il existe d'ailleurs une étrange affaire : l'existence d'un parchemin de la
main de la fille de Dagobert II et de
Gisèle :
Saint Irmine,
abbesse d'Oeren en 708
 Il est impensable de croire que
Dagobert II n'ait pas tenu à avoir un fils. La
descendance mérovingienne en dépendait et il est du
devoir d'un roi d'assurer sa lignée, surtout mérovingienne.
Il est impensable de croire que
Dagobert II n'ait pas tenu à avoir un fils. La
descendance mérovingienne en dépendait et il est du
devoir d'un roi d'assurer sa lignée, surtout mérovingienne.
 Dagobert II se maria pour
la seconde fois en
671 à 21 ans avec
Gisèle de Razès. Si l'on prend
l'hypothèse qu'ils eurent un fils
Sigisbert IV en
676 (d'après le
Prieuré de SION), ce
dernier devait avoir presque
4 ans lors de l'assassinat du père en
679. Sigisbert était donc trop jeune
pour prendre des initiatives et trop âgé
pour ne pas laisser une trace historique.
Cet âge pourrait correspondre.
Dagobert II se maria pour
la seconde fois en
671 à 21 ans avec
Gisèle de Razès. Si l'on prend
l'hypothèse qu'ils eurent un fils
Sigisbert IV en
676 (d'après le
Prieuré de SION), ce
dernier devait avoir presque
4 ans lors de l'assassinat du père en
679. Sigisbert était donc trop jeune
pour prendre des initiatives et trop âgé
pour ne pas laisser une trace historique.
Cet âge pourrait correspondre.
|
|
Les éléments à décharge
Il est clair que du point de vue
historique, il n'existe aucune preuve ni aucune trace d'un fils
roi exilé à Rhedae. Pour les historiens qui admettent son existence, il
aurait été assassiné avec son père durant la partie de
chasse.
Si l'on suppose que
Sigisbert IV a été
assassiné dans la forêt de Woëvre, pourquoi n'a‑t‑on aucun
écrit, aucune allusion d'un fait aussi important pour
l'époque. La mort de Dagobert II est connue avec précision,
pourquoi pas celle de son fils ? Comment peut‑on imaginer que
l'on n'est aucune trace de la sépulture de
Sigisbert IV
alors que la dépouille du roi fut transférée dans une
basilique pour être transformée en relique. Soit il s'agit d'un mythe, soit ce fils roi a été mis au secret.
|
|
Que peut‑on en conclure ?
Si l'on admet que
Dagobert II n'eut jamais de fils ou qu'il fut
assassiné avec son père, le problème de descendance est
évident. Et la lignée mérovingienne s'étant éteinte, le pouvoir
royal ne pouvait que changer de sang.
À l'inverse, si l'on
considère que Sigisbert IV a existé et qu'il a été mis au secret, il y a usurpation du pouvoir royal. La
descendance mérovingienne devient alors légitime et tous
les mystères entourant cette page de notre Histoire sont
compréhensibles. Cette légitimité remettrait donc en cause les
descendances royales suivantes et donc d'une manière plus générale,
la lignée complète des rois de France.
C'est sur cette dernière hypothèse
qu'est bâti l'arbre généalogique des comtes de Rhedae. L'arbre diffère bien sûr de celui que l'on peut trouver dans
les livres d'histoire officiels.
Enfin, c'est sur cette généalogie que
Pierre Plantard et son complice
Philippe de Cherisey
s'appuyaient pour confirmer la thèse d'une descendance
mérovingienne dans la famille Plantard. Il est vrai que
Sigisbert IV, dit
le Rejeton Ardent, se
dit en vieux français:
PLANT‑ARD
|
|
Manipulation sur la Dalle des chevaliers
Il existe dans les révélations de
Pierre Plantard des exemples de manipulation
flagrante. L'une d'elles concerne la
Dalle des Chevaliers. Il faut néanmoins considérer que
ces manipulations restent anecdotiques si on les compare à tous les éléments amenés par Plantard et qui sont aujourd'hui vérifiés et
confirmés par l'Histoire. |
|
La Dalle des Chevaliers fut découverte par
Bérenger Saunière dans son église
et servit de preuve pendant quelque temps pour confirmer l'existence du Rejeton Ardent. Cette dalle longtemps présentée d'époque
wisigothe ou mérovingienne présenterait sur le tableau droit un chevalier portant un
jeune enfant pouvant être Sigisbert IV.
La dalle pourrait alors faire référence au long voyage de ce roi perdu depuis Stenay
jusqu'à
Rennes‑le‑Château... |

Relevé de la dalle des chevaliers
par
Stublein
On voit nettement le bouclier à droite qui a été redessiné
pour faire
croire à un enfant
|
|
En fait, nous
savons
aujourd'hui que cette dalle est d'époque carolingienne
(vers l'an 771). Le chevalier à droite monte un cheval avec étriers et
selle. Il brandit une épée et un petit bouclier rond en usage à
cette époque : le bocle. |
|

La Dalle des Chevaliers exposée actuellement au musée
de Rhedae à Rennes‑le‑Château |
|
Que serait devenu le roi perdu
Sigisbert IV ?
Officiellement, le mystère est complet, car
aucune piste n'existe. Il est probable que Sigisbert IV
s'il eut existé, serait mort jeune, compte tenu de l'espérance de vie
extrêmement basse à cette époque. Néanmoins, le Prieuré de
SION apporte des réponses qu'il
faut bien sûr interpréter avec prudence et que l'on ne peut
ignorer en toute objectivité.
On peut aussi imaginer que la
Dalle des Chevaliers
trouvée par Saunière et préalablement placée par
Antoine Bigou devant l'autel
cacherait l'entrée
de la crypte sous l'église Marie‑Madeleine et
des sépultures importantes, dont celle de
Sigisbert IV
|
|
200 ans
après la mort de Dagobert II, sa sépulture fut retrouvée
par hasard
sous le chœur de la basilique Saint‑Rémy
de Stenay
où il avait été enterré. Le roi
Charles II le Chauve fit
alors exhumer le corps et le transféra à Douzy pour le
canoniser. Ce sera fait
le 10 septembre 872 par un concile métropolitain
d'évêques.
Dagobert II devint alors pour l'église saint et martyr. Charles II fit
ensuite construire une
plus grande église à Stenay,
la basilique Saint Dagobert. Une châsse d'or et
d'argent fut construite pour y conserver les reliques dont
une partie alla à l'abbaye de Juvigny. |
|
En 1069, le Duc de Lorraine, qui était le
grand‑père de Godefroi de Bouillon, comprit l'importance
spirituelle de la sépulture et fit retourner la dépouille de
Dagobert II à l'église Saint Dagobert à Stenay.
La basilique Saint‑Rémy de Stenay
fait aujourd'hui l'objet d'une fête annuelle le 23 décembre, rendant hommage
au roi perdu. |

Le crâne de Dagobert II
|
|
Mais lors de l'attaque des huguenots à Stenay en
1591,
les reliques furent dispersées. Toutes ? Non, car seul le crâne
supposé de Dagobert II fut mis à l'abri à
Orval.
C'est à la Révolution que le crâne
changea encore de propriétaire. Il fut récupéré par le
couvent des Sœurs Noires à Mons en Belgique et préservé
dans la chapelle Sainte Madeleine. Il faut remarquer sur la
photo une curieuse blessure au sommet du crâne.
Elle est sans doute due à la coutume mérovingienne de la
trépanation.
À la fin du XVe siècle, plusieurs béguines
reçurent de l'évêque de Cambrai, Mgr Henri de Berghes,
l'autorisation de prononcer les trois vœux et d'entrer
en religion. Les sœurs
vivaient déjà en communauté depuis une vingtaine d'années et avaient choisi de suivre la
règle de saint Augustin. Ce sont les Augustines
auxquelles l'évêque impose de porter le scapulaire noir. Ce
vêtement leur vaudra le surnom de "Sœurs Noires". En 1485,
le Pape leur envoya une bulle d'approbation.
Au cours des siècles, les Sœurs Noires
accumulèrent un important patrimoine souvent
désigné "Trésor des Sœurs
Noires". Ce patrimoine fut accumulé par la tradition qu'avaient
les familles aisées d'offrir au couvent une œuvre d'art
lorsqu'une de leurs filles entrait dans la communauté.
En 1910,
Mgr Mangin, curé de Stenay, prit
conscience de l'importance de la relique et promit à ses
fidèles de ramener le crâne à Stenay. C'était sans
compter sur l'intransigeance des sœurs de Mons qui se
réfugièrent derrière leur hiérarchie et refusèrent de livrer la
précieuse relique. Mgr Mangin mourut le 9 septembre 1914
sans aboutir. Le flambeau fut repris en
1962 par
l'abbé Vigneron, curé de
Stenay.
|
|
La légende continue
Poursuivant ses recherches, l'abbé Vigneron
tomba sur un courrier de Mgr Mangin faisant état d'un
curieux manuscrit. Mgr Mangin aurait appris l'existence d'un
parchemin qui appartenait aux moines d'Orval avant la
Révolution et qui se serait trouvé avec le reliquaire avant
d'être transféré à
Mons. Que dit ce parchemin ?
L'écrit signé de
Sainte Irmine,
abbesse d'Oeren en 708,
fille de Dagobert II,
raconte l'assassinat de son père, le refuge de son
frère Sigisbert IV au monastère d'Oeren,
puis le 17 janvier 681 à Rhedae, capitale du Razès.
Voici donc apparaître à nouveau la date fétiche de
Rennes‑le‑Château : "17 janvier" et le fameux nombre
681, que l'on retrouve aussi sur les
pierres tombales de Blanchefort et dans
la phrase découverte sur le
Grand parchemin :
BERGERE PAS DE
TENTATION
QUE POUSSIN TENIERS GARDENT LA CLEF PAX 681
PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU
J'ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI
POMMES BLEUES
Enfin, notons que
Gisèle de Razès, la
seconde femme de Dagobert II, était la nièce d'un roi
wisigoth et originaire du Razès. Voici une autre belle
coïncidence...
|
|
Les Mérovingiens et Rennes‑le‑Château |
|
Quels sont les liens qui unissent les Mérovingiens à
Rennes‑le‑Château et à son énigme ?
 Le petit parchemin
Le petit parchemin
Suite à l'analyse du
petit
parchemin supposé découvert par Saunière,
une phrase énigmatique
cite explicitement Dagobert II :
A DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE
TRESOR
ET IL EST LA MORT
On voit ici que le mot SION peut
prendre plusieurs sens : s'agit‑il du Prieuré de SION ?
De l'évêque de SION qui aida Dagobert II ? De la
fabrique royale de SION
en Suisse ? Notons que Plantard et de Cherisey sont
soupçonnés d'avoir introduit cette phrase dans le
parchemin, une supposition qui n'a jamais été prouvée.
 La Dalle des Chevaliers
La Dalle des Chevaliers
La Dalle des Chevaliers découverte par Saunière
serait d'époque mérovingienne ou wisigothe et le
chevalier semble porter un enfant qui conforte la thèse de Sigisbert IV. En fait, on sait aujourd'hui qu'il s'agit
d'une dalle carolingienne et l'enfant serait plutôt un bouclier.
 Le mariage de Dagobert II avec Gisèle de Razès,
fille d'un comte de Rhedae wisigoth
Le mariage de Dagobert II avec Gisèle de Razès,
fille d'un comte de Rhedae wisigoth
Il est clair que ce mariage est un
lien fort qui unit la destinée mérovingienne avec les
Wisigoths implantés à Rhedae qui n'est autre que Rennes‑le‑Château.
 Une date clé, le 17 janvier 681
Une date clé, le 17 janvier 681
Cette date qui marquerait
l'arrivée supposée de Sigisbert IV à Rennes‑le‑Château est
reprise dans plusieurs indices. On trouve le
17 janvier sur
la
stèle de Blanchefort dans la date
de décès de la
Marquise de Blanchefort, ou sur la stèle de l'abbé Jean VIE dans
l'église de Rennes‑les‑Bains.
On trouve
681 sur
la dalle horizontale ou dans le grand
parchemin avec la phrase
BERGERE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN
TENIERS GARDENT LA CLEF PAX 681
...
 L'église Saint‑Sulpice de Paris
L'église Saint‑Sulpice de Paris
Cette église est un élément clé du
mystère des deux Rennes. Elle est notamment citée dans
le Serpent Rouge.
Elle est aussi associée à
l'église de
Saint Germain des Prés
et fut un lieu de culte mérovingien. Plantard ne manqua
pas d'y d'approfondir son étude que l'on peut découvrir
dans les
dossiers Lobineau.
 Boudet et les Mérovingiens
Boudet et les Mérovingiens
Il est étonnant de voir en prenant
un peu de recul comment l'affaire de Rennes‑le‑Château
conserve une cohérence. Se pourrait‑il qu'il y ait un lien
entre
Henri Boudet, curé de Rennes‑les‑Bains
et les Mérovingiens ? Oui, tout simplement dans son fameux livre "La Vrai
Langue Celtique ou le Cromleck de Rennes‑les‑Bains".
En page
208,
Boudet
ouvre un chapitre sur les rois francs :
|
|
LES PREMIERS ROIS
FRANKS
... Clodion le
Chevelu pénétra fort avant dans la Belgique; sa tête était
ornée de la longue chevelure, signe distinctif de l'autorité
royale chez les Francks, ‑ load (lôd), charge, ‑ high (haï),
il‑lustre, élevé, ‑ to own (ôn), posséder ‑.
L'héritier royal était seul admis à porter les cheveux
longs, et ce fait, bien reconnu et certain d'ailleurs,
devient encore plus manifeste par la composition du nom de
Mérovée, Merowig, le vainqueur d'Attila, ‑mère (mire) seul,
‑ to owe (ô), être obligé de, ‑ wig, chevelure ‑
Lorsque Mérovée mourut, jeune encore, les possessions des
Francks s'étendaient jusqu'à la Seine.
Childéric n'était qu'un enfant, lorsqu'il fut appelé, par
la mort de son père, au commandement de la nation Franke, ‑
child (tchaïld), enfant, ‑ heir (ér) héritier, ‑ wig
(ouigue), chevelure ‑.
Il perdit l'affection et l'estime de son peuple par des
fautes si graves, qu'il fut contraint de s'exiler...
|
|
Il faut remarquer comment
Boudet explique les racines des noms
Clodion, Mérovée, et Childéric en
utilisant la langue celte. Mais son écrit reste hermétique et
seul un lecteur affûté dans l'histoire des Mérovingiens peut s'y
retrouver. Le plus curieux est que Boudet ne fait aucune
allusion à Dagobert II comme s'il procédait par omission
pour attirer l'attention... Une technique déjà éprouvée sur d'autres sujets comme la Pierre dressée des Pontils qui n'est jamais citée
dans son inventaire... |
|
Les Mérovingiens et le Prieuré de SION |
|
Immanquablement, l'affaire de Rennes‑le‑Château
ramène aux Mérovingiens puis au Prieuré de SION.
D'où vient ce lien? La question reste posée. Il est en tout
cas indéniable que le Prieuré de SION a joué un rôle dans la
communication de certains éléments vrai ou faux qui doivent
être versés au dossier. Voici donc quelques éléments de
réponse :
L'origine des Mérovingiens
D'après certains documents du Prieuré,
l'origine des Mérovingiens remonterait à une tribu qui
aurait vécu en
Arcadie située dans une région de la Grèce
(L'Arcadie existe encore aujourd'hui). Ce peuple
serait venu s'installer dans l'Allemagne occidentale en
donnant les Sicambres, ancêtres des Mérovingiens.
L'intégration des Sicambres dans la société romaine ne posa
aucun problème, et lorsque l'Empire romain s'effondra, ils
n'eurent aucune peine à récupérer le pouvoir.
Le pouvoir usurpé
Le
Prieuré de SION n'admet qu'une
seule noblesse pouvant assurer la lignée monarchique,
celle issue d'une descendance wisigothe ou mérovingienne,
sans doute du fait de Sigisbert IV originaire de ces
deux sangs. Les Carolingiens et toutes les lignées royales seraient donc
montés sur le trône de façon illégitime. De plus, l'Église
qui a plusieurs fois trahi le pacte de Clovis s'est rendue
coupable et complice de cette usurpation.
La descendance mérovingienne
Le
Prieuré de SION fournit dans
ses documents de nombreuses indications sur la suite à
donner au fils de Dagobert II
Sauvé par sa sœur,
Sigisbert IV aurait été conduit en
secret sur les terres de sa mère dans le Razès en
681
et aurait pris le surnom de "Plant‑Ard" qui est une allusion au
"Rejeton Ardent" de la lignée mérovingienne. Il serait devenu
ensuite Duc de Razès et
Comte de Rhedae puis
aurait perpétué la lignée.
La lignée se poursuivit
donc avec
Sigisbert V
de
759 à 758. Le Razès était alors en
pleine expansion. Puis vint
Bera III
de
758 à 770,
Guillaume, et
Bera IV
jusqu'en 813 qui fonda
l'abbaye d'Alet‑les‑Bains. Les comtes de Rhedae continuèrent
à se succéder avec Argila
de 813 à 836,
Bera V
de
836 à 860,
Hildéric I
de 860 à 867, et
Sigisbert VI
dit le
prince Ursus
de
867 à 885.
La dynastie fait
apparaître d'autres noms comme
Bernard Plantavelu, Comte de Limoux et père du futur
Duc d'Aquitaine,
Guillem de Gellone en
790, Comte de Razès qui
conquit Barcelone en
803.
Voulant retrouver son trône, le prince Ursus se souleva
contre Louis II
en
881, mais il fut battu à
Poitiers et s'exila avec sa famille en
Bretagne. Ainsi la lignée mérovingienne se poursuivit
parmi les ducs de Bretagne et d'Aquitaine durant le IXe siècle. Il perdit ses terres, mais garda pour l'honneur les
titres de Duc de Razès et Comte de Rhedae.
Si le Prieuré de SION nous donne une version exacte, on peut
affirmer que
Sigisbert IV a redonné un nouvel essor à la dynastie
mérovingienne, celle des rois perdus. Il faut également
remarquer que ce n'est qu'en
1655 que Dagobert II fut
autorisé à apparaître comme roi de France de façon
officielle.
Mais pourquoi tant de mystères? Que cache cette lignée qui a
suscité tant de complots et qu'il fallait à tout prix faire
disparaître?
Toujours selon le
Prieuré de SION, la race mérovingienne a survécu jusqu'à nos
jours et s'est poursuivie par le jeu des alliances
dynastiques et des mariages. C'est ainsi que l'on retrouve
dans cette descendance des grandes familles nobles ou
royales, anciennes ou modernes comme :
Blanchefort, Gisors, Saint‑Clair ou Sinclair, Montesquiou, Montpezat, Poher, Lusignan,
Plantard, Habsbourg‑Lorraine
|
|
Lohengrin ou la légende de Bouillon
|
|
La légende de
Lohengrin que l'on appelle aussi
le Chevalier au cygne conte l'histoire d'un
descendant de la mystérieuse famille du Graal. Cette légende
a été d'ailleurs reprise par Richard Wagner dans un
opéra en 3 actes.
Il était une fois dans le château de Graal, un temple sacré
situé à Munsalvaesche, une chapelle et une cloche. Un jour,
Lohengrin entend sonner cette cloche, mais celle‑ci est
agitée sans l'aide d'aucune main humaine: Une personne de
par le monde appelle à l'aide. Une damoiselle en détresse,
la Duchesse de Brabaut pour certains, la Duchesse de
Bouillon pour d'autres, réclame désespérément de l'aide.
Le chevalier Lohengrin s'élance alors à son secours dans une barque
tirée par des cygnes. Il réussit à vaincre les
agresseurs de la belle duchesse et l'épouse. Mais le jour de
leurs noces, il exige d'elle un serment : celui de ne jamais
l'interroger ni sur ses origines ni sur son passé. Pendant
7 ans, la duchesse respecta son serment, mais un jour,
rongée par la curiosité, elle finit par poser la question
interdite à Lohengrin. Ce dernier la quitte aussitôt et
repart dans sa barque menée par les cygnes puis disparaît
dans le soleil couchant. Il laisse cependant derrière lui un
enfant qui, selon la légende, serait le père ou le
grand‑père de Godefroi de Bouillon.
|
|
Cette légende permit à Godefroi Comte de Bouillon (1061‑1100) de bénéficier d'une extrême
popularité
jusqu'au XVIIe siècle.
N'oublions pas que cette figure
médiévale fut le chef de la première croisade et
prit Jérusalem en
1099.
Or, le plus
intéressant est que d'après le
Prieuré de SION, Godefroi de Bouillon descendrait des mérovingiens. Ceci implique,
toujours selon cette thèse, qu'il serait un descendant
direct de
Dagobert II.
|

The Knight of the holy grail (1912)
de Frederick Judd Waugh
|
|
On pourrait donc
supposer que
Godefroi de Bouillon, à la recherche d'un royaume perdu,
préféra se tourner vers le royaume divin, la Terre sainte,
Jérusalem. Etant le premier croisé à prendre
Jérusalem, sa vengeance était donc complète puisque 400 ans plus tard,
il récupéra le lieu Saint tant convoité par ceux qui trahirent
les Mérovingiens et Dagobert II, les Carolingiens, les
Capétiens, et l'Église... |
|

Ainsi, la lignée mérovingienne
serait un des
fils conducteurs reliant Rennes‑le‑Château,
certaines grandes familles, le
Prieuré de SION, et les
croisades. Que cache cette mystérieuse dynastie qui a
obsédé
certains peintres de la Renaissance ?
Quand on sait
que
Gisors, qui est l'une des grandes familles mérovingiennes
est aussi un château, chef‑lieu des
Templiers rempli de mystères, il devient très difficile d'occulter la piste mérovingienne de l'énigme des deux Rennes...
|
|
|



