|
|
Il existe, parmi les sujets de
recherche
sur Rennes‑le‑Château,
des thèmes récurrents.
Celui concernant les méridiens
revient régulièrement.
À la fois
simple et complexe,
cette notion est de manière évidente
liée à l'énigme. Leurs histoires
touchent aussi
des domaines
comme l'alchimie, l'occultisme
ou les
alignements topographiques.
Surtout, il existe une histoire officielle
qui aurait commencé au
XVIIe siècle
sous Louis XIV,
mais l'étude montre
que le sujet est bien plus complexe
que ce que l'on veut bien
nous faire croire... |
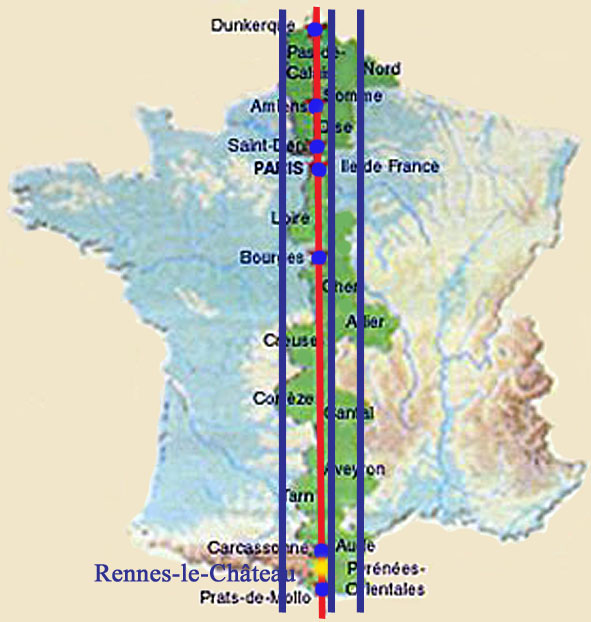
Les méridiens historiques
et occultes de la France |
|
Méridien 0, méridienne verte, méridien de Saint‑Sulpice, de Bourges, méridien de Paris, sont
autant de lignes virtuelles peu connues du grand public. Et pour cause, la communication est particulièrement trompeuse, car tout n'est pas dit.
L'affaire des méridiens, car il s'agit d'une affaire dans l'énigme, touche
la géographie secrète et sacrée de la France, un sujet très peu
médiatisé, mais que
l'accessibilité aux nouveaux outils de cartographie permet de mettre en valeur.
De nombreuses erreurs
perdurent également de façon cyclique, comme croire que
le
méridien 0 traverserait exactement
le
tombeau des Pontils, ou que la cathédrale
de Bourges se trouverait sur le méridien de
l'église Saint‑Sulpice
de Paris. On peut même lire que la petite chapelle abritant la sépulture de
Jean Cocteau serait placée sur ce même méridien, alors
qu'elle est située à plusieurs kilomètres. Ces erreurs colportées par de nombreux auteurs entraînent
inévitablement des confusions difficiles à corriger avec le
temps. Tout ceci favorise une tradition culturelle qui se
propage sous la forme de rumeurs année après année,
sans aucune vérification élémentaire.
Le dossier présenté ici ne se veut ni parfait, ni
exhaustif. Le sujet est bien trop riche. Il essaie
néanmoins de démystifier certains préjugés et de tordre le
cou à des affirmations tenaces. Il n'en demeure pas moins
que l'affaire des méridiens reste remplie de mystères. Mais comme souvent
dans cette énigme,
les anomalies ne sont pas là où on les attend. Ce serait bien trop
simple...

|
|
Le
méridien de Saint‑Sulpice |
|
Le méridien
de Saint Sulpice est né d'un instrument astronomique
particulier, le
gnomon, installé dans
l'église Saint‑Sulpice de Paris.
Il fut construit à la demande de Jean‑Baptiste Languet de Gergy
(1675‑1750), curé saint sulpicien
de 1714 à 1748. Languet de Gergy voulut d'abord établir avec précision le
temps astronomique afin de faire sonner les cloches au
moment le plus opportun dans la journée. Pour cela, il
chargea l'horloger anglais
Henry Sully de
construire le gnomon. Un autre objectif
officiel était de déterminer l'équinoxe de mars et ainsi la
date exacte de la Pâque. En effet, cette fête chrétienne qui
commémore la Résurrection du Christ doit être célébrée
le dimanche suivant la première pleine lune, après l'équinoxe de
printemps, entre le
22 mars et le 25 avril. C'est entre autres pour
cette raison que le méridien prit plus tard un sens ésotérique.
Cette ligne particulière faite de laiton cuivré et que l'on nomme aussi
"Ligne Rose" ou "Rose Line" a donc un rapport
étroit avec la Résurrection de Jésus.
Dans le langage des oiseaux, le
méridien de Paris, du fait de sa couleur cuivrée et rouge, a
donné aussi les noms : "Rousse
Ligne", voire
"Roux Sillon"
(Languedoc
Roussillon).
Le nom "Rose ligne" amène aussi à
Roseline
qui est le prénom de
Sainte Roseline, fêtée
le
17 janvier en même temps que la fête de
Saint‑Sulpice. |
|
La particularité du
gnomon
de Saint‑Sulpice est qu'il
mesure la hauteur du soleil à midi en projetant sur le sol,
puis sur un obélisque, l'image du Soleil. Chaque jour
ensoleillé, un cercle de lumière apparaît donc à midi sur
cette bande de laiton et s'étale au fil des jours sur toute
la longueur du transept.
La ligne est donc très précisément orientée
Nord‑sud symbolisant le
méridien en ce lieu.
A ne pas confondre avec un
autre ancien méridien, celui de l'Observatoire de Paris
qui est l'ancien méridien de Paris (aussi appelé Méridien 0).
La Ligne Rose de Saint‑Sulpice
passe par la croisée du transept et correspond au méridien
de longitude :
2° 20' 05.49"
E
|

Le méridien et le gnomon au fond
|
|
Le gnomon est constitué de
deux œilletons, l'un à 25,98 m du sol, d'un pouce de
diamètre qui était utilisé vers le solstice d'hiver et les
équinoxes. L'autre installé à 24,36 m de hauteur
comportait une lentille convergente de 80 pieds de foyer qui
permettait d'étudier la tache de lumière pratiquement sans
pénombre au solstice d'été.
La
lumière du Soleil passe à travers une petite
ouverture de section circulaire disposée dans le
vitrail sud du transept, à une hauteur de 25 m,
formant sur le sol une petite tache de lumière
elliptique qui croise la ligne méridienne chaque fois
que le
Soleil culmine à
midi vrai.
Le soleil croise différentes parties du méridien selon
l'époque de l'année, en fonction de sa hauteur dans le
ciel à midi. Sur la ligne méridienne figure un disque «
d'or » qui localise la position du soleil aux
équinoxes. Il est situé juste en face de l'autel.
À l'extrémité sud de la ligne méridienne se trouve une
plaque carrée en marbre, qui correspond à la position du
Soleil au plus haut à midi (64° 35′ à l'emplacement de
Saint‑Sulpice), le jour du
solstice d'été, vers le
21 juin.
À l'autre extrémité de la ligne méridienne se trouve un
obélisque, qui est éclairé près de son sommet
lorsque le Soleil est au plus bas à midi (17° 42′ à
l'emplacement de Saint‑Sulpice), le jour du
solstice d'hiver. Si l'obélisque n'existait pas,
l'image solaire frapperait le sol horizontal dans une
zone située à 20 m environ au‑delà du mur de
l'église.
|
|
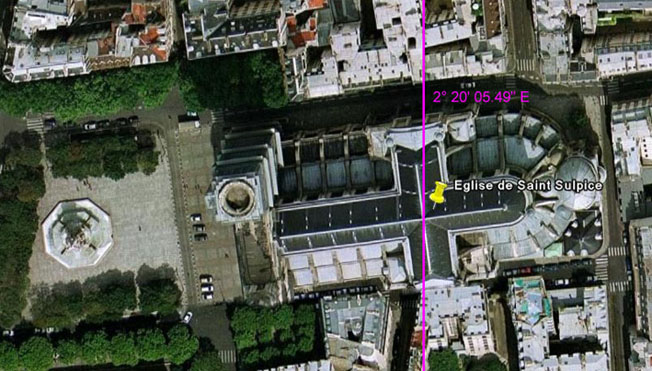
La croisée du Transept est située
à 48° 51' 03.28" N et
2° 20'
05.49" E
et définit la Ligne Rose qui est le méridien de Saint‑Sulpice |
|
Saint‑Sulpice
et Paris, deux méridiens,
deux objectifs différents...
Le
méridien de Saint‑Sulpice et celui
de
Paris sont très proches (environ 300 m) et c'est sans
doute
la raison pour laquelle ces deux lignes sont souvent confondues. Pourtant
d'un point de vue scientifique, leurs fonctions ont été très
différentes.
 A l'église de
Saint‑Sulpice, l'objectif était de connaître très précisément
l'heure solaire et donc l'instant du midi en un point
géographique précis. D'autres églises utilisent
ce procédé. A l'église de
Saint‑Sulpice, l'objectif était de connaître très précisément
l'heure solaire et donc l'instant du midi en un point
géographique précis. D'autres églises utilisent
ce procédé.
 Le
méridien de Paris servit par contre à tirer une ligne puis un tracé
géométrique sur toute la France. Les résultats de ces travaux
furent importants puisque le rayon de courbure de la Terre une fois mesuré permit de définir le
mètre étalon. Le
méridien de Paris servit par contre à tirer une ligne puis un tracé
géométrique sur toute la France. Les résultats de ces travaux
furent importants puisque le rayon de courbure de la Terre une fois mesuré permit de définir le
mètre étalon. |
|
En résumé, le méridien (le gnomon)
de Saint‑Sulpice donne l'heure de midi et le méridien de
l'Observatoire de Paris offre un référentiel géographique (méridien 0).
Le méridien de
Saint‑Sulpice n'est pas très éloigné du
méridien de l'Observatoire de Paris
Ils sont en fait
écartés
d'environ
300 m |
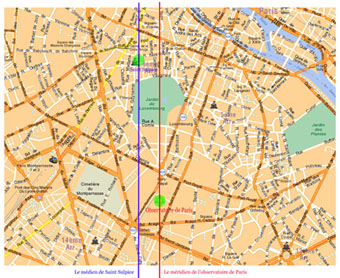 |
|
Il existe un autre
méridien que l'on confond souvent avec celui de
Saint‑Sulpice
ou avec celui de l'Observatoire de Paris.
C'est celui qui
passe par la cathédrale de Bourges. Il est vrai que cette
méridienne a aussi de quoi étonner. Non seulement elle est
aussi matérialisée par une bande de cuivre, mais elle est
proche de la Ligne Rose de Saint‑Sulpice (4908 m) et donc
du Méridien de Paris.
Une autre
particularité est que Bourges est liée à
l'église Saint‑Sulpice puisque
Saint Sulpicius
était archevêque de
Bourges au
VIe
siècle. Il mourut le
17 janvier
647, jour de l'année hautement
symbolique dans l'affaire de Rennes...
Ajoutons aussi que Bourges,
ancienne capitale,
est considérée comme la ville du centre de la France (le cœur de France) et qu'elle
fut réputée pour avoir hébergé un alchimiste célèbre
Jacques
Cœur. |
|

La cathédrale de Bourges a aussi sa ligne
méridienne |
|
Contrairement au gnomon
de Saint‑Sulpice destiné à mesurer la date exacte de Pâque,
le méridien de Bourges date de
1757
et servit de cadran solaire.
Les méridiennes
présentes dans de nombreuses églises des villes ou des villages
d’Europe permettaient de donner l’heure locale du
midi solaire. La nécessité d’une heure de midi commune ne se fit
sentir qu’après l’essor des horloges mécaniques. La précision
des horloges des églises se faisait alors au moyen de ces
méridiennes. |
|

Le méridien de Saint Sulpice (en rose) est
distant de 4908m de
celui de la cathédrale de Bourges (en bleu) |
|
Les méridiens et l'énigme du Razès |
|
Pourquoi les méridiens sont si importants
dans
l'affaire de Rennes‑le‑Château ?
La notion de méridien est une constante. On la retrouve dans
différents indices et elle a un
objectif : servir de référence et de repère géographique.
C'est aussi un moyen virtuel de relier Paris au Razès
comme s'il fallait montrer par des lignes virtuelles que ces
deux régions sont intimement liées.
 Le méridien est sous‑entendu dans la phrase clef issue du grand
parchemin :
Le méridien est sous‑entendu dans la phrase clef issue du grand
parchemin :
|
BERGÈRE PAS DE TENTATION
QUE POUSSIN TENIERS GARDENT LA CLEF
PAX DCLXXXI
PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU
J'ACHÈVE CE DAEMON DE GARDIEN
A MIDI POMMES BLEUES
|
Le midi solaire a ceci de particulier
que le soleil est à son zénith, c'est‑à‑dire qu'il se
trouve sur le méridien d'observation.
 Le méridien de
l'église Saint‑Sulpice de Paris
est encadré par les deux tableaux de
Signol
au N
inversé.
Le méridien de
l'église Saint‑Sulpice de Paris
est encadré par les deux tableaux de
Signol
au N
inversé.
 Le concept de méridien est cité deux fois dans
le
Serpent Rouge :
Le concept de méridien est cité deux fois dans
le
Serpent Rouge :
|
Rassembler les pierres éparses,
œuvrer de l'équerre et du compas pour les remettre
en ordre régulier, chercher
la ligne du
méridien en allant de l'Orient à l'Occident,
puis regardant du Midi au Nord, enfin en tous sens
pour obtenir la solution cherchée, |
|
Vision céleste pour celui qui me
souvient des quatre œuvres de Em. SIGNOL autour de
la ligne du
Méridien, au chœur même du sanctuaire d'où
rayonne cette source d'amour des uns pour les
autres, je pivote sur moi‑même passant du regard la
rose du P à celle de l'S, puis de l'S au P... |
Il faut d'ailleurs noter que l'un des
méridiens, celui qu'il faut chercher, commence par une
minuscule et que le Méridien de Saint‑Sulpice est noté avec
une majuscule. Ceci prouve qu'il y a au moins
deux
méridiens importants.
 Le méridien est cité dans
la
dalle de Coume Sourde. Sur le
côté face de la pierre, on peut lire : IN MEDIO LINEA UBI M SECAT LINEA
PARVAT
Le méridien est cité dans
la
dalle de Coume Sourde. Sur le
côté face de la pierre, on peut lire : IN MEDIO LINEA UBI M SECAT LINEA
PARVAT
Ce qui peut se traduire par :
AU MILIEU DE LA LIGNE OU M (Méridien)
COUPE LA PETITE LIGNE
 Les méridiens de Saint‑Sulpice et de l'ancien Observatoire de
Paris traversent le Razès non loin du
tombeau des Pontils
et de la
bergerie Paris.
Les méridiens de Saint‑Sulpice et de l'ancien Observatoire de
Paris traversent le Razès non loin du
tombeau des Pontils
et de la
bergerie Paris.
 Henri Boudet
en parle de façon détournée en parlant de
l'Observatoire de Paris
Henri Boudet
en parle de façon détournée en parlant de
l'Observatoire de Paris
 De façon très discrète,
les Bergers d'Arcadie II
de
Poussin
semblent liés au
méridien de Paris
De façon très discrète,
les Bergers d'Arcadie II
de
Poussin
semblent liés au
méridien de Paris |
|
Les
méridiens et le Serpent Rouge |
|
Aussi bien le méridien de Saint‑Sulpice que celui de
l'Observatoire,
tous deux possèdent des liens avec l'affaire de Rennes et
c'est pour cela qu'ils sont souvent confondus. En fait il
semble que les deux lignes soient importantes et
le
Serpent Rouge le confirme puisqu'il nous
amène très clairement sur le méridien de Saint‑Sulpice tout
en finissant par une allusion à
Charles Perrault, le
frère de l'architecte de l'Observatoire.
Le méridien est une pièce
fondamentale dans le puzzle de Rennes‑le‑Château. Pour s'en
convaincre il suffit de lire le Serpent Rouge à la
strophe 5 :
|
Rassembler
les pierres éparses, œuvrer de l'équerre et du
compas pour les remettre en ordre régulier,
chercher la
ligne du méridien en allant de l'Orient à
l'Occident, puis regardant du Midi au Nord,
enfin en tous sens pour obtenir la solution
cherchée, faisant station devant les quatorze
pierres marquées d'une croix. Le cercle étant
l'anneau et couronne, et lui le diadème de cette
REINE du Castel |
Où à la
strophe 9 :
|
Commencé
dans les ténèbres, mon voyage ne pouvait
s'achever qu'en Lumière. A la fenêtre de la
maison ruinée, je contemplais à travers les
arbres dépouillés par l'automne le sommet de la
montagne. La croix de crète se détachait
sous le soleil
du midi, elle était la quatorzième et la
plus grande de toutes avec ses 35 centimètres!
Me voici donc à mon tour cavalier sur le
coursier divin chevauchant l'abîme. |
Mais aussi à la
strophe 10 :
|
Vision
céleste pour celui qui me souvient des quatre
œuvres de Em. SIGNOL
autour de la
ligne du Méridien, au chœur même du
sanctuaire d'où rayonne cette source d'amour des
uns pour les autres, je pivote sur moi‑même
passant du regard la rose du P à celle de l'S,
puis de l'S au P... |
|
|
Le
Méridien de Paris et Boudet |
Il faut lire et relire
Boudet et
sa
Vraie Langue Celtique pour s'apercevoir
combien son livre jongle avec les concepts. Car il faut un sacré
tour de force pour arriver à citer l'Observatoire de Paris
en parlant du Cromleck de Rennes‑les‑Bains, le tout sans
éveiller l'attention sur ce fameux méridien de Paris.
On peut ainsi apprécier en page 268 :
|
[...] Les fontaines
enfermées dans l'enceinte du Cromleck sont fort
nombreuses : trois sont thermales à des degrés
divers de température. La source dite du Bain‑Fort,
possède une température de + 51 degrés centigrades,
tandis que les deux autres, dites de la Reine et du
Bain‑Doux, atteignent + 41 et + 40 degrés
centigrades.
Il est facile d'apprécier la profondeur
extrême du siphon amenant à la surface du sol cette
eau minéralisée et élevée à ces degrés de chaleur.
On sait généralement que la température varie d'une
manière fort sensible dans l'intérieur de la terre,
suivant les différentes profondeurs auxquelles on
peut atteindre. En prenant pour point de départ les
caves de
l'Observatoire
de Paris, qui sont à vingt‑huit mètres
au‑dessous du sol, et où le thermomètre marque
constamment + 11 degrés centigrades, on trouve en
moyenne un degré de plus de chaleur pour chaque
trente mètres de profondeur, en pénétrant plus avant
dans l'intérieur de la terre. L'eau du Bain‑Fort
marquant + 51 degrés centigrades, qui se réduisent à
40, puisqu'il faut retrancher les onze degrés
constants marqués par le thermomètre à vingt‑huit
mètres au‑dessous du sol, dans les caves de
l'Observatoire de Paris, le point de
profondeur extrême du siphon serait à peu près à
douze cent trente mètres, abstraction faite
cependant de toute déperdition de chaleur produite
par des causes secondaires et accidentelles. Quant
aux sources de la Reine et du Bain‑Doux, leur degré
de température accuserait neuf cent trente et neuf
cents mètres de profondeur. [...]
Extrait de "La vraie
langue celtique" |
Quel étrange calcul, car il y a une sévère erreur de
raisonnement. Si on considère que la température de l'eau du "Bain‑Fort"
est de 51° à la surface, comment peut‑elle être de 40°
à 28m
de profondeur ? Car selon Boudet il faut retrancher 11°
puisque c'est la température constante à 28m. Ce
raisonnement voudrait dire que l'eau se réchauffe en remontant
puisqu'elle aurait 40° à 28m de profondeur puis 51° à sa
surface...
Ces déductions
absurdes continuent puisqu'à partir de la notion de 1° de
plus par 30 m de profondeur Boudet trouve une source à
1230 m. Comment peut‑il arriver à un pareil calcul en
partant de 40° à 28 m et en ajoutant 1°
tous les 30 m. La connaissance de 1230 m ne peut
se déduire que si l'on connaît la température de l'eau à sa
source... Le calcul qu'il fait est en fait 41 x 30 =
1230 m comme si l'eau démarrait à 0° et se réchauffait en
remontant, en prenant 1° tous les 30 m...
En fait, comme d'habitude,
Boudet fait ici une erreur très grossière pour nous alerter. Car
si on observe son style, certains nombres sont en chiffre et
d'autres sont en lettres. L'objectif est bien sûr de concentrer
le lecteur vers ces 4
nombres
51, 41, 40 et 11
qui doivent avoir une seconde signification. Il faut dire que
cette suite possède des propriétés étonnantes :
Serait‑ce un hasard de la
numérologie ? Si on aligne les chiffres
51 41 40 11 et
qu'on les additionne on obtient
17 un nombre bien connu de l'énigme :
5
+ 1 + 4 + 1 + 4 + 0 + 1 + 1 = 17
(Nombre remarquable) |
|
Rappelons aussi que ces trois températures sont retrouvées
dans une suite de chiffres romains au bas de
la dalle de Blanchefort puisqu'en formant les groupes : LI XLI XL
on obtient les nombres : 51, 41, 40 |
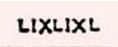 |
|
D'autre part, en réorganisant les chiffres et en effectuant la
somme des couples on a :
51, 44, 01
ce qui
donne : 5+1, 4+4, 0+1 d'où
681 ...
Il est clair que derrière
ces jeux de chiffres, Boudet
veut nous faire comprendre l'importance toute particulière du
Méridien de Paris, le méridien 0 qu'il faut associer à 681. |
Pour
comprendre pourquoi
les frères Perrault sont importants dans l'affaire de
Rennes, il suffit de lire la dernière strophe du
Serpent
Rouge car rien n'y est
cité au hasard : |
|
Mon émotion fut grande,
"RETIRE MOI DE LA BOUE" disais‑je, et mon réveil fut immédiat.
J'ai omis de vous dire en effet que c'était un songe que j'avais
fait ce 17 JANVIER, fête de Saint SULPICE. Par la suite mon
trouble persistant, j'ai voulu après réflexions d'usage vous le
relater un conte de
PERRAULT. Voici donc Ami Lecteur, dans les pages qui
suivent le résultat d'un rêve m'ayant bercé dans le monde de
l'étrange à l'inconnu. A celui qui PASSE de FAIRE LE BIEN ! |
|
Cette allusion au conteur
Charles Perrault est bien sûr destinée à attirer la
curiosité du lecteur sur ce personnage et surtout sur son frère,
Claude Perrault, architecte de l'Observatoire et donc du
méridien de Paris.
|
|
Qui était Charles Perrault ?
Charles Perrault (1628‑1703)
est le septième enfant d'une famille aisée de quatre frères. Il
fit des études de droit et après une première œuvre burlesque,
"Les Murs de Troie"', il entra en
1654 comme commis chez
son frère aîné Pierre Perrault, receveur général des
finances de Paris. Il fut alors remarqué par ses poèmes "les
Odes au Roi". Nommé commis auprès de
Colbert en
1663
puis conseiller de Louis XIV, il devint Premier commis
des bâtiments du Roi en 1665. En
1671 il entra à
l'Académie française et s'opposa à Boileau dans la célèbre
querelle des Anciens (à leurs têtes Boileau, partisans des
auteurs antiques) contre les Modernes en
1687. Chancelier
de l'Académie, il devint bibliothécaire en
1673. |

Charles Perrault (1628‑1703) |
|
Sa
célébrité tient aujourd'hui de
ses contes de la Mère l'Oye
(1697)
inspirés de l'imaginaire médiéval légendaire et chevaleresque.
L'art de Charles Perrault est d'avoir su reprendre dans
une prose faussement naïve des histoires transmises
traditionnellement par voie orale et intégrées dans
l'inconscient collectif. Il
transforma le conte populaire en réalisant un chef‑d'œuvre de
la littérature universelle et il sauva de l'oubli huit récits
traditionnels, aujourd'hui incontournables comme Cendrillon, le
petit Poucet, le petit Chaperon rouge, le Chat botté, etc...
Il
est aussi très intéressant de noter à partir de sa biographie,
les rapports étroits qu'il eut très probablement avec le
pouvoir, les finances royales et
Colbert. Il suivit très
certainement de près
l'affaire d'État du Surintendant des
finances Nicolas Fouquet
que l'on sait aujourd'hui fortement impliquée dans l'affaire
de Rennes. Était‑il dans quelques confidences de
Colbert
ou de
Fouquet, confidences qu'il sut
transmettre à son frère
Claude Perrault ? |
|
Qui était
Claude Perrault ?
Claude Perrault (1613‑1688)
naquit à Paris et fut le troisième
fils d'une famille bourgeoise.
Deux frères suivront, Nicolas et Charles, mais les
frères Perrault, Claude et Charles, demeureront très liés
toute leur vie durant.
Claude Perrault était un ingénieur
infatigable. Il étudia d’abord la médecine à la Faculté de
Paris. Docteur en
1641, il exerça pendant près de 25 ans. Parallèlement,
Colbert créa l'Académie des Sciences à la fin de l'année
1666.
|

Claude Perrault (1613‑1688) |
|
Or, à cette époque, Charles Perrault
était le commis de
Colbert et ses fonctions l'amenaient à gérer tout ce qui
concerne l'Art et les sciences. Il
put ainsi introduire son frère
Claude, scientifique passionné, dans ce petit monde
d'intellectuels proche de Louis XIV.
Finalement,
Claude et Charles Perrault feront tous deux leur carrière au service
de Colbert et du Roi.
Claude Perrault se rapprocha de savants célèbres comme
Huygens, Roberval (mathématicien), ou Pecquet (médecin). Cet
environnement le dynamisa, portant son intérêt sur
l'Histoire naturelle, mais aussi sur la physiologie animale et
humaine, la physique et l’art des machines.
Il entra à l'Académie des
sciences et du Conseil des bâtiments en 1673 et fut
chargé par Colbert de traduire "De architectura de Vitruve".
Cette étude donnera naissance à un nouveau traité célèbre.
Il publia ensuite en 1683 "L'Ordonnance
des 5 espèces de colonnes selon la méthode des anciens" provoquant une grande polémique.
On lui doit avec l'aide de
Charles Le brun et
Louis Le Vau, la colonnade de la façade orientale du
Louvre,
les plans de l'Observatoire de Paris (1667‑1766), le Château de Sceau, et
l'Arc de triomphe du faubourg Saint‑Antoine qui sera
abandonné. Claude Perrault proposa même une reconstitution du
Temple de Jérusalem.
A la
fois médecin de profession, anatomiste, savant et architecte, le
scientifique décédera d'une infection en 1688 à Paris
après avoir disséqué un chameau au Jardin des Plantes.
|
|

Mansart et Claude Perrault à droite ‑ par
Philippe de Champaigne 1656 |
|
La Vierge de l'Observatoire |
Il existe de nombreuses rumeurs sur la découverte d'une
petite chapelle sous l'Observatoire de Paris. Cette chapelle
aurait abrité une statuette, une Vierge que l'on appelle aussi :
"Nostre
Dame de dessous terre".
Ces propos viendraient de Claude Perrault
lui‑même dans un rapport qu'il envoya au cabinet du Roi lors de
la construction des fondations du bâtiment. Il aurait même
évoqué le terme de "caveau illustre".
Une autre source nous
dit que c'est Camille Flammarion qui découvrit
également cette
statuette, et cette affirmation peut se lire dans :
" Le
mystère des cathédrales "
de
Fulcanelli.
Voici ce qu'il écrit... |
 |
"Nous
contemplâmes, à notre tour, la petite Nostre‑dame
dessous terre, symbole de la pierre brute du Grand
art, lors d'une mémorable exploration des
souterrains, au mois de juillet 1936, en compagnie
de trois excellents amis et d'un fonctionnaire à qui
nous dûmes cette exceptionnelle faveur. Que tous
quatre, ici, soient derechef et Chaleureusement
remerciés."
Extrait " Le mystère des cathédrales " de Fulcanelli |
Comme dans toute légende ou rumeur, il faut aussi se tourner vers
l'Histoire officielle. L'Observatoire fut construit sur
des catacombes et les fondations furent noyées dans les
tunnels souterrains. Or, il existe un plan des caves
élaboré lors des travaux et indiquant l'emplacement
exacte d'une Vierge. La statuette est aujourd'hui
exposée à l'Observatoire.
Claude Perrault aurait‑il trouvé une petite chapelle avec cette
statuette ? C'est fort possible. Les terrains appartenaient à
certaines congrégations religieuses qui auraient pu parfaitement
utiliser les galeries souterraines comme chapelle et ossuaire.
Pourquoi alors tant de mystères autour d'une découverte qui
finalement semble banale ? Fallait‑il que Claude
Perrault justifie l'importance de ce Méridien posé
exactement à l'endroit de la Vierge ? Avait‑il
peur que l'on déplace cette ligne de référence ? |

Notre Dame de dessous terre
Observatoire de Paris |
|
En lisant Fulcanelli,
tout se passe
comme si le Méridien de Paris devait être à cet endroit et pas
ailleurs. La découverte d'une Vierge sous
l'Observatoire n'aurait donc été qu'un moyen de justifier une fois
pour toutes la position de la ligne imaginaire.
Il est vrai qu'à cette époque un autre
méridien était en concurrence, celui de l'église Saint‑Sulpice
de Paris... |
|
Les plans de l'observatoire qui sont
l’œuvre de Claude Perrault, frère de
Charles Perrault, auteur des contes de « Ma Mère l’Oye » porte aussi une symbolique
très forte. Il faut rappeler que les deux frères sont affiliés à une société secrète « Angélique » et aussi à la première loge
maçonnique pionnière « Les Chevaliers Errants ». Ils ont aussi une vénération pour le
21 juin, date la plus fréquente du
solstice d'été, et utilisent ce jour pour déposer soit un recueil de conte, soit une étude. Le 21 juin est aussi le jour où les
repères sont pris sur le terrain pour la construction de l'Observatoire. L’ensemble des bâtiments respecte la règle du célèbre Nombre
d’Or, en clair tout participe à une symbolique ésotérique très appuyée tournée vers les rythmes solaires. L'Observatoire est en
réalité un temple qui de plus eut les faveurs de Louis XIV. Il est vrai que le Roi soleil est la représentation incarnée d’Apollon
dans toute sa lumineuse splendeur... |
|
Le puits zénithal, un lieu sacré
il
semble que le lieu voulu pour l’implantation de l’Observatoire soit plus pour son sous‑sol que pour l’espace en surface utile aux
observations et aux calculs stellaires et solaires. Le sous‑sol choisi est celui de très anciennes carrières, aménagées en catacombes
et en une véritable citadelle souterraine aux labyrinthes multiples, bien connues à l’époque par des initiés de différentes tendances
ésotériques.
Perrault tenait à ce que l’édifice majeur
soit axé sur son puits zénithal et non l’inverse. Il y eut aussi de bien curieuses consolidations des sous‑sols et un rapport royal de
l’époque (de C. Perrault au Cabinet privé du Roi ‑A.R. Pierre Coute N’ 678‑orc 71) fait mention de découvertes de cours d’eau
souterrains, de ramifications profondes et de caveaux illustres dont les issues furent terrassées et d’autres soigneusement
dissimulées pour des raisons de travaux ultérieurs
Autre information : il était clairement
noté (doc. R.B.R. Fn XXXII) la formule suivante « l’endigue profond du ru
SAYX (anagramme
de AXYS ou AXIS... AXE) à présent sous machinerie ». Le mystère continue avec une liste
exhaustive d’objets remontés pour les collections royales lors de ces travaux souterrains. Plus insolite encore, il est établi une
seconde liste concernant des objets, mobiliers et écritures qui furent « rangés et enfouis » sous les fondations... et de plus par
volonté royale ! Une des trois copies de ce royal et insolite document est encore partiellement lisible aujourd’hui. Perrault explique
à un certain « Sire Ulisse Charde et ses frères » l’utilité historique de bâtir autour du puits zénithal afin de conserver intact
l’accès à la cavité souterraine qui sera connue sous le nom de « Nostre Dame Soubsterre ».
Le lieu noté «
antyque Chaspel »
était accessible par des escaliers à vis et on pouvait y contempler une petite
Vierge retrouvée lors des travaux. La
découverte dut choquer, car on affirmera plus tard que ce sont les constructeurs du lieu qui la commandèrent en terre cuite et la
déposèrent dans un réduit au niveau des souterrains de l’observatoire. Certains grands alchimistes considérèrent cette crypte comme
seule capable d'offrir les moments propices aux différentes phases du Grand Œuvre, un lieu connu sous le vocable de « Pierre brute
du Grand Art ». On peut aussi lire (doc R.B.R) que deux ans auparavant, le site souterrain qui deviendra celui de l’Observatoire
Royal aurait reçu de prestigieux visiteurs, curieux, et savants, parmi lesquels messieurs Reynaud Levieux,
Nicolas Poussin et des notables religieux.
La profondeur du puits zénithal fut fixée à
28 mètres et la hauteur du bâtiment à
27 mètres, ce qui donne une hauteur totale de
55 mètres. L’utilité première
prévue pour l’observation stellaire fut rapidement délaissée, et ce ne sera qu’en
1851 que Foucault réalisera sa seconde
expérience du pendule rendue célèbre par Umberto Eco. Puis ce sera pour
Foucault, en
1862, la première détermination de
la vitesse de la lumière.
Le lieu de l'Observatoire semble
décidément hautement symbolique et plusieurs sociétés plus hermétiques que savantes, connues un peu plus tard sous le nom de
« Sociétés du Brouillard » ne manquèrent pas de sacraliser l'endroit... |
|
La
famille Cassini
est incontestablement liée à l'histoire de
L'Observatoire
Royal. Tout commença lorsque
Colbert
fit venir du comté de Nice un scientifique encore inconnu :
Jean‑Dominique Cassini
(1625‑1712).
Louis XIV lui confiera
immédiatement la responsabilité de l’Observatoire. Ce sera aussi le
début d’une véritable dynastie
qui gérera l'Observatoire durant plus de
120 ans,
de 1667
jusqu'à la Révolution.
4 générations de
Cassini se succédèrent jusqu'en
1793.
L'observatoire de Paris fut placé dès ses débuts sous la tutelle
de l'Académie des sciences. Il n'y eut donc aucune fonction
officielle de Directeur ni aucun budget alloué. Les astronomes
qui désiraient travailler ou venir faire des observations
devaient apporter leurs propres matériels ou solliciter des
aides provenant soit de l'Académie, soit du Roi, soit d'un
mécène. Il faut attendre 1771 pour que
Louis XV attribue officiellement à Cassini de Thury
(Cassini III) le poste de Directeur de l'Observatoire.
Les Cassini apportèrent
énormément dans la recherche astronomique et géodésique. Depuis
sa fondation, l'Observatoire servit d'habitat à cette famille qui travaillait sur place avec
une petite équipe de scientifiques très choisis.
Dans l'ordre chronologique, on
trouve :
 Jean‑Dominique Cassini
(Cassini I) :
De
1669 à
1712 il travailla avec de
grands astronomes comme
Huygens
ou
Roëmer.
L'abbé Jean Picard
y effectua une mesure du degré terrestre faisant naître une
nouvelle science :
la
géodésie.
Jean‑Dominique Cassini
(Cassini I) :
De
1669 à
1712 il travailla avec de
grands astronomes comme
Huygens
ou
Roëmer.
L'abbé Jean Picard
y effectua une mesure du degré terrestre faisant naître une
nouvelle science :
la
géodésie.
 Jacques Cassini
(Cassini
II) :
Son fils prend la suite de
1712 à
1756. L'Observatoire est
alors dirigé par l'Académie des sciences et son Directeur
règne en maître.
On lui doit des travaux sur la figure de
la Terre.
Jacques Cassini
(Cassini
II) :
Son fils prend la suite de
1712 à
1756. L'Observatoire est
alors dirigé par l'Académie des sciences et son Directeur
règne en maître.
On lui doit des travaux sur la figure de
la Terre.
 César‑François Cassini
(Cassini III
aussi appelé
Cassini de Thury) :
Le petit fils prend la direction de
1756
à
1784.
C'est l'époque des recherches cartographiques. Il
dressera la célèbre carte du royaume de France à l’échelle du
1/86400°
César‑François Cassini
(Cassini III
aussi appelé
Cassini de Thury) :
Le petit fils prend la direction de
1756
à
1784.
C'est l'époque des recherches cartographiques. Il
dressera la célèbre carte du royaume de France à l’échelle du
1/86400°
 Jean‑Dominique, comte de Cassini
(Cassini IV) :
L'arrière‑petit‑fils subit la Révolution française
et dirigea l'Observatoire à partir de
1784.
Il
terminera les travaux
cartographiques de la France, mais étant
monarchiste,
il démissionnera en
1793.
Jean‑Dominique, comte de Cassini
(Cassini IV) :
L'arrière‑petit‑fils subit la Révolution française
et dirigea l'Observatoire à partir de
1784.
Il
terminera les travaux
cartographiques de la France, mais étant
monarchiste,
il démissionnera en
1793.
La branche française de la famille Cassini
s'éteindra finalement avec la disparition du dernier des 5
enfants, Alexandre Henri‑Gabriel,
vicomte de Cassini (1781‑1832), juriste et botaniste. |
|
Jean Dominique Cassini
(1625‑1712)
Il
fut un astronome d'exception et contribua au
développement de cette science en matière d'instrumentation et
d'observations.
Grâce aux
expériences faites sur la méridienne, il étudia la réfraction
atmosphérique et les éphémérides solaires. Cassini travailla
également sur la mesure de la parallaxe du Soleil afin de
trouver les dimensions exactes du système solaire.
Dès
1663,
Colbert
démontra au Roi de France l’urgence d’établir « des cartes
géographiques de la France plus exactes que celles qui ont été
faites jusqu’ici ». |

Jean Dominique Cassini (1625‑1712) |
|
Un fait qui pourrait
avoir toute son importance dans l'énigme, Jean‑Dominique Cassini fut, de par sa fonction de géographe du Roi, en
1681 près de
Rennes‑les‑Bains, très exactement sur le
col de la Sals, pour calculer le point de passage du méridien 0.
En
1696, Cassini est à Paris et malgré son âge avancé, il se
lance dans la réalisation de cette œuvre colossale commandée par Louis XIV :
"la Carte de la France". Il sera aidé de quelques
collaborateurs comme son fils Jacques et son neveu Giacomo
Filippo Maraldi.
La réalisation de cette carte sera exécutée et terminée par ses descendants, son
fils Jacques (Cassini II), son petit‑fils, César‑François
(Cassini III) et Jean Dominique (Cassini IV). La carte sera
finalement présentée par ce dernier devant la Constituante en
1790. Le document comprend 182 planches et représente
132 ans de travail ininterrompu.
Pour accomplir ce résultat, il fallut parcourir tout le territoire en prenant des mesures et des visées basées sur la méthode de
triangulation. La moindre erreur était fatale et pouvait engendrer des erreurs difficiles à corriger.
À la fin de sa vie, Jean‑Dominique Cassini
est aveugle, mais il écrit malgré tout ses mémoires qui seront
publiées en 1710. Il meurt à Paris le 14 septembre
1712, à 87 ans. Il est enterré dans l’église
Saint‑Jacques du Haut Pas, avec cette seule épitaphe :
“ Jean Dominique Cassini ‑ Astronome ”.
On retiendra des Cassini
la première carte de France
fidèle à la réalité, mais aussi des zones d'ombres accompagnant plusieurs mystères.
|
|
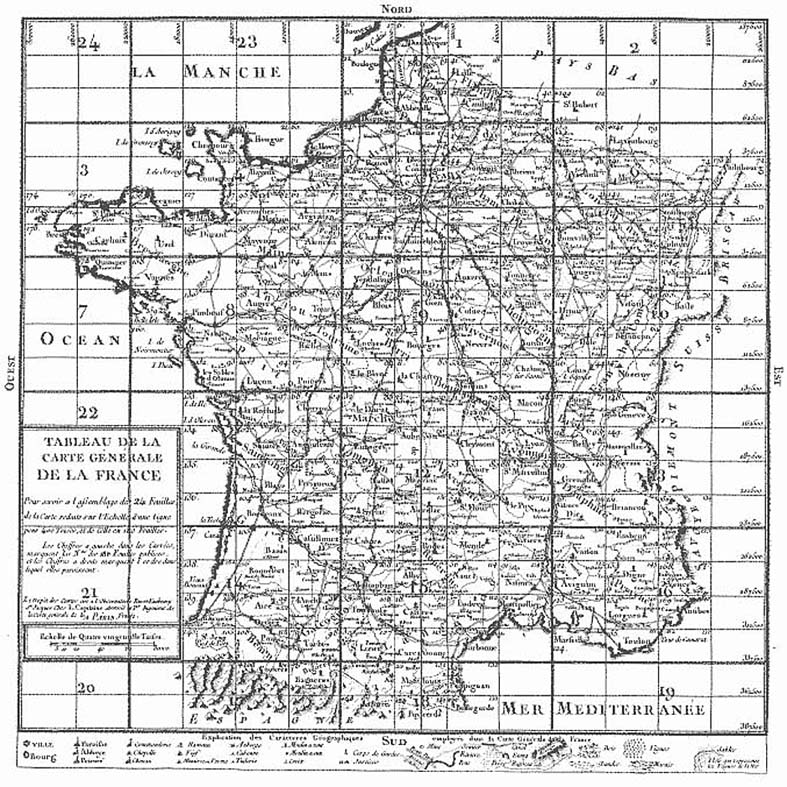
La carte de Cassini générale découpée en
182 planches |
|
Encore des mystères ?
Derrière
cette dynastie de scientifiques se cache un secret. Il faut
d'abord savoir que les
4 Directeurs successifs furent membres de l'Angélique,
une société secrète dans laquelle ils occupèrent des fonctions
importantes de maîtrise (Archives Angéliques ‑ Barret
et Mitlot 1825 éd. Colonnes)
Mais ce n'est pas tout. Durant leur
dynastie, ils écrivirent des documents très particuliers et
personnels, dans lesquels on pouvait trouver des détails sur
leurs travaux de cartographie et notamment autour du Méridien de
Paris. Ces documents qui ne furent jamais publiés (il y sans doute des raisons à cela) sont appelés
"Cahiers Méridiens". Surtout, il est
intéressant de lire dans leurs notes que les
Cassini attachaient
une importance toute particulière à certains sites
archéologiques situés autour de la méridienne.
Les astronomes vont d'ailleurs plus loin dans leurs études, puisqu'ils qualifient ces sites de
primordiaux et sacrés selon leur propre
terme. Ces notes mystérieuses
sont également accompagnées de détails et de chronologies
insolites, et d'une liste de mobiliers anciens ou archéologiques
qu'ils appelaient "engins"...
Cette série de « Cahiers Méridiens »
(dont il ne resterait que les N° 3, 6 et 7) s’agrémenta tout au long des études des directeurs Cassini. Il était entre autres question
de relevés accentués sur certains points du territoire : on y note une insistance remarquable sur des sites dits archéologiques situés
uniquement sur la méridienne de Paris. Ces sites entreront plus tard dans différents travaux indexés sur des événements liés à notre
Histoire et surtout à des « histoires » qui seront vite classées à la rubrique ésotérique et insolite. Les Cassini insistèrent tout au
long de leur série de cahiers sur le fait de ne jamais oublier ces sites, les dénaturer, ni les éloigner de leurs fonctions
primordiales et « sacrées » (selon le terme qu’ils choisirent). Non seulement ils dressèrent scrupuleusement un état des lieux sans
rapport avec la topographie du méridien de Paris, mais ils joignirent à leurs remarques des détails et des chronologies pour le moins
curieux. De plus ils constituèrent des collections d’objets archéologiques qu’ils appelèrent « engins » et « machines antiques ». Les
plus grandes parties des collections et archives « Cassini » se trouvent encore dans le Sud de la France et non à Paris à la BN, ni
aux archives de l’Observatoire. C’est sur une partie de ces archives conservées vers Perpignan que travaillera le préfet Xavier
Richard
qui écrira en 1936 le monumental et incontournable «
ELEUSIS ALESIA » sur lequel en page 119, il
réutilise le tracé « Cassini » pour les sites proches de l’Observatoire ainsi que sur le passage de la méridienne au Nord et au Sud :
Groslay, Montmagny, Deuil, Saint‑Denis, Arcueil et L’Hay, des sites sur lesquels les Cassini travaillèrent hors propos de leurs
fonctions... |
|
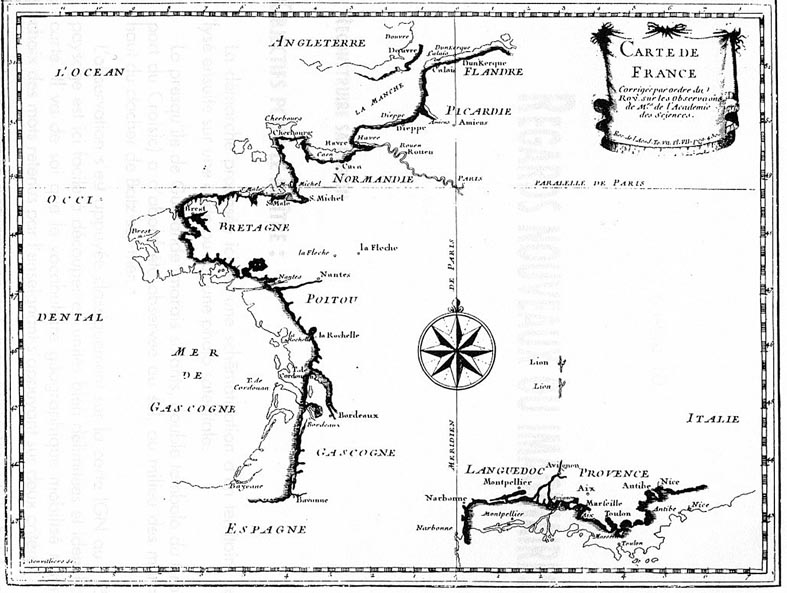
Carte de la France corrigée par ordre du Roy, sur les observations des Messieurs de l'Académie des Sciences par de La Hire et présentée au Roi en
1682. Cette carte mystérieuse présente des résultats qui ne seront connus que 30 ans plus tard...
C'est la première carte utilisant le méridien
de Paris comme méridien de référence. La
Carte de France corrigée
due aux astronomes de l’Académie des sciences, Jean Picard (1620‑1682) et Philippe de La Hire (1640‑1718) redessine les contours de la
France. Ceux‑ci offrent alors une configuration d’ensemble beaucoup plus proche de la réalité (le format de la carte originale est
265x360 cm). La superficie du pays s’en trouve réduite par rapport aux tracés de Guillaume Sanson (1679). Cela fit dire à Louis XIV
que l’Académie des sciences lui coûte cher ! |
|
Ajoutons à ceci
le mystère de l'élaboration de la carte de France.
Lorsque l'on s'attarde sur la chronologie et la présentation d'une carte comparative, on s'aperçoit que des résultats formidables sont
présentés en 1682, seulement après 3 ans d'étude, alors qu'il faudra attendre 65 ans pour accéder aux chaînes de triangulation
indispensables pour redessiner les côtes.
Comme nous le verrons plus loin, tout ceci débouche sur une véritable affaire qui
se cristallise toujours autour des mêmes thèmes : méridiens, mobiliers archéologiques, balisages, sacralisation, géométrie secrète,
etc.... |
|
La société
Angélique
Un cercle de personnage bien connu...
Et
voici comment après avoir étudié les
Cassini liés à
l'Observatoire de Paris, on revient pleins feux sur tout un
groupe de personnages bien connus dans l'affaire de
Rennes‑Le‑Château. Car la
Société Angélique
qui se faisait appeler aussi "le Brouillard"
est une société secrète artistique et littéraire qui avait pour
membre des artistes et des écrivains aussi célèbres que :
Eugène Delacroix,
Jules Verne, Gérard de Nerval, Frédérique Mistral ou même
Hergé (Ses fameuses oranges bleues seraient une
allusion poétique aux pommes bleues...)
La Société
Angélique fut fondée au XVIe siècle par un
imprimeur lyonnais Sébastien Greif qui se faisait
appeler : "Gryphe". Originaire de Wurtemberg, il s'installa à
Lyon en 1522. Sans doute à cause de son pseudonyme, il
choisit le griffon
comme emblème, symbole que l'on associe facilement au sphinx.
Faut‑il y voir alors un lien avec la Sphinge peint par Ingres
et dont la signature comporte un N inversé ? Il faut
savoir que Ingres et Delacroix se connaissaient et
s'appréciaient.
Selon
Grasset d’Orcet, l’imprimeur allemand, Gryphe était entouré
de nombreux savants et auteurs affiliés à cette organisation. La
Société Angélique utilisait comme code pour les initiés une
sorte de cabale phonétique complexe basée sur "La langue
des oiseaux".
Le livre clé
de cette société secrète est : "le Songe de Poliphile",
achevé en 1467 par Francesco Colonna, un
dominicain né à Venise en 1433. Il fut réédité par Jacques
Kerver en 1553 et en 1561 il fut légèrement corrigé. Très
curieusement il inspira des peintres comme
Poussin ou Lesueur
mais aussi Claude Perrault.
Charles Nodier,
supposé grand maître du
Prieuré de Sion selon les
documents Lobineau,
fut également très
imprégné par ces textes et créa ses rêveries apocryphes.
Gérard de Nerval ne fut pas non plus épargné.
Enfin, la
Société Angélique eut des liens étroits avec la
Rose‑Croix qui se démontrent par la similitude entre le
symbole de la Rose‑Croix paru en 1616 : "un
serpent enlaçant une ancre" et le dauphin du "Songe de
Poliphile" |
|
Les méridiens dans le Razès |
|
Les points de passage
Contrairement à certaines croyances, les
deux méridiens ne traversent pas la
bergerie Paris ou
le tombeau des Pontils,
mais ils n'en sont pas loin :
Le méridien de
Saint‑Sulpice
à Paris(en
rose)
est placé à :
2° 20' 05.49" E
Le méridien de Paris
(en
bleu)
est placé à :
2° 20' 11.37"
E
La
bergerie Paris (en
jaune)
est à :
42° 55' 17 N
2° 19' 56 E
Le
tombeau des Pontils (en
rouge)
est placé à :
42° 56' 59 N
2° 20' 27 E |
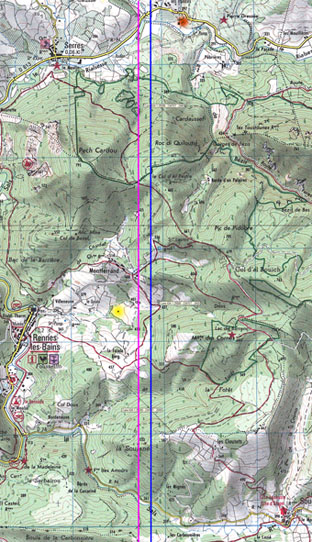 |
|
Le méridien
et les bergers d'Arcadie de Poussin
Prouvé scientifiquement par radiographie,
le bâton droit des
Bergers d'Arcadie
fut
peint en premier. Or ce détail représente un non‑sens dans l'art de
la composition picturale. Ce bâton qui passe derrière la tête du
berger n'aurait jamais dû servir de guide à la composition, à
moins que sa position soit fondamentale.
Nicolas Poussin,
maître incontesté du XVIIe siècle poursuivait donc un
but très précis.
C'est une évidence, ce bâton représente un
repère très important et le plus naturel est bien sûr de
l'assimiler au méridien de Paris. D'ailleurs son tracé
parfaitement rectiligne prouve une volonté de l'artiste à
montrer cet objet pour toute autre chose qu'un vulgaire attribut
de berger. |
|

Photo Infra Rouge montrant les
sous‑couches de la peinture (photo
P. Merle)
Remarquez le bâton droit qui ressort sur le visage du
berger,
prouvant qu'il a été peint avant le personnage
Ce détail est également perceptible sur la peinture réelle
|
|
Une autre coïncidence extraordinaire
doit être citée :
Le bâton passe exactement sur le cou du berger, or il existe au
bord du méridien 0, au nord de Montferrand, un lieu au
non évocateur "Le Col d'Al Pastre" |
|
Pourtant il y a problème à cette thèse et elle est de taille. Si
l'on admet que Poussin a utilisé le
méridien de Paris pour composer
sa toile, comment a‑t‑il pu intégrer un repère cartographique
qui fut crée 2 ans après sa mort en
1665, par
Claude Perrault en
1667 ?
Mais, si cette thèse aboutit
à une contradiction évidente du fait de la chronologie des
évènements, il faut peut‑être poser le problème autrement :
Et si
Poussin avait
créé pour le besoin de sa toile un repère fondamental ? Peut‑on
imaginer que le maître ait créé un méridien placé d'une manière
telle qu'un codage d'une logique extrême vienne ensuite
naturellement compléter la peinture. Nous savons que
Nicolas
Fouquet et
Charles Perrault étaient proches du fait de leur
fonction à Paris. Claude Perrault
aurait‑il hérité de quelques confidences de
Nicolas Poussin
via Fouquet et son frère Charles ? L'architecte aurait‑il, en
hommage au peintre, concrétisé ce méridien qu'il posa très
exactement là où Poussin l'avait conçu. Nous aurions alors
aujourd'hui un repère topographique construit sur la plus belle
toile du maître, ouvrant ainsi des pistes de recherches
passionnantes... |
|
Chronologie autour de l'Observatoire et du
méridien |
|
240 av. J.‑C.
‑ Erastosthène calcule le rayon
terrestre avec une précision de 10%
1663
‑
Colbert et Louis XIV décident d'améliorer la représentation cartographique du territoire français.
1665
‑ Quelques membres de la communauté scientifique élaborent le projet d'une "Compagnie des Sciences et des
Arts".
1666
‑
A la demande des astronomes, Louis XIV et Colbert mettent en
place "L'académie royale des sciences".
La première séance eut lieu le 22 décembre 1666.
1667
‑ Sous l’impulsion de l’Académie Royale des Sciences, l’Observatoire Royal de Paris est créé. Colbert fait venir du conté de
Nice l'astronome Jean‑Dominique Cassini (1625‑1712) qui devient directeur de l'Observatoire.
7 mars 1667
‑ Achat du terrain qui
accueillera le bâtiment de l'Observatoire
21 juin
1667 ‑
Claude Perrault et les mathématiciens tracent sur le terrain le futur emplacement de l'Observatoire orienté sur son méridien de
Paris
1668
‑ Début de construction de l'Observatoire sur les plans de Claude Perrault. Il sera terminé en 1678.
1670
‑ L’abbé Picard est désigné pour initialiser le projet de cartographie et devient l’instigateur du principe de la triangulation.
Il réalise une première étude mondiale en mesurant un arc de méridien terrestre de 130km
1681
‑ Colbert réclame impérativement des cartes géographiques de la France plus exactes que celles existantes. Jean‑Dominique
Cassini est à Rennes‑les‑Bains au col de la Sals pour des mesures.
1682
‑ De La Hire présente au Roi une mystérieuse carte de France corrigée sur recommandation des Messieurs de l'Académie et par
ordre du Roi
1696 ‑ Jean‑Dominique Cassini, malgré son âge avancé, se
lance dans la réalisation de la Carte de la France.
1718
‑
Le tracé de
la méridienne est achevé grâce à
Jean‑Dominique Cassini (1625‑1712), à son fils Jacques Cassini (1677‑1756)
et à Philippe de la Hire (1640‑1718)
1747
‑ Les triangulations appuyées sur la méridienne
vertébrale couvrent toute la surface du territoire. Une carte de France est alors possible.
1789
‑ La France voit son territoire entrer dans la forme géométrique d’un hexagone parfait.
1790
‑ Jean Dominique (Cassini IV)
présente devant la Constituante la nouvelle carte de France.
1792
‑ Jean Baptiste Delambre et Pierre
Méchain mesurent le méridien. Une expédition qui se terminera en
1798
La Convention
décide d'unifier les unités de mesure sur le territoire français
1795
‑ La Convention crée le système métrique.
1798
‑
Jean Baptiste Delambre et Pierre
Méchain terminent la mesure du méridien
3 juillet 1799
‑
Jean Baptiste Delambre et Pierre
Méchain présentent leurs travaux. Le mètre étalon
est défini et devient la base du système métrique qui deviendra international.
24 septembre 1803
‑ Les étalons du mètre, du kilogramme et toutes les règles qui ont servi aux
diverses mesures de la terre sont déposés à l’Observatoire National.
1834
‑ François Arago est Directeur de l'Observatoire de Paris
1851
‑ Foucault réalise dans le puits de l'Observatoire l'expérience du pendule "de Foucault".
1862
‑ Foucault détermine aussi dans ce même puits la vitesse de la lumière.
1884
‑ Le méridien 0 devient Greenwich et non Paris, défini sous l’égide d’une Convention Internationale.
1919
‑ l’Observatoire devient le centre mondial de l’Heure et du temps.
1994
‑ Jean Dibbet
dresse un monument à la mémoire d'Arago, une ligne imaginaire comprenant
135 médailles de
bronze.
 |
|
|



