|
|
Rennes‑le‑Château est entouré
de légendes et d'histoires merveilleuses. Celle
du
berger Ignace Paris est certainement l'une des plus
importantes, car elle est la résurgence d'un secret
enfoui depuis des siècles.
Cette belle histoire
participera à la
naissance d'une saga que l'on nommera plus
tard "l'affaire
de Rennes‑le‑Château" et que
Gérard de Sède, magnifique romancier, divulguera au
public pour la première fois dans son livre "L'or
de Rennes ou la vie insolite de Bérenger Saunière"
paru en
1967.
|
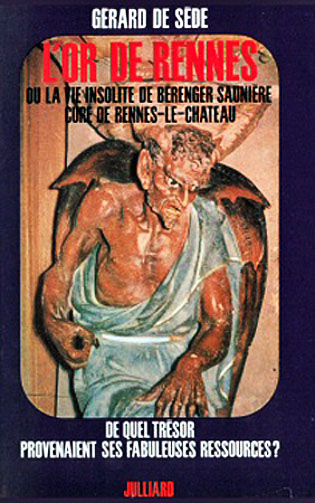
|
|
Cette légende qui n'en
serait pas une si l'on se fit aux nombreux indices qui émaillent
les faits historiques liés aux deux Rennes, nous ramène en l'an
1645... |
|
L'histoire d'un berger... |
|
En
1645,
non loin de
Rennes‑le‑Château, un berger nommé
Ignace Paris mena ses brebis sur un domaine de
pâturage aux alentours. La campagne de cette région est rude
et le relief tourmenté. Alors qu'il les faisait paître, il
constata que l'une d'elles disparut. Il partit rapidement à
sa recherche, mais alors qu'il recherchait vainement
l'animal, il l'entendit bêler au fond d'un trou.
|
|
Ignace Paris
décida alors de se faufiler dans cette anfractuosité
pour sauver sa brebis, mais le passage était difficile et
dangereux. Dans l'obscurité la plus totale, il essaya de se
repérer en tâtonnant, tel un aveugle. Alors qu'il rejoignit
la brebis dans une sorte de grande cavité, son esprit fut
rempli d'effroi et d'enchantement. D'un côté, il venait
d'explorer de ses mains un ensemble de squelettes et de
crânes ; de l'autre, il caressait par poignées entières
d'innombrables pièces d'or par terre et dans des coffres.
On peut imaginer la surprise et la peur
de ce pauvre berger qui ne s'attendait certainement pas à
une telle découverte. Sans doute pour prouver au monde
extérieur sa trouvaille, mais peut‑être aussi pour se
rassurer, il décida de remplir la capuche de son manteau de
pièces d'or et se redirigea vers la sortie en poussant tant
bien que mal sa brebis au‑dehors. La tâche était d'autant
plus difficile, car l'animal était certainement blessé.
Le chemin dangereux et étroit
ne manqua pas d'écorcher le
berger contre les parois. Arrivé
à l'air libre, il camoufla la sortie de bois mort et partit
annoncer la nouvelle aux habitants du village.
Que devint le petit berger héritier d'un
lourd secret ? L'histoire ne le dit pas. Une première
version raconte que le berger, accusé de vol, fut conduit au
seigneur du domaine, le baron
Blaise de Hautpoul. Ce dernier séquestra Paris
et le soumit à la question pour connaître l'emplacement
exact du trésor. Mais le pauvre berger succomba à la torture
et Blaise de Hautpoul ne connut le secret que bien plus
tard.
Et si le berger avait gardé son secret et
le confia à l'un de ses des proches ? Le fait est que, et
ceci n'est plus une légende, Nicolas Pavillon, évêque
du diocèse d'Alet commença à engager des travaux très importants
dans sa ville d'Alet dès 1646. Or, il faut souligner
que l'évêque
prit sous son aile un fidèle compagnon qui deviendra
son secrétaire privé. Ce personnage se nommait François
Paris et était prêtre originaire du Razès. Peut‑on
alors imaginer que le secret remonta de Ignace Paris
à
François Paris pour finalement tomber dans les
oreilles de
Pavillon ? L'hypothèse est non seulement
séduisante, mais elle permet de corrober toute une série de
faits historiques liés aux mystères du Haut‑Razès et qui
remontent jusqu'à l'affaire
Nicolas Fouquet.
Le baron de Hautpoul
connaîtra, semble‑t‑il, le Secret 15 ans
plus tard, et ceci est confirmé par un procès complexe
qui eut lieu entre Nicolas Pavillon et Blaise de Hautpoul. L'objectif du baron était bien sûr d'interdire le
passage sur ses terres des gens du roi Louis XIV et donc de Nicolas Pavillon et de ses complices.
|
|
La maison des Hautpoul
La famille de Hautpoul
est une des plus anciennes de la plus haute noblesse
du Languedoc. Le premier acte connu date de 1081 où
un certain Pierre‑Raymond d'Hautpoul figure avec
Raimond comte de Toulouse. Ce même Pierre‑Raymond
d'Hautpoul prit part à la croisade en 1095 avec
Raimond de Saint‑Gilles.
Le château d'Hautpoul fut assiégé, pris et
détruit en 1212 par
Simon de Montfort lors de la croisade des
albigeois.
L'armoirie des Hautpoul est constituée d'or
à 2 fasces de gueules accompagnées de 6 coqs de sable crêtés
becqués, barbés de gueules
et posés 3, 2 et 1.
|

L'armoirie de Hautpoul
(Musée de Rédhae)
|
|
En 1422,
Blanche de Marquefave
épousa un autre Pierre‑Raymond d'Hautpoul qui
devint ainsi seigneur de la baronnie de Rennes. Cette
famille possèdera le château de Rennes‑le‑Château pendant
plusieurs siècles.
En
1732,
François de Hautpoul, Marquis et
chevalier de Hautpoul, épousa
Marie de Nègre D'ables, Dame de Niort et Roquefeuil,
connue pour avoir laissé sur
sa stèle un
message codé.
|
|
Quelques indices qui confirment le
récit du berger... |
|
Les bergers d'Arcadie
On ne peut s'empêcher de rapprocher l'histoire du berger
Paris d'un tableau célèbre de l'affaire... En effet, comment ne pas penser aux
deux
tableaux "Les bergers d'Arcadie" de
Nicolas Poussin
et surtout à sa seconde version : trois bergers et une
bergère découvrant un tombeau...
Si l'on considère que cette toile a
été commandée à Nicolas Poussin pour coder le secret
de Rennes‑le‑Château et que le secret serait lié à la
découverte d'Ignace Paris, le tableau
aurait été
obligatoirement peint après
1645.
Or, il se trouve que cette toile fait
l'objet d'une polémique au sujet de sa datation. Officiellement
datée par le musée du Louvre entre
1638 et
1640, des experts
indépendants, spécialistes de Poussin, situent la conception de la toile plutôt entre
1650 et 1655...
D'autres recherches confirment la date
1655. Il suffit d'ailleurs d'analyser la finesse du trait, les coloris et la maturité de
l'œuvre pour se rendre à l'évidence : le tableau n'a pas pu être
élaboré vers
1640...
|
|

Les Bergers d'Arcadie ‑ Version II
‑ par Nicolas Poussin
(faussement daté entre 1638 et 1640),
plus vraisemblablement
vers 1655
|
|
Le confessionnal de Bérenger
Saunière
Lorsque l'on entre dans l'église de Rennes‑le‑Château,
juste à côté du diable Asmodée,
un confessionnal en bois de chêne
sait se faire discret. Il cache pourtant un détail très
révélateur. Cet ouvrage aurait été tout à fait
anodin s'il n'y avait pas sur son fronton une scène sculptée
bien curieuse.
|
|
L'image est censée rappeler un épisode
biblique peut illustré, celui d'un bon berger
délivrant un mouton pris dans un buisson épais rempli
d'épines.
Mais ici, la sculpture bas‑relief possède une autre
lecture : celui d'un bon berger examinant la patte cassée d'une
brebis. Le buisson épineux a disparu et l'on comprend
difficilement comment l'animal a pu se casser la patte
avant.
La
subtile référence à la légende du berger Paris
examinant sa brebis après une chute dans un trou est
presque évidente. On peut mesurer ici l'ingéniosité de
l'allégorie qui utilise l'imagerie biblique pour suggérer
tout autre
chose... Un seul détail, celui de la patte cassée,
suffit à confirmer l'allusion et sans cet élément graphique,
le message aurait pu passer complètement inaperçu ...
|
|
Le porche 1646
Comme le souligne Franck Daffos
dans son livre "Le secret dérobé", le porche de
l'église de Rennes‑le‑Château porte une date très
évocatrice. Sur l'un des piliers, on peut lire
1646, l'année où l'évêque Nicolas Pavillon
serait
devenu dépositaire du secret de Rennes, un an après la
découverte du berger Paris en
1645...
|

Le pilier droit du porche de l'église
de Rennes‑le‑Château et le cartouche 1646
|
|
Il ne faut pas confondre ...
Il faut savoir qu'il existe dans la
mythologie grecque un autre
berger Paris, fils de
Priam et roi de Troie. Plusieurs peintres ont traité
ce sujet comme Juan de Juanes, peintre espagnol du
XVIe siècle
Le berger est assis et regarde
trois
déesses. Il désigne de son index la plus belle et il s'agit
selon la légende d'Aphrodite, les deux autres étant Héra et
Athéna. Toujours selon la mythologie grecque, il tient dans
sa main une pomme d'or qui sera lancée par Eris lors des
noces de Pélée et de Thétis ...
Plusieurs auteurs verraient dans cette
toile un codage lié à l'énigme de Rennes‑le‑Château, mais
il n'existe
aujourd'hui aucune étude sérieuse pour l'affirmer.
|

Le berger Paris
grec
de Juan de Juanes
|
|
De la légende à la réalité |
|
Il est toujours
amusant de retrouver la part de vérité d'une légende. C'est courant mai 2007 que
Jean Brunelin faisait paraître sur le forum du site les photos
d'une bergerie qui pourraît bien être celle d'Ignace Paris. |
|

La bergerie Paris
est en fait une petite ferme
Dans la région et au 17e
siècle, les paysans vivaient au‑dessus de la bergerie |
|
Après une patiente enquête de voisinage et un
recoupement avec l'histoire locale, la célèbre bergerie fut
enfin localisée. Elle est située au lieu‑dit "Les Artigues",
au sud de Montferrand. C'est en suivant le petit ruisseau
de "la Dous" et que Boudet appelle délibérément par
erreur sur sa carte "la Coume" que l'on arrive tout
naturellement sur le plateau des Artigues. Cette erreur
est bien sûr volontaire pour attirer notre attention. Voici ce
que nous dit Boudet : |
|
On peut affirmer avec certitude qu'ils
cultivaient le blé, puisque cet aliment était l'objet d'une
distribution impartiale et la kaïrolo – key
(ki) clef, – ear
(ir), épi de blé. – hole, creux, petite
maison –, le grenier et peut‑être le silo ou souterrain
renfermant la précieuse céréale, existait toujours auprès des
centres d'habitations celtiques. Il n'y a guère, en effet, de
village qui ne possède un terrain de ce nom :
la kaïrolo des
Redones était située au sud de Montferrand tout près du chemin
conduisant au ruisseau de la Coume et aux Artigues. La
production du blé étant même fort abondante dans certaines
régions privilégiées, on avait recours à des mains étrangères à
ces contrées, afin de moissonner avec plus de célérité. Les
Redones n'hésitaient point à louer ainsi leurs bras pour les
travaux importants de la moisson, et le nom de Montferrand
atteste leurs périodiques voyages à cet effet – to mow
(mô), moissonner, –
to own (ôn), prétendre à, –
to fare
(fère), voyager, –
hand, main –.
(La vraie
langue celtique ‑ Boudet ‑ Page 295)
|
|
Sa position sur la carte IGN de Quillan 1/25000
confirme ce que nous dit Boudet. Elle est effectivement située
au sud de Montferrand, tout près du ruisseau de la Coume
(en fait
la Dous) menant aux Artigues. Et un coup
d'oeil sur la carte celtique montre que Boudet a omis de nous
signaler cette
Kaïrolo confirmant son importance. |
|

Emplacement de la fameuse Kaïrolo des Redones
sur la carte Boudet
|
|
C'est donc en
août 2007 que
j'entrepris d'explorer cette vieille bâtisse pleine de
mystères.
La petite maison dans la prairie est
décidément bien frêle.
Compte tenu de l'état des murs de
soutènement et des linteaux, elle a encore 10 à 20 ans devant elle...
|

|
|
Les alentours de la petite bergerie sont
incontestablement chargés d'émotions et d'Histoire. C'est aussi
dans ce lieu que Boudet fit certainement quelques
randonnées. Son église de Rennes‑les‑Bains n'est effectivement
qu'à un kilomètre à vol d'oiseau... |
|
La bergerie a visiblement resservi dans une
période récente, mais l'état des poutres la rend dangereuse |
|
La position de la bergerie est aussi remarquable,
car elle se situe à
300 m à l'Ouest du méridien 0 (méridien de Paris).
Autre curiosité, le
tombeau des pontils
est à 300 m à l'Est. Ce méridien focalise décidément de
nombreuses coïncidences... |
|

Image Google Earth
|
|
Je ne pouvais terminer ce topique sur la petite
bergerie sans remercier
Jean Brunelin qui permit à tous les
passionnés de rêver sur ce lieu mythique avec son petit livre "La
croix dans le cercle" publié en juillet 2007 |
|
|



