|
|
Il existe, parmi les sujets de
recherche
sur Rennes‑le‑Château,
des thèmes récurrents.
Celui concernant les méridiens
revient régulièrement.
À la fois
simple et complexe,
cette notion est de manière évidente
liée à l'énigme. Leurs histoires
touchent aussi
des domaines
comme l'alchimie, l'occultisme
ou les
alignements topographiques.
Surtout, il existe une histoire officielle
qui aurait commencé au
XVIIe siècle
sous Louis XIV,
mais l'étude montre
que le sujet est bien plus complexe
que ce que l'on veut bien
nous faire croire... |
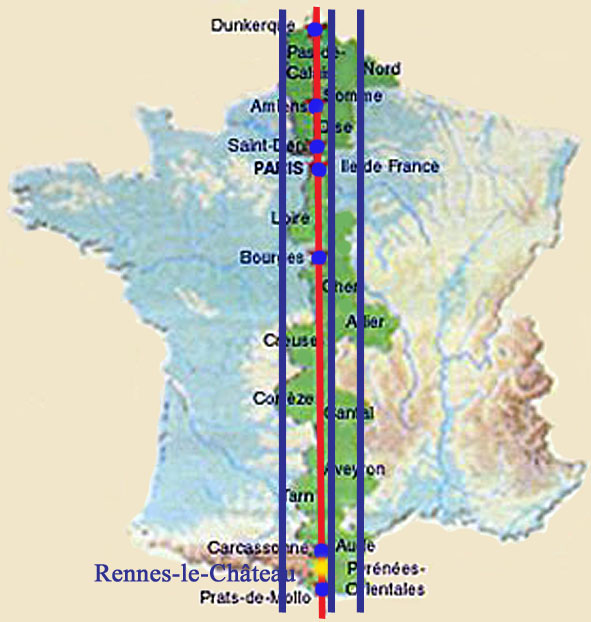
Les méridiens historiques
et occultes de la France |
|
Méridien 0, méridienne verte, méridien de Saint‑Sulpice, de Bourges, méridien de Paris, sont autant de lignes
virtuelles que le grand public connaît mal. Et pour cause, la communication est particulièrement trompeuse, car tout n'est pas dit.
L'affaire des méridiens, car il s'agit d'une affaire dans l'énigme, touche
la géographie secrète et sacrée de la France, un sujet très peu connu, mais que
l'accessibilité aux nouveaux outils de cartographie permet de mettre en valeur.
De nombreuses erreurs
perdurent également de façon cyclique, comme croire que
le
Méridien 0 traverserait exactement
le
tombeau des Pontils, ou que la cathédrale
de Bourges se trouverait sur le méridien de
l'église Saint‑Sulpice
de Paris. On peut même lire que la petite chapelle abritant la sépulture de
Jean Cocteau serait placée sur ce même méridien, alors
qu'elle est située à plusieurs kilomètres. Ces erreurs colportées par de nombreux auteurs entraînent
inévitablement des confusions difficiles à corriger avec le
temps. Tout ceci favorise une tradition culturelle qui se
propage sous la forme de rumeurs année après année,
sans aucune vérification élémentaire.
Le dossier présenté ici ne se veut ni parfait, ni
exhaustif. Le sujet est bien trop riche. Il essaie
néanmoins de démystifier certains préjugés et de tordre le
cou à des affirmations tenaces. Il n'en demeure pas moins
que l'affaire des méridiens reste remplie de mystères. Mais comme souvent
dans cette énigme,
les anomalies ne sont pas là où on les attend. Ce serait bien trop
simple...
Je veux remercier ici Patrick Merle, chercheur spécialisé dans les structures
cartographiques,
qui initialisa cette étude et qui permit de voir le jour à ce
travail laborieux,
resté longtemps endormi. C'est le 5 septembre 2009 que Patrick tentait sur le forum
d'attirer l'attention sur
certaines anomalies autour du méridien 0 et de son
élaboration historique. Depuis, beaucoup d'eaux ont coulé sous les ponts.
Ce dossier inédit est le résultat de nombreux travaux sur plusieurs années
et j'ai jugé le moment indispensable de publier une compilation de nos études.
En effet de nombreux
éléments futurs viendront s'appuyer sur ces recherches,
véritable boîte de Pandore aux pistes multiples et étonnantes...
Copyright © RLC Archive ‑ Jean‑Pierre Garcia et
Patrick Merle
 |
|
Méridien et géographie sacrée
C’est
à partir de cette page et des suivantes que le dossier des méridiens entre dans le domaine de la
géographie sacrée. Faut‑il
faire la différence avec la géographie officielle ? Oui si l'on considère qu'elle est non enseignée et peu connue, non si l'on regarde
son aspect descriptif et ces règles. Cette géographie particulière se base sur des constats historiques et des faits de terrain qu'il
est très difficile de contredire. En effet, les outils numériques du Web permettent des prouesses qui étaient inconcevables à l'époque
de Philippe de Cherisey. C'est en cela que ce dossier est important. Des preuves par l'image et des faits de l'Histoire montrent
clairement des anomalies et des incohérences que la géographie descriptive classique ne peut combler et expliquer.
Ce sujet sensible et
sulfureux en amènera d'autres. Prenez le temps de réfléchir et de mûrir la question. N'hésitez pas à contrôler sous Google Earth, Geo
Portail ou directement sur les cartes. Les moyens sont aujourd'hui à la portée de tous pour vérifier ce nouvel espace très fermé.
Attention :
Avant de vous lancer dans le tracé des méridiens, il est
important de lire à ce propos les pièges qu'il faut éviter.
Rejoignez la page :
Géodésie et cartographie ‑ Le problème du tracé des
méridiens sur une carte
|
| Le méridien naturel (Pic de Nore ‑ Pic du Canigou)
Depuis que les frontières françaises ont existé, on a cherché à poser un méridien
traversant le territoire de France afin de marquer son milieu géographique et surtout son centre. Cette nécessité s'est imposée
naturellement pour des raisons politiques et des besoins de balisage. Le problème est bien sûr de placer un centre ou du moins un
milieu sur une forme irrégulière. Les Hommes ont donc d'abord tiré parti des repères naturels et immuables comme les montagnes ou les
pics les mieux adaptés.
Le
premier méridien dit "naturel" fut choisi en prenant comme
repère :
au Nord : le Pic de
Nore
GPS 43° 25' 27,47" N
2° 27' 47,58" E
au Sud : le Pic du Canigou
GPS
42° 31' 07,53" N 2° 27' 24,33" E
Le
Pic de Nore est un sommet et un col situé dans la Montagne Noire, près
de la frontière des départements de l'Aude et du Tarn. Il culmine à
1211 m d'altitude. Le
panorama depuis le pic est très vaste puisqu'il domine la chaîne des Pyrénées du Sud‑ouest au Sud‑est (Canigou), le sillon audois, la
mer Méditerranée, les Corbières, le Haut‑Languedoc, les Monts de Lacaune et la plaine toulousaine.
Il faut remarquer que la Montagne Noire abrite la commune de
Mazamet et le village de
Hautpoul accroché à un piton rocheux. Le village garde l'entrée de la
Montagne noire et ses vastes forêts cachent une légende selon laquelle
Hautpoul aurait été fondé en
463 par Atholph 1er, roi
wisigoth qui y installa une communauté et dessina les premiers contours de la forteresse.
Le Canigou est l'une des montagnes les plus célèbres d'Europe et
plusieurs milliers de personnes la gravissent chaque année. Son sommet, le
Pic du Canigou, est sur un point oriental de la chaîne des
Pyrénées. Il est situé dans le Conflent, département des Pyrénées‑Orientales et culmine à
2 784 m d'altitude. Sa situation
géographique offre une vue fantastique sur la plaine du Roussillon et même par temps clair sur Barcelone.
Du fait de son calage sur ces deux pics naturels, le méridien est légèrement incliné,
mais cela reste négligeable surtout pour la précision de l'époque, d'autant qu'il s'agit d'un méridien régional. Mais si on le prolonge sur
toute la France, il est remarquable de le voir frôler une
forteresse historique très importante, celle de Condé, la forteresse de
Montrond. Le méridien
passe en effet à moins de 1600 m du château. Ceci est d'autant plus remarquable que la forteresse est non loin du point central
officiel du
territoire français situé à Saint‑Amand‑Montrond.
Une particularité étonnante :
la distance entre le Pic de Nord et le Pic du Canigou
est de 100 km à 200 m près
|
|

Le méridien naturel régional Pic de Nore‑Pic du Canigou traverse
le château de Montrond (forteresse de Condé) (Google Earth) |
|
La forteresse de Montrond
La forteresse totalement oubliée est située tout près de
Saint‑Amand‑Montrond dans le Cher. Implantée sur une butte calcaire isolée, posée au confluent des vallées du Cher et de la
Marmande, elle est la seule fortification bastionnée édifiée dans le centre de la France, ce qui la rend unique. D’autre part, elle
présente un véritable condensé de l’architecture militaire du XIIIe au XVIIe siècle. Paradoxalement, c’est un monument
entièrement tombé dans l’oubli et de plus, complètement disproportionné par rapport à son lieu stratégique situé sur les voies de
passage du centre. Le château fut
successivement
la propriété des d'Albret,
de Culan, de
Sully, et des
princes de Condé. |
|

Les ruines de la forteresse de Montrond près de Saint Amant‑Montrond |
|
Construite au XIIe siècle par
Renaud de
Montfaucon sur un pic isolé, entre les vallées du Cher et de la Marmande, la forteresse de Montrond tomba en
1361
entre les
mains des Anglais. Reconstruite au XVe siècle par
Charles d'Albret, elle comportait alors un logis, une enceinte renforcée de
12 tours et un puissant donjon de 40m de haut. Durant la guerre de Cent Ans, la forteresse résista à l'invasion anglaise alors même
que le château voisin d'Orval fut totalement brûlé en
1412.
Mais le véritable essor se situe
incontestablement au XVIIe siècle.
Abandonné au XVIe siècle, le château
est en ruine en 1606, lorsque
Maximilien de Béthune,
Duc de
Sully, puis les
Condé
le font renaître. Racheté en
1606 par le
célèbre
ministre d’Henri IV « grand maître de l’artillerie », le château se trouvait dans un état de délabrement proche de la ruine, surtout après
avoir traversé l'époque trouble du XVIe siècle.
Sully s’attacha dans un premier temps à restaurer, agrandir et embellir l’ancien
château‑fort pour en faire une résidence luxueuse en rapport avec ses moyens. Il modernisa le système défensif qui ne répondait plus
aux contraintes de l’artillerie. L'imposant bastion fut également
transformé en une demeure princière. Le sculpteur Lafrimpe et le peintre Jean Boucher sont chargés de la décoration. Les quelques
inventaires des meubles, tableaux, vases et vaisselles se trouvant dans le château de Montrond au début du XVIIe siècle permettent de
se faire une idée du luxe et du raffinement. En
1617, on trouve aussi dans la forteresse un arsenal impressionnant : plus de 200
mousquets, 200 arquebuses, des pistolets et pas moins de 1500 boulets de toutes tailles. Fin
1610, malade et en semi‑disgrâce après la
mort d'Henri IV, Sully se retira plusieurs mois à Montrond où il rédigea une partie de ses
Mémoires.
Contraint d'abandonner ses
places du Berry méridional, il céda alors Montrond en
1621 au prince
Henri de Condé, duc de Bourbon et père du
Grand Condé,
dont Bossuet fera plus tard l'oraison funèbre. L'enfant, héritier présomptif du trône de France pendant 17 ans et porteur, de ce fait,
du titre de Premier Prince du Sang, passa sa jeunesse au château. Nous
voici reliés à
la Fronde et donc à
Port‑Royal.
Le prince de Condé
poursuivit à très grande échelle les aménagements de son prédécesseur pour faire de Montrond la forteresse redoutable qui causa tant
de soucis aux armées royales lors de la Fronde. Pour fortifier la place, il engagea un spécialiste, Jean Sarrazin, surnommé
«Mathématicien du prince» ou encore «intendant des fortifications». Ce dernier travailla plus de 10 ans à la conception
et à la réalisation d’un puissant réseau de fortifications bastionnées, étagées sur les pentes de la colline.
Vers 1650, la Forteresse devint l’une des plus fortifiées de France avec ses nombreux ouvrages empilés sur plusieurs niveaux.
Ces niveaux respectent la topographie de la colline et sont séparés par des fossés taillés dans le roc, le tout relié par des passages souterrains.
Ce système bastionné avec ses angles rentrants ou saillants dont le tracé conçu en
fonction de la portée utile des armes à feu devait éliminer les angles morts. Le ceinturage défensif atteint une longueur cumulée d’environ 5 km, ce qui
traduit l’importance de la forteresse. |
|

Le château de Montrond en 1651 (Mallard Histoire des deux villes de Saint Amand 1894) |
|
Louis
II de Bourbon, le Grand Condé prit la tête de l’opposition contre Mazarin lors de la Fronde et Montrond devint la
dernière place forte du Berry et du Bourbonnais à résister et à tenir tête aux armées royales après la reddition successive de tous
les autres châteaux tenus par les partisans de Condé (Culan, Bommiers, le Châtelet, Hérisson).
Défendu par le
marquis de Persan, le
siège commencé en octobre 1651 ne s’acheva que le 1er septembre 1652, avec la capitulation d’une garnison épuisée,
affamée et décimée par les maladies (la seule tentative de secours de la place se solda par l’échec d’un corps de cavalerie composé de
800 hommes en août 1652).
Les vingt survivants sortirent de la forteresse
« tambour battant, enseigne déployée et mèche allumée ».
Furieux d'avoir vu l'autorité
royale bafouée, Louis XIV et Mazarin
ordonnèrent le démantèlement immédiat de la place dont l’essentiel des ouvrages bastionnés fut miné ainsi que les accès aux
cheminements souterrains.
Les
bâtiments résidentiels furent heureusement préservés par ces destructions punitives. Faute d’entretien, habité plus ou moins après la Fronde, le
château fut abandonné vers 1735 et ses matériaux les plus intéressants démontés et vendus (charpentes, couvertures). Il fut
ensuite livré vers 1775 comme carrière de pierre à bon compte aux habitants de Saint‑Amand pendant la Révolution.
A la fin du XVIIIe siècle, Montrond passe au
duc de Béthune‑Charost puis au
comte de Fougières. Il est saisi à la Révolution et vendu comme bien national le 7 vendémiaire an III. Les dernières ruines sont
abattues en 1827.
Son emplacement fut
transformé en promenade publique à partir de 1834.
Enfoui
sous un parc planté d'arbres, avec des jardins et des vergers sur ses pentes, son souvenir s’effaça même des mémoires. C’est à
partir de 1970, sous l’impulsion d’une petite équipe de curieux et de passionnés, que s’amorça une résurrection progressive
d’un site prestigieux tombé dans l’oubli.
Le problème est donc posé.
Pourquoi un château‑forteresse d'une telle importance fut‑il
construit au centre de la France ? Et pourquoi Louis XIV s'empressa‑t‑il de le démanteler ?
Simple hasard ou intrigue politique ? |
|

Les plans de la forteresse de Montrond (BNF) |
|
Le méridien frontière
Il existe un méridien français étonnant : À partir du tracé actuel des frontières, il est possible de définir un méridien dit "frontière"
coupant la France en deux sur ses latitudes extrêmes. Ce
méridien se construit en choisissant les extrémités nord et sud
du territoire français, c'est‑à‑dire les points frontière le
plus au Nord et le plus au Sud. Ces points sont localisés comme
suit :
Au Nord : La plage de Bray‑Dunes près de Dunkerque
(très exactement la maison de la dune)
GPS : 2° 32' 32" E 51° 5' 27" N
Au Sud : La montagne de la Bague de Bordeillat
près de Prats‑de‑Mollot avec une crête à 1395 m. Sur le même méridien et très
près de la frontière se trouvent
les tours de Cabrens composées d'une tour à signaux, d'un ancien donjon et d'un château en ruines.
GPS : 2° 32' 32" E 42° 20' N
Ce méridien démontre une
caractéristique étonnante du territoire français actuel : cette ligne méridienne unique traverse les points frontière extrêmes Nord et Sud de la France. Ceci est remarquable, car si on peut toujours déterminer un point le plus au
Nord ou le plus au Sud, il est étonnant que son opposé soit aussi à l'extrême tout en étant posé sur ce méridien.
Ce fait intriguant
est loin d'être un hasard. Les frontières françaises ont non seulement respectées une géographie naturelle, mais aussi des contraintes
très particulières permettant d'inscrire les contours de la France dans une forme géométrique sacrée. |
|

Le méridien frontière (en orange) à l'extrême nord de la France
coïncide avec la frontière franco‑belge (en jaune) |
|

Le méridien frontière à l'extrême sud de la France coïncide avec
la frontière franco‑espagnole (en jaune) |
|
Le méridien frontière est très proche du méridien naturel (5400 m),
mais contrairement à ce dernier qui est légèrement incliné
(méridien régional), le méridien frontière est parfaitement
défini à :
2° 32' 32" E
La forteresse de
Montrond est située à
3500 m à l'Est du méridien frontière et
ND du Cros
est placée exactement sur celui‑ci
Le méridien frontière partage la France sur une longueur de
973
220 m |
|

Le méridien frontière traverse la France sur ses extrémités Nord et Sud
©
Rennes‑le‑Chateau‑archive.com |
|
Le méridien du duc de Rochechouart‑Mortemart
Nous allons maintenant voir que si le méridien frontière se définit
parfaitement, les curiosités historiques autour de cette ligne virtuelle ne manquent pas et
qu'elle se comporte comme une véritable
boîte de Pandore...
Nous avons vu précédemment que le centre de la France se situe
autour de Saint‑Amand‑Montrond, or il existe près de là, une colline : "La colline du Belvédère" sur laquelle fut construite
en 1855 une étrange tour : "La Tour Malakoff"
située à :
GPS 46° 44' 24" N 2° 32' 56" E
|
|
La Tour Malakoff fut érigée en
1855 par le
général‑marquis de Rochechouart duc de Mortemart
en
l'honneur des troupes victorieuses de Napoléon III durant la campagne de Crimée.
Elle porte la mention :
GLOIRE IMMORTELLE A L'ARMÉE D'ORIENT
8 septembre 1855
La tour est de forme octogonale et est à
314 m d'altitude
La tour Malakoff
est considérée officiellement comme
le centre géométrique du
territoire continental.
Elle est située à
474 m à l'Est du méridien frontière, ce qui représente une erreur
négligeable par rapport à la longueur du méridien évalué à
973 220 m
(taux d'erreur 10‑4) |

La Tour Malakoff à St Amand‑Montrond |
|
Qui était le général marquis duc de
Rochechouart‑Mortemart ?
La maison de
Rochechouart est considérée comme la famille
de la noblesse française la plus ancienne de France après la maison royale. Sa filiation a été vérifiée et prouvée à partir de
l'an
980. De plus, la famille constituée des
Rochechouart et des
Mortemart resta possessionnée durant plusieurs siècles
dans le Limousin et
servit la France à
travers ses différents régimes. C'est en lisant le parcours de cette longue lignée que l'on comprend qu'elle fut impliquée non seulement dans
les grands évènements français, mais qu'elle côtoya les plus grands du royaume durant des siècles. Le résumé ci‑dessous est édifiant (source
Wikipédia).
|
|
La branche
Rochechouart provient de la
maison de Limoges fondée
par Foucher de Limoges et qui serait le
second fils de Raymond Ier,
comte de Toulouse, et de Berteys, fille de Rémi. Les vicomtes de Limoges et de Rochechouart seraient ainsi issus des comtes de
Rouergue et
des comtes d'Autun apparus en l'an
730. Selon de récentes études généalogiques, les Rochechouart seraient donc les descendants de
Thierry II, de
Clovis et des
rois mérovingiens.
La branche aînée des vicomtes de Limoges s'est fondue en
1290 dans la maison de Dreux‑Bretagne
(1290‑1384) qui devint vicomte de Limoges, puis dans
celle de Blois‑Châtillon (1384‑1481), et
enfin dans la
maison
d'Albret (1484‑1572). À la mort de
Jeanne d'Albret,
vicomtesse de Limoges, en 1572, le titre revient à son fils
Henri, roi de Navarre, dernier vicomte de Limoges, et futur
Henri IV.
En
980, Aimery de Limoges, quatrième fils du vicomte Géraud, épouse Ève
Taillefer, fille de Guillaume II, comte
d'Angoulême et reçoit en dot les
terres de Rochechouart. Il
devient le premier vicomte de Rochechouart.
En
1096, le vicomte Aimery IV rejoint
la Première Croisade et
participe à la prise de Jérusalem
en 1099 aux côtés de
Godefroy de Bouillon. En
1146, son fils Aimery V accompagne le roi Louis VII
lors de la
deuxième croisade.
Après la répudiation d'Aliénor
d'Aquitaine en
1153, le Poitou et le Limousin sont le théâtre de combats sanglants entre Français et Anglais.
Exposée aux guerres pendant trois siècles, Rochechouart se range dans le camp du roi de France : Aimery VI rend hommage en
1226 à
Saint‑Louis; Aimery IX accompagne
Philippe III le Hardi à
l'Ost de Foix en 1271 et l'expédition d'Aragon en
1283; Simon de Rochechouart participe en
1304 aux côtés de
Philippe IV le Bel, à la
victoire française en Flandres.
En
1328, le vicomte Jean de
Rochechouart accompagne
Philippe VI de Valois lors de l'expédition menée en Flandres. Il participe également en
1346 à la
bataille de Crécy. À la suite de cette bataille, Henry de Lancastre, capitaine du
roi d'Angleterre, dévaste avec ses troupes l'ensemble du
Poitou. Après plusieurs jours de siège, Rochechouart est mise à sac. 600 personnes sont égorgées. Dix ans plus tard,
en 1356, Jean de Rochechouart et tué lors de la
bataille de
Poitiers,
en s'interposant
pour sauver le roi
Jean le Bon. L'année suivante, le
Traité de Brétigny accorde
l'ensemble du Poitou et du Limousin à la Couronne d'Angleterre, Rochechouart est livrée aux Anglais en
1362.
En
1364, le vicomte Louis, est fait prisonnier par le
Prince Noir qui le soupçonne
d'être resté fidèle au roi de France. À sa libération, il renouvelle en effet son allégeance à
Charles V et rejoint les
troupes de Du
Guesclin.
En représailles, les troupes anglaises font le siège de Rochechouart, à plusieurs reprises. Les enceintes de la ville et
du château résistent, mais les terres alentour sont dévastées.
Louis de Rochechouart, nommé conseiller et chambellan de
Charles V, et son lieutenant pour le Limousin, participe aux
côtés de Du Guesclin à la reconquête du Poitou en
1372.
La fidélité des Rochechouart à la Couronne de France est récompensée par le roi
Charles V qui appelle Louis de
Rochechouart "son cousin": les vicomtes Jean II, Geoffroy et
Foucaud sont conseillers et chambellans de père en fils des rois
Charles VI,
Charles VII et
Louis XI. Par leur mariage, ils
accroissent leur domaine, en recevant des fiefs dans le Berry et le Poitou. Jean II épouse
Eléonore de Mathefelon dont la mère est de sang royal. Ils participent aux dernières grandes batailles de la guerre de
Cent‑Ans : Azincourt et les
campagnes de Jeanne d'Arc, dont Geoffroy est
un compagnon. Foucaud est nommé gouverneur de La
Rochelle.
Fait chevalier de l'ordre du
Porc‑Épic, un ordre chevaleresque institué par
Charles d'Orléans et
qui ne
comptait que 24 membres, il participe en
1453 à la prise de
Bordeaux et la
bataille de Castillon qui
marquent la reconquête du sud‑ouest du pays et la victoire définitive de la France sur l'Angleterre dans la Guerre de
Cent‑Ans.
En
1470, Anne, fille unique de Foucaud, épouse Jean de
Pontville, chambellan de Charles de
France, duc de Guyenne et frère de
Louis XI. À l'instar de la
vicomté de Limoges trois siècles plus tôt, la vicomté de Rochechouart quitte alors la lignée de Foucher de Limoges, qui
continue à se perpétuer avec les
Seigneurs du Bourdet et les
Seigneurs du Chandenier, deux branches cousines.
Au
XVIe siècle, les Rochechouart participent aux
guerres menées par la France, notamment les Guerres d'Italie. En
1508, François est nommé gouverneur de
Gênes par
François Ier,
Christophe est fait prisonnier avec le roi à la
bataille de Pavie en
1525. Antoine de Rochechouart commande en
1530 lors de la défense de
Marseille contre
Charles Quint, il est tué à la bataille de
Cérisoles en 1544. René participe aux côtés du
Duc de Guise à la prise de
Calais en
1558 et reçoit en
1580 le collier de
l'Ordre
du Saint‑Esprit.
Jean‑Louis de Rochechouart participe en 1627 au
siège de
la Rochelle commandé par le
Cardinal de
Richelieu. Après la Journée des
Dupes, son neveu François, appelé le chevalier de Jars, proche de la reine
Anne d'Autriche,
est contraint de s'exiler en Angleterre. A son retour en 1632,
il est enfermé à la Bastille et interrogé par
le « Bourreau du cardinal
», qui le fait condamner à mort. Conduit à l'échafaud le
10 novembre 1633, François de Rochechouart est gracié quelques instants
seulement avant son exécution. Après un long séjour en prison, il s'exile en Italie, où il devient proche de
Mazarin. Il joue un rôle important aux
premières heures de
la Fronde.
Ami d'enfance de
Louis XIII,
Gabriel de Rochechouart de Mortemart l'accompagne dans ses diverses expéditions. Il est fait premier gentilhomme de la
chambre du roi en 1630 et chevalier des ordres du roi en
1633.
Louis XIV l'élève en
1663 au titre de
Duc de Mortemart, prince de Tonnay‑Charente et pair de France, et le nomme
gouverneur de
Paris et de l'Île‑de‑France en
1669.
Trois de ses
enfants occupent les plus hautes places à la cour du Roi‑Soleil :
Louis‑Victor, appelé
duc de Vivonne, est maréchal de France et vice‑roi de
Sicile ; Marie‑Madeleine, dite reine des abbesses, est une personnalité très influente de la communauté intellectuelle du XVIIe
siècle, qui traduit avec
Racine
Le Banquet
de Platon.
Mais le plus célèbre membre de la famille est sans aucun doute
Françoise‑Athénaïs, épouse du
marquis de Montespan, qui est, de 1667 à
1680, la favorite de
Louis XIV. Aux côtés de cette femme éprise de luxe et de bel esprit, le monarque mène un règne fastueux. Ils ont ensemble sept enfants. Le roi souhaite que ces derniers montent sur le
trône en cas d'extinction de sa descendance (son arrière‑petit‑fils Louis, le futur
Louis XV, était alors son unique
héritier). Dans son testament, le monarque désigne le
Duc du Maine et le
Comte de Toulouse,
comme les régents de son jeune successeur. Après la mort du Roi‑Soleil, les fils de la Montespan sont cependant écartés
par le Duc
d'Orléans, qui avait épousé
Mademoiselle de Blois, l'une des filles de
Louis XIV et d'Athénaïs de Rochechouart. De la sorte que cette dernière est
l'arrière‑grand‑mère de
Louis‑Philippe
Ier, roi des Français.
Au
XVIIIe siècle, la maison de Rochechouart occupe une place de premier plan à
la cour. Jusqu'à la Révolution, elle donne huit généraux à l'armée française. Trois sont décorés de l'ordre
du Saint‑Esprit. Le
cardinal de Rochechouart,
évêque de Laon, est
quant à lui le second pair ecclésiastique du royaume. Il est nommé par
Louis XV ambassadeur à Rome
auprès du pape Benoît XIV. Grand aumônier de la
reine, il assiste en 1775 au sacre de
Louis XVI en qualité de pair du
royaume. Cette position privilégiée à la cour de France place la maison de Rochechouart dans une situation délicate sous
la Révolution.
En
1789, le général
Aimery‑Louis‑Roger de Rochechouart est élu aux États Généraux. Libéral, il est l'un des
47 députés de la Noblesse à se prononcer pour la fusion des trois ordres et à se rallier à l'Assemblée Nationale.
Membre de l'Assemblée
Constituante, il participe à l'abolition
des privilèges, lors de la Nuit du 4 août. Sa sœur Diane est guillotinée en
1794 sous
la Terreur, avec son mari, le
député
Louis Marie Florent du Châtelet. La vicomtesse Marie de Rochechouart est elle aussi décapitée en avril de la même
année. Quant à
Elisabeth de Rochechouart, amie de
Marie‑Antoinette,
elle échappe de peu au même sort. Un mandat d'arrêt est lancé contre elle après qu'elle a tenté de faire évader la reine,
enfermée à la Conciergerie. Elle échappe de justesse aux autorités et émigre en Angleterre et en Allemagne où elle devient
une active contre‑révolutionnaire. Son fils
Louis‑Victor‑Léon de Rochechouart émigre en Russie où il est nommé général‑major de l'armée du tsar. Il participe aux
batailles de la Berezina,
Dresde,
Leipzig, à la
Campagne de France
et à la Bataille de Paris
en 1813 et
1814. Nommé général et
commandeur de la Légion d'Honneur par
Louis XVIII, il est
gouverneur de
Paris de 1815 à
1823.
Le général
Victurnien de Rochechouart de Mortemart, député de la noblesse aux États‑Généraux en
1789, émigre en
Angleterre en 1792. Le roi
George III
le nomme
à la tête d'un régiment émigré à la solde britannique, le
régiment de Mortemart, qui
combat à Guernesey et au Portugal. Il rentre en France en
1802.
Napoléon le nomme conseiller général de la
Seine en 1812.
Son fils
Casimir s'engage dans la Grande Armée, et
participe notamment aux batailles de
Friedland,
Essling,
Wagram et
Borodino. Nommé général à
la Restauration, il est décoré de
l'ordre
du Saint‑Esprit en
1825. En
1830,
Charles X le nomme Premier
ministre.
Grand‑Croix de la légion d'Honneur, il est nommé sénateur en
1852. Ses cousins René‑Roger et Henri sont députés sous
la IIIe République.
Anne de Rochechouart de Mortemart, duchesse d'Uzès, dépense une grande partie de son argent dans le financement de la
carrière politique du général Boulanger
en 1890. Grande femme du monde, elle écrit une dizaine de romans et devient la première femme française à posséder le permis de conduire. François de
Rochechouart de Mortemart, prince de Tonnay‑Charente, est tué en 1918 à Liny devant Dun‑sur‑Meuse (Meuse), lors de la
Première Guerre mondiale.
La famille de Rochechouart de Mortemart est la branche cadette de la
maison de Rochechouart. Les seigneurs
de Mortemart accèdent au titre de duc et pair de France par lettres
patentes du roi Louis XIV en
1663. |
|
Casimir Louis Victurnien
de Rochechouart
de Mortemart
(1787‑1875)
Il naquit à Paris le
20 mars 1787 et disparut à
Neauphle‑le‑vieux le
1er janvier 1875
Prince de Tonnay‑Charente, baron de Mortemart et de
l’Empire, 9e duc de Mortemart et pair de France
en 1814, il fut militaire, diplomate, et homme politique français du
XIXe siècle. Il fut nommé président du Conseil des ministres par
Charles X en 1830.
C'est également lui qui construira la
Tour Malakoff à Saint‑Amand‑Montrond
|
 |
|
Il est le fils de
Victurnien‑Jean‑Baptiste de Rochechouart de Mortemart
(1752‑1812), duc de Mortemart, et
d'Adélaïde de Cossé‑Brissac (la maison dans laquelle on retrouva la fameuse lettre
mystérieuse de l'abbé Fouquet parlant de
Nicolas Poussin). Casimir de Rochechouart émigra avec sa famille
en 1791. Élevé en Angleterre, il revint en France avec sa mère en
1801.
À la fin de sa vie qui fut très remplie par les guerres napoléoniennes et la restauration française, le duc se consacra aux œuvres de
charité. Curieusement, une seule fois, il réagit violemment par une lettre indignée contre la suppression de la
Société de
Saint‑Vincent‑de‑Paul.
Il faut aussi noter que
la lignée Blanchefort est liée à la
famille Rochechouart. La famille Blanchefort est associée aux
Croisades et à l'Ordre des Templiers.
Un extrait généalogique montre ce rapprochement :
Guy I de Blanchefort
mort en
1356 à Poitiers eut un fils :
Guy II de Blanchefort mort après 1432 eut un fils avec
N. de Rochechouart :
Guy III de Blanchefort
mort en 1460 |
|
Vous pensez certainement qu'il s'agit de la Tour Malakoff ? Observez
bien...
Il s'agit en fait d'une
autre tour ressemblant terriblement à celle du duc de Mortemart,
et qui est aussi située à Saint‑Amand‑Montrond :
La tour Regnault.
Quelle
est donc cette étrange coutume à Saint‑Amand qui consiste à
construire une tour à facettes crénelée et perchée sur une
butte ?
Celle‑ci fut selon la rumeur construite par Émile Regnault, un concessionnaire des
charbons et anthracites du Creusot, d'où le nom tour Regnault. Elle aurait servi à l'observation du ciel... Décidément, Saint‑Amand
possède une réelle tradition de bâtisseurs rêveurs... |
 |
|
Le méridien frontière rectifié
Pourquoi rectifier un méridien qui est déjà remarquable puisqu'il correspond aux points frontière extrêmes ? La réponse se trouve dans
la mise en valeur et dans la préservation d'une
géométrie secrète et sacrée du territoire français. Pour répondre à des
critères de plus en plus précis du fait de la cartographie moderne et des technologies nouvelles, le "méridien frontière" qui convenait
largement au 19e siècle a dû être légèrement décalé vers l'ouest, très exactement de
900 m.
Ainsi,
la tour Malakoff bien que placée avec une excellente précision pour
l'époque, se trouve maintenant à une distance de
1424 m à l'Est de ce nouveau méridien dit rectifié.
|
 |
|
Mais quel est donc le repère de ce méridien secret et sacré ? Puisque ce travail est récent,
le monument ou la borne devrait être issu d'un projet récent.
Reformulons la question : quel est le projet le plus marquant des 20 dernières années à
Saint‑Amand‑Montrond ?
Vous avez trouvé ? |
|

Le méridien frontière rectifié passe très exactement par la Pyramide de Saint‑Amand‑Montrond
(Google Earth)
©
Rennes‑le‑Chateau‑archive.com |
|
Le repère de ce méridien très particulier est fourni par
la plus grande pyramide de France,
faite de verre et d'acier. Le monument est en effet posé
sur ce méridien précieux au milieu de l'axe désignant de fait le centre géométrique continental du territoire. Paradoxalement, aucune
information sur cette propriété très particulière n'est fournie, aussi bien sur les brochures du site que sur place.
La Pyramide est située à l'Est de
Saint‑Amand‑Montrond
aux coordonnées :
GPS 46° 43' 27,42" N 2° 31' 47 E
L'altitude au haut de la pyramide est très exactement
168 m, un nombre symbolique
dans l'énigme de Rennes (déclinaison du
681).
Le méridien frontière rectifié coupe la France sur une longueur de
972 784 m
et passe exactement
par Caune Minervois, la mine de marbre. Remarquez aussi qu'il ne passe pas par Paris, mais plus à l'Est. |
|

La plus grande pyramide de France à Saint‑Amand‑Montrond
sert de repère au centre du territoire, mais ceci est non officiel |
|
La
Pyramide de Saint‑Amand‑Montrond n'a pas été posée au hasard. Elle respecte les contraintes d'une
géographie secrète et sacrée de tradition très
ancienne. Il suffit de tracer le cercle de France pour s'en convaincre. En prenant comme centre la pyramide de verre, la forme divine passe
bien sûr par les extrémités
frontières Nord et Sud du méridien, mais aussi très précisément par la pointe frontière Est, à
Lauterbourg, où se trouve un important château
épiscopal. Il est aussi remarquable de voir que le conté de Nice, Toulon,
Argelès‑sur‑Mer (1), et Saint Jean‑de‑Luz près de Biarritz, sont également traversés par la circonférence. Même les
îles bretonnes
sont incluses dans le cercle...
(1) Dans
Clovis Dardentor de
Jules Verne, le bateau du capitaine
Bugarach s'appelle l'Argeles
et en inversant...
"C'est le Graal". Nul doute que Jules Verne disposait de
quelques notions du méridien secret...
Voici donc une première explication de la toponymie de
Saint‑Amand...
Mon rond... là, où pas loin se trouve aussi la
Tour Malakoff construite à une hauteur de
314 m (Pi = 3,14 symbole mathématique du cercle)
Il est vrai que la Tour Malakoff était le centre de la France, le centre d'un cercle...
|
|

La pyramide de verre de Saint‑Amand‑Montrond est le centre du cercle qui inscrit
le méridien frontière rectifié ‑ ©
Rennes‑le‑Chateau‑archive.com |
|
En
géométrie sacrée le cercle est une forme
divine. Inscrire la France dans un
cercle est un symbole très fort qui implique de nombreuses questions sur
l'élaboration des frontières et l'acquisition des territoires à la suite des guerres et des Traités, et qui dessinèrent au fil des siècles la France que nous
connaissons aujourd'hui...
C'est en 1789
que l'on découvre que la France possède une forme très particulière. Son contour et sa géométrie permettent de l'inscrire dans un hexagone
régulier, forme lourde de symbole puisque qu'il s'agit aussi de l'étoile de Salomon, l'étoile à 6 branches... |
|

La Pyramide et son entrée pharaonique aux portes de la petite commune de Saint‑Amand‑Montrond
|
|
La pyramide de Saint‑Amand‑Montrond ‑ Google maps |
|
Saint‑Amand‑Montrond, une commune à part |
|
Saint‑Amand‑Montrond est situé dans la région centre et dans le département du Cher, à
60km de
Bourges, l’ancienne
capitale de France. Construite dans une cuvette naturelle autour de la Marmande, en amont de son confluent le Cher, la petite commune
est voisine d’Orval. Elle est aussi intégrée dans la province du Bourbonnais et s’inscrit parmi les Trésors de la Route Jacques
Cœur, la plus ancienne route historique de France.
|
 |
| L’eau est très présente dans la commune qui comportait de nombreux marécages.
Beaucoup de jardins disposent aujourd’hui d'un trou d'eau dont le niveau varie fortement en fonction de la pluviométrie. C’est aussi
la capitale du Boischaut, zone de bocages et d'élevage, et elle est installée au contact de deux régions agricoles complémentaires, au
sud, la région du Boischaut et au nord, le secteur de la Champagne berrichonne (culture de céréales). |
|

Saint‑Amant‑Montrond... Une ville paradoxale où art,
Histoire et mystères se combinent |
|
Au Moyen‑Âge, deux cités se
partagent le territoire du centre :
Saint‑Amand‑le‑Chastel et
Saint‑Amand‑sous‑Montrond qui sont dominées par la forteresse de Montrond, un ancien
château que l’on redécouvre aujourd’hui grâce à une association et qui lutta contre l’armée royale durant la Fronde. Une première
abbaye aurait été fondée par Saint Téodulphe sur une île de la rivière de la Marmande. La cité Saint‑Amand le Chastel se développa
autour de ce monastère fondé au VIIe siècle. Saint‑Amand, disciple de Saint Colomban et évêque
de Maastricht évangélisa la région et vécut une partie de sa vie ici.
On trouve aussi l'église Saint‑Amand, consacrée à Saint‑Amand,
évêque de Maastricht et deux petits châteaux disparus.
L'un est Saint‑Amand le Chastel détruit à la fin du XVIIe. Sous‑fief de la seigneurie de Charenton du Cher, il était le plus
ancien. L'autre est le château du Vernet datant du XIVe et du XVe siècle. Sous‑fief de Montrond, il s'est
illustré lors de la Fronde en 1652. |
|

La Pyramide d'Or... Symbole sacré de la France secrète |
| Cette
commune possède surtout un concentré de particularités, dont il
est difficile, pour certaines, de ne pas les relier à l’affaire
de Rennes :
 La petite commune touche la commune d’Orval…
Le val d’or… La petite commune touche la commune d’Orval…
Le val d’or…
 Elle est considérée comme
le centre de la France Elle est considérée comme
le centre de la France
 Elle abrite
la Tour Malakoff construite par la branche cadette de la plus ancienne maison de
France, la maison Rochechouart. Elle abrite
la Tour Malakoff construite par la branche cadette de la plus ancienne maison de
France, la maison Rochechouart.
 Une forteresse surdimensionnée gardait les terres de Saint‑Amant et des alentours Une forteresse surdimensionnée gardait les terres de Saint‑Amant et des alentours
La
famille des Fouquet semble aussi partie prenante dans
l’administration de la commune. C'est ainsi que l'on peut
constater parmi la liste des maires :
 Entre l’an IV et l’an V, un certain
M. Fouquet administrateur de la cité Entre l’an IV et l’an V, un certain
M. Fouquet administrateur de la cité
 Entre
1792 et 1793, M. Fouquet De Pont Charraud, maire Entre
1792 et 1793, M. Fouquet De Pont Charraud, maire
 Entre
1762 et 1763,
Louis‑Antoine Fouquet Des Babillots conseiller du Roi et maire Entre
1762 et 1763,
Louis‑Antoine Fouquet Des Babillots conseiller du Roi et maire
À titre de
curiosité supplémentaire, Maurice Papon (1910‑2007) condamné en 1998 pour complicité de crime contre l’humanité fut ancien
maire de Saint‑Amand‑Montrond entre 1971 et 1983.
Enfin, et c'est une autre surprise, la commune est
par tradition spécialisée dans la bijouterie, l'orfèvrerie et l’or.
Elle possède notamment un musée très particulier…
La Cité de l’Or… |
|
La Cité de l'Or et sa pyramide
Comme les surprises n’en finissent pas,
voici qu’un repérage plus récent et discret a été mis en place pour préciser le centre géométrique français continental.
En effet,
pour marquer ce point, un édifice particulier a été construit et quel édifice ! Il s’agit de
la plus grande pyramide de France,
toute de verre vêtue, l'une de ses filles étant la célèbre pyramide de verre du Louvre, cette dernière marquant un autre méridien,
le
méridien de Paris…
Cette pyramide est placée très précisément
sur un méridien très discret et marque le centre de la France rectifié à Saint‑Amand‑Montrond. Mais pour mettre en place ce marquage, il
fallait lui trouver une justification crédible et pourquoi pas, rentable. L’idée géniale et très symbolique fut donc de créer un
musée…
Mais comme ici tout est symbole, il fallait un musée approprié. Nous voici donc avec
le musée de l'or, un choix plutôt
décalé en ces temps de crises… |
|

Petite pyramide d'or à côté de la grande... |
|
Le lieu a été baptisé « La Cité de
l’Or »
et le bâtiment égyptien « La Pyramide des Métiers d’Art » . Le site offre à ses visiteurs et invités un ensemble de services comme
un bar, un théâtre, une salle de spectacle, une galerie et même un restaurant. Le musée se veut ludique et à la pointe du progrès tout
en
présentant les métiers de l'or, de la fonte et de l'orfèvrerie...
L’histoire du site est tout aussi rocambolesque
En
1888 : Charles et Auguste
Moricault qui possèdent à Montargis (Loiret) une fabrique de bijoux, bagues, colliers et chaînes, décident d’installer leur fabrique
dans un coin tranquille offrant toutes les garanties de discrétion et de sécurité. En fait de coin tranquille, il s’agit tout de même
d’un lieu hautement historique et très symbolique.
En
1919, Louis Bardary s’associe
avec Dupré pour monter une fabrique de bijouterie au bord de la Marmande. Les ateliers entrent toutefois en concurrence et l'usine
ferme en 1926.
Entre les deux guerres, trois bijoutiers
s’installent à Saint‑Amand‑Montrond. L’activité est capricieuse, mais ils finissent par faire fortune. L’après‑guerre fut faste surtout pour la
bijouterie Saint‑Amandoise. Tous les matins, la Cotterelle fondait selon les chiffres officiels
7 à 8 kilos d’or. C’était le
plein emploi et on travaillait chez soi tout en allant à l’usine le dimanche...
Cet âge d’or se termine brutalement entre
1979 et 1980, la crise de l’or expliquant cela… Suite aux crises économiques des années
1970, les petites fabriques
ferment et les grandes licencient, se restructurent ou sont rachetées.
|
Si l’on fait un rapide calcul, à raison de
7 à 8 kg d’or fondu par jour entre
1946 et
1979, cela fait 365 jours x 7kg soit environ
2,5 tonnes d'or par an,
ce qui représente pour la période glorieuse au total :
2,5 tonnes d'or x 33 ans =
83 tonnes d’or fondu
Question : d’où provenait cet or ? … Une mine
existe non loin, mais pouvait‑elle fournir autant ?
On comprend mieux la toponymie du lieu :
La Cité de l’Or... |
Aujourd’hui, plusieurs entreprises
travaillent l'or et la ville de Saint‑Amand‑Montrond est un important pôle bijoutier français spécialisé dans la fabrication de
mailles en or semi‑massif.
Ouverte au premier trimestre de
l’an
2000 de façon très discrète,
la Cité de l'Or est une
pyramide de verre et d’acier de
34 m de haut et de
4600 m2. Un immense terrain aux aménagements très sobres met en valeur une grande entrée façon égyptienne, bornée par des petites
pyramides éclairantes. Du fait de la couleur foncée des verres, les parois offrent un aspect surréaliste à l’ensemble.
De forme pyramidale tronquée façon
Illuminati, les quatre angles cachent au centre un diamant fictif, une petite pyramide. Au cœur de l’édifice, deux ascenseurs de verre font découvrir aux
visiteurs le musée sur 834 m2 et sa fabuleuse collection de joyaux et d'objets précieux. Espérons que l’alarme est à la hauteur du
lieu… |
| Une pyramide construite par Eiffel
L'idée de la Cité de l'Or est née à l'instigation de la
municipalité de Saint‑Amand‑Montrond et de son Sénateur Maire Serge Vinçon de 1983 à 2007. C'est en 1990 que le Conseil municipal de Saint‑Amand‑Montrond,
alors présidé par Serge Vinçon, décida de la construction et en 1996 les travaux furent confiés à la société
Eiffel sur une création de l'architecte C. Allibert.
Dix ans après le vote du projet par le conseil municipal, la
Cité de l’Or est inaugurée le 17 juin 2000 (et non le
17 janvier) par Serge Vinçon, en présence du Préfet du Cher
Bernard Tomasini. Lors de
l'inauguration le Sénateur Maire Serge Vinçon qualifiait déjà le site de "Pyramide des Hommes et des Métiers" en
axant son développant pour et avec les entreprises de bijouterie et de joaillerie.
Le musée permet
de présenter plusieurs facettes du traitement de l'or :
• Il retrace l’histoire du minerai précieux à travers ses découvertes dans le monde
• Il décrit le travail et les outils
• Il présente les différentes nuances d’or provenant de mélange avec d’autres matériaux précieux ou non,
l’or à
l’état pur ne permettant pas son travail
• Il montre également les poinçons apposés sur les objets
• Il étudie les multiples applications industrielles du fait de ses qualités de malléabilité
et de conductibilité
électrique
• Il expose une collection de bijoux et objets de 1850 à nos jours
En prime une fonte d'or d'environ 500 grammes est exécutée
durant la visite |
|

La coulée de l'or à la Cité de Saint‑Amand‑Montrond |
|
La commune de
Saint‑Amant‑Montrond est peu connue, mais je suis sûr
qu'après avoir dévoilé son caractère très particulier, beaucoup auront envie et la curiosité de découvrir ce lieu, surtout lorsque
l'on sait lire ses symboles et son histoire en parallèle de l'énigme des deux Rennes...
|
|

La Pyramide de Saint‑Amand‑Montrond... Symbole secret et sacré... |
|
Ce méridien très discret est le préalable indispensable à la compréhension de la géographie
sacrée de la France,
une notion que Philippe de Cherisey avait bien perçue...
Il faut revenir sur le méridien de
Paris et la carte de France
pour comprendre... Continuons...
 |
|
|



