|
|
À
partir de
1890,
Bérenger Saunière se mit à collectionner des
cartes postales qu'il aimait trier et ranger, et cette activité le poursuivit jusqu'à la fin de sa vie. Réfugié dans sa
bibliothèque au rez‑de‑chaussée de la
Tour Magdala, il agissait en parfait collectionneur,
classant et archivant les nombreuses images. Pour enrichir sa
collection, il n'hésitait pas à demander à ce qu'on lui envoie des cartes usagées ou neuves. Pour cela, il
n'hésitait pas à publier des petites
annonces diffusées dans des magazines comme « La semaine de Suzette »
Les grands travaux de Saunière et les nouveaux aménagements de son Domaine
offrirent évidemment de nombreux sujets inédits et propices à la carte
postale. Cette passion de l'image et de la photo aurait donc tout naturellement
conduit le prêtre à posséder sa propre collection, un ensemble de
33 photographies qu'il aurait produit lui‑même et qu'il
commercialisa sur place ou par correspondance. Il écrivit même dans une lettre à l'un de ses amis :
|
"Les
cartes postales sont des vues de Rennes‑le‑Château, il y
en a 33 à 0,10 c l'une. Tous les baigneurs prennent la
collection complète. Ces cartes ont un tel succès que je
puis à peine leur en fournir. Ces cartes sont neuves et
ma propriété."
Bérenger Saunière |
 |
|
La collection du prêtre aurait eu, semble‑t‑il, un franc succès auprès des curistes de Rennes‑les‑Bains. Les images offrent non seulement un
souvenir de Rennes‑le‑Château et de la région, mais elles ont aussi une portée religieuse et répondent sans aucun doute à une demande de l'époque.
À cela, il faut ajouter l'existence d'une série supplémentaire de deux petits livrets de
cartes détachables qui auraient été imprimés à la même époque en plus des 33 cartes, des cahiers très rares et pour le
moment inédits.
Longtemps
mélangées avec d'autres photos de l'époque, les 33 photographies
doivent être étudiées séparément. Elles permettent de lister les lieux d'intérêts qu'affectionnait Saunière
dans
son Domaine et aux alentours. Surtout, cette collection offre un témoignage qui n'a subi aucune
manipulation postérieure à
1917.
Elles représentent une source d'information authentique et non
falsifiée pour les chercheurs et les passionnés.
L'observation
du Domaine
fraîchement terminé ainsi que de l'église
Marie-Madeleine et des jardins permet d'affirmer que les scènes
furent certainement photographiées entre
1904
et 1907.
Le thème général est bien sûr religieux. Rien d'étonnant pour une
collection éditée et commercialisée par un prêtre désireux de promouvoir ses restaurations du culte.
On y trouve
l'église Marie‑Madeleine, son porche et le tympan, quelques
statuaires comme Saint‑Antoine de Padoue
ou Saint Jean le Baptiste, le diable accablé par
le
bénitier et ses 4 anges. Il y a aussi la
fresque haut‑relief
de la Montagne Fleurie ainsi que le confessionnal. À l'extérieur, dans
le
jardin de l'église, d'autres aménagements religieux font aussi partie de la sélection comme le
calvaire, les grottes artificielles, ou ND de Lourdes
sur son pilier inversé.
Plus éloigné du culte, le Domaine est aussi largement
représenté avec la
Villa Béthanie et son potager,
le
belvédère, la
Tour Magdala et
son parc, la
Tour de l'Orangeraie. Sur certaines photographies, Saunière pose seul ou avec
Marie Dénarnaud, parfois avec un
parapluie blanc. Nous
verrons d'ailleurs que ce détail a son importance.
Le périmètre
augmente encore avec le château d'Hautpoul
et ses
tours. Enfin, il reste une série d'images difficiles
à intégrer dans la logique de la collection. Il y a
deux vues des
Rochers
de la Rouïre plus connus sous le nom
"Roco‑bert", les cascades du Saoutadou, et enfin
deux vues d'un moulin et de ses annexes... Étrange assemblage, à vrai dire...
Notons également que les cartes postales ne sont pas
numérotées ce qui dénote à priori une volonté de ne
pas proposer un
tri ou un ordonnancement des prises de vue.
Pourtant, nous allons voir qu'au fil de leur analyse certains
détails ne sont par fortuit, voire particulièrement
porteur d'information.
Pour les chercheurs,
l'intérêt principal de ces cartes est évident.
Élaborées vers
1904, date de la fin de construction du Domaine, elles permettent d'avoir une vision précise sur
les
jardins et ses aménagements, l'église Marie‑Madeleine, ou
le château d'Hautpoul. Elles sont aussi une aide essentielle à la reconstitution du
plan du Domaine
dans son exacte proportion, un travail publié sur le site
RLC Archive et qui permit de mettre en valeur sa
géométrie sacrée
et de faire bien d'autres découvertes.
Certaines photos sont célèbres et ont fait le tour des auteurs. D'autres
restent parfaitement méconnues et n'ont eu visiblement aucun succès. Il faut dire que pour certaines d'entre elles, leur esthétique et leur intérêt paraissent discutables.
Or, c'est là que le sujet
devient
intéressant...
Mais avant d'aller plus loin,
dressons l'inventaire de ces cartes ainsi que leur
localisation. Car, si le sujet de la localisation peut paraître
puéril,
certaines cartes ont
demandé beaucoup de travail de recherche afin de
déterminer le lieu exact, notamment
pour l'une d'elles intitulée "Les cascades du
Saoudatou". Fort heureusement, une mémoire locale existe
encore...
Et ce n’est pas tout. La résolution de cette carte
postale a pu enfin clore un long travail d’analyse qui
comporte quelques surprises, notamment autour des photos
sur Roco-Bert et d’une certaine aiguille rocheuse… Eh
oui… Certaines cartes postales ne sont pas innocentes et
véhiculent des messages subliminaux… Il fallait sans
douter… Bérenger Saunière était-il au courant ? Peu
probable…
|
Le Domaine de Saunière
12 cartes postales sont consacrées au Domaine
fraîchement terminé et elles sont très riches
d'enseignement pour ceux qui savent être curieux. Les photos
certainement prises vers 1904 montrent des jardins
tout juste plantés, et le contraste avec les alentours est saisissant. Il suffit d'observer l'aridité des
paysages environnants pour comprendre qu'à cette époque,
la région était très peu boisée. Il faut aussi admirer avec
quel soin les bordures ont été dessinées. Les chemins du
parc sont soigneusement installés et une fine végétation
sert de tracé. Ce sont d'ailleurs ces cartes postales qui
apportèrent une aide irremplaçable à la reconstitution du
plan de référence
du Domaine. Il faut dire que toute la propriété respecte une
géométrie sacrée très précise et la volonté des architectes a
été d'éviter toute ambiguïté dans son élaboration. Il
est aussi amusant de remarquer que la
Tour de l'Orangeraie
était nommée "Vérandha" et que
le belvédère s'appelait "terrasse"...
Bérenger Saunière aime
aussi apparaître sur certaines cartes, mais nous allons
voir qu'il le fait à chaque fois sur des édifices clés
ou des lieux particuliers, une manière sans aucun doute
d'attirer notre attention... Une carte montrant la Villa Béthanie
échappe pourtant à cette règle. Un prêtre pose devant la porte d'entrée
de la Villa et attend qu'on lui ouvre. Véritable mise
en scène, voici certainement le lazariste
Jean Jourde, maître
d'oeuvre du Domaine, tenant des papiers dans les mains,
et laissant discrètement sa
signature dans le jeu de cartes... |

La Tour Magdala et le parc
agrémenté d'une jeune plantation
Le sas d'entrée n'était pas encore installé |
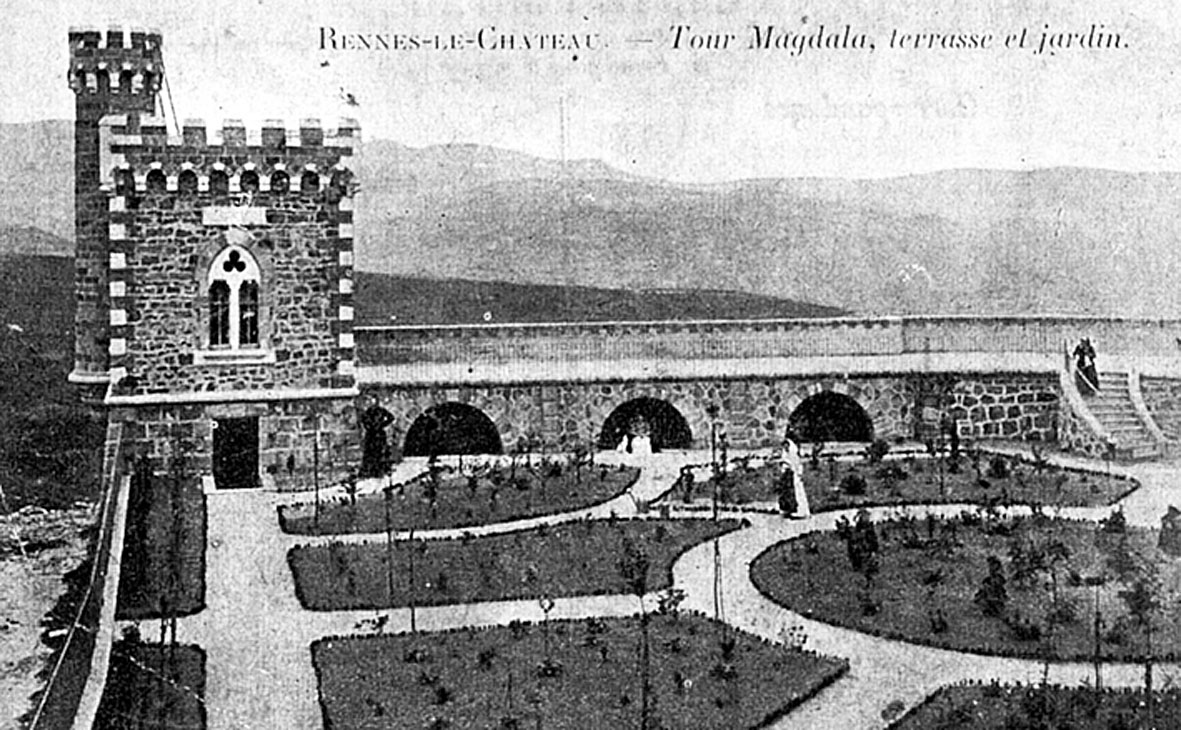
La Tour Magdala et le parc
tiré au cordeau
Saunière pose fièrement appuyé à la Tour Magdala
Marie Dénarnaud, sa mère et Julie Fons sont dans le parc
Photo prise depuis la Villa Béthanie |

Vue sur la Villa Béthanie,
l'église Marie-Madeleine à gauche,
et le château d'Hautpoul au fond. A droite le potager et
ses deux cercles
Photo prise depuis la Tour Magdala |

Une autre vue du potager
circulaire devenu aujourd'hui un jardin restaurant
On peut observer au fond à droite le Bugarach
Photo prise depuis la Tour Magdala |

La Tour de l'Orangeraie est
en cours de montage
et sa tourelle n'existe pas
encore
Photo prise depuis la Tour
Magdala |
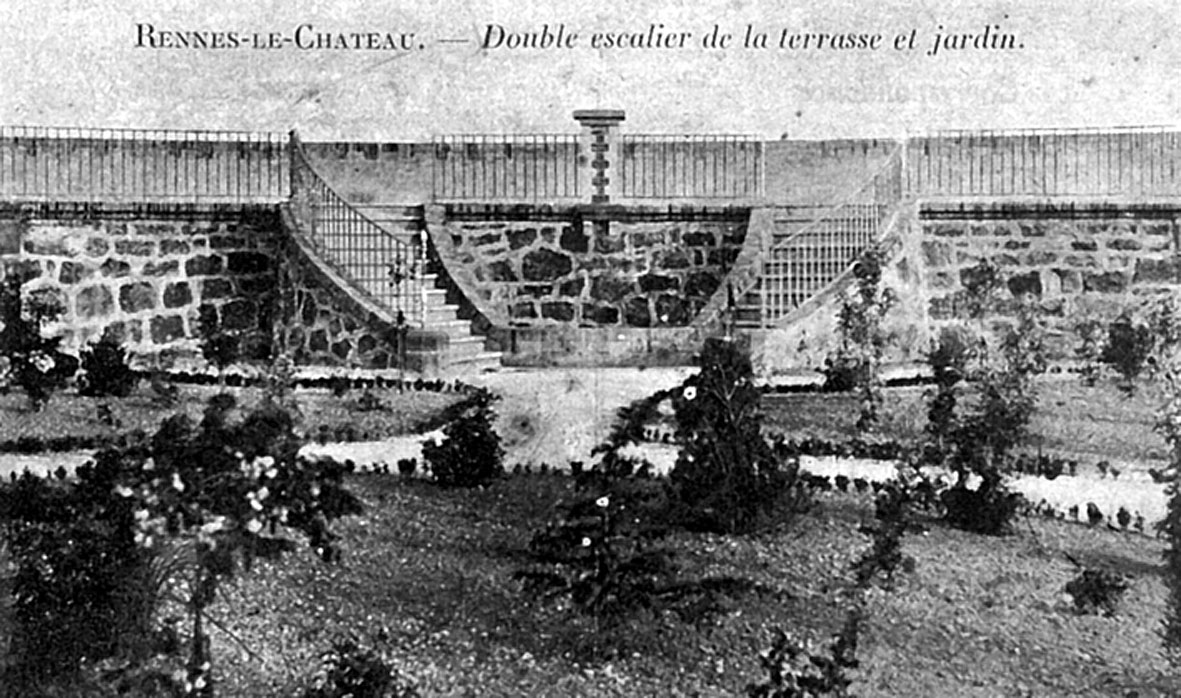
Le double escalier et son
bassin central
La vue donne une idée des
dénivelés considérables qui a fallu entreprendre |

Le belvédère (terrasse), la Tour de
verre (véranda) et la Tour Magdala
vus depuis l'extérieur du
Domaine. A cette époque les ouvertures n'existaient
pas
encore puisqu'elles sont apparues avec Noël Corbu
lors
de l'aménagement de son restaurant "La Tour" |
|
La carte suivante pose question, car elle est plutôt inesthétique. On y voit
un pignon de la Villa Béthanie et le clocher de
l'église. Le titre de la carte est d'ailleurs étrange,
évoquant une vue d'ensemble.
Pourquoi ce choix ? Fallait-il suggérer un aperçu sur le
petit cimetière source de préoccupation de Bérenger
Saunière lors de la restauration de l'église ? Il est vrai que présenter
directement sur une
carte postale le cimetière aurait
été de mauvais goût...
|

Vue sur la Villa Béthanie, l'église
Marie-Madeleine
et son petit cimetière derrière l'enceinte du Domaine |
|
Si les précédentes
cartes postales paraissent anodines, les quatre
suivantes le sont moins. Deux images sont consacrées au
potager circulaire. On y voit
Bérenger Saunière posté près du bassin
central, la première avec son pied sur la bordure,
la
seconde avec un
parapluie blanc, une manière d'attirer notre attention
sur cette construction concentrique atypique. Et pour
comprendre les enjeux, il faut se reporter aux dernières recherches
concernant le plan du Domaine et son positionnement sur
la carte d'État major 1866. En effet, une fois le
Domaine calé sur la carte, le bassin circulaire se pose
de manière très précise sur un lieu
symbolique et sacré de Rennes-les-Bains largement
commenté par Boudet : la Source du Cercle... |
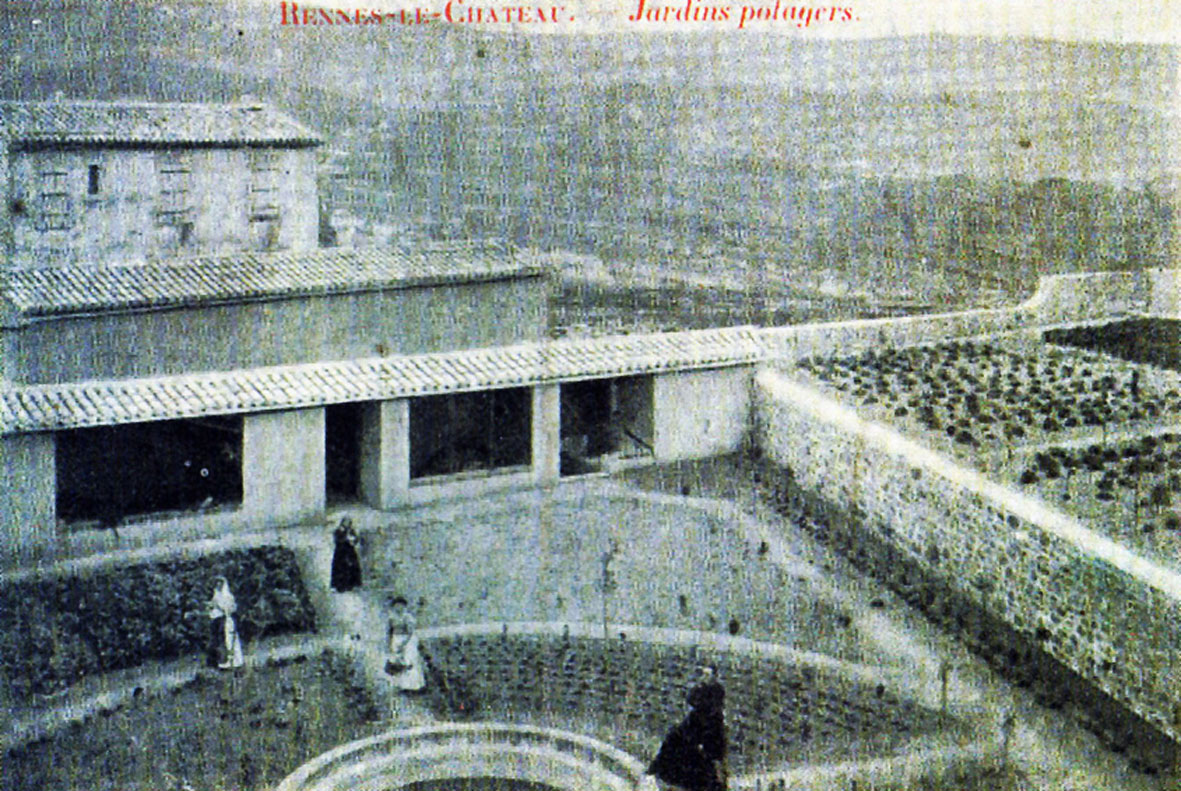
Vue sur le potager circulaire
et le bassin central
Saunière s'affiche fièrement, un pied posé sur le
cercle du bassin,
un bassin qui a toute son importance dans la
cartographie du Domaine...
Il est accompagné de Marie Dénarnaud et sa mère et de
Julie Fons
La photo a été prise depuis
une fenêtre de la Villa Béthanie |
Notons que
la construction d'un potager circulaire n'a absolument rien de
rationnel ni de pratique en matière de culture. Au fil des
ans, le maintien de sillons
parfaitement concentriques lors des
plantations et des coups de bêches demande un travail
important et minutieux. D'ailleurs, il existe à côté
de ce potager
un autre espace maraîcher beaucoup plus classique. Il est
évident que cette mise en forme circulaire avait un tout
autre objectif que celui de rationaliser l'exploitation des plantations... La carte postale suivante poursuit cette
même volonté de nous montrer l'importance du bassin
"La Source du cercle"...
|
Dans le
processus de fixation du Domaine sur la carte
d'État major Quillan 254 datée de 1864, le
bassin circulaire se pose sur La Source
du Cercle à Rennes-les-Bains. D'après
Boudet, cette source représente le centre du
cromlech autour de laquelle deux cercles de
pierre parfaits sont disposés. Le potager trace
effectivement deux cercles concentriques
parfaits façon croix celtique (*) |
(*) Pour plus de détails,
se reporter aux ouvrages "La Rennes d'Or ...là où dort
la Reine" Tome 1 et 2. Voir également les
conférences 2020 sur YouTube |

Vue sur la Villa Béthanie, le
potager circulaire et l'église Marie-Madeleine
Saunière est de nouveau
présent au pied du bassin circulaire
et marque son importance avec un parapluie blanc |
| Les deux
cartes suivantes portent aussi chacune un message. Sur la
première, la Villa Béthanie
vient d'être achevée. Les volets sont clos et un prêtre
en tenue lazariste fait mine de frapper à la porte
d'entrée. Sa main gauche tient des documents. La scène a
bien sûr été préparée pour la photo, et nous avons sans aucun doute
ici celui qui oeuvra dans l'ombre pour que le Domaine
sorte de terre : le
R.P. Jean Jourde. En s'affichant sur une
carte, Jean Jourde signe finalement et très discrètement
la fin des travaux vers 1904, une façon de laisser à la
postérité son empreinte discrète... Il faut avouer que ceci a
bien fonctionné... |

Une des cartes les plus
intéressantes montrant un prêtre lazariste devant
la porte d'entrée de la Villa Béthanie |

Il s'agit sans aucun doute du
R.P. Jean Jourde
posant devant
la porte et tenant dans
sa
main gauche des documents |
La seconde
carte est aussi très symbolique. La
Tour Magdala vient
également d'être terminée et un personnage, tel un
capitaine sur son navire, scrute l'horizon. Il s'agit de
Bérenger Saunière s'affichant en haut de sa tour
et
observant le plateau du Bal des couleurs. Voici le
dernier seigneur de Rennes, tel un nautonier, fier de
son domaine. La mise
en scène est également très évocatrice...
Il est aussi intéressant de noter les tonnes de remblais présentes
au pied de la tour Magdala et qui montrent les travaux
monumentaux qui ont été entrepris à l'époque pour
effectuer le terrassement... |
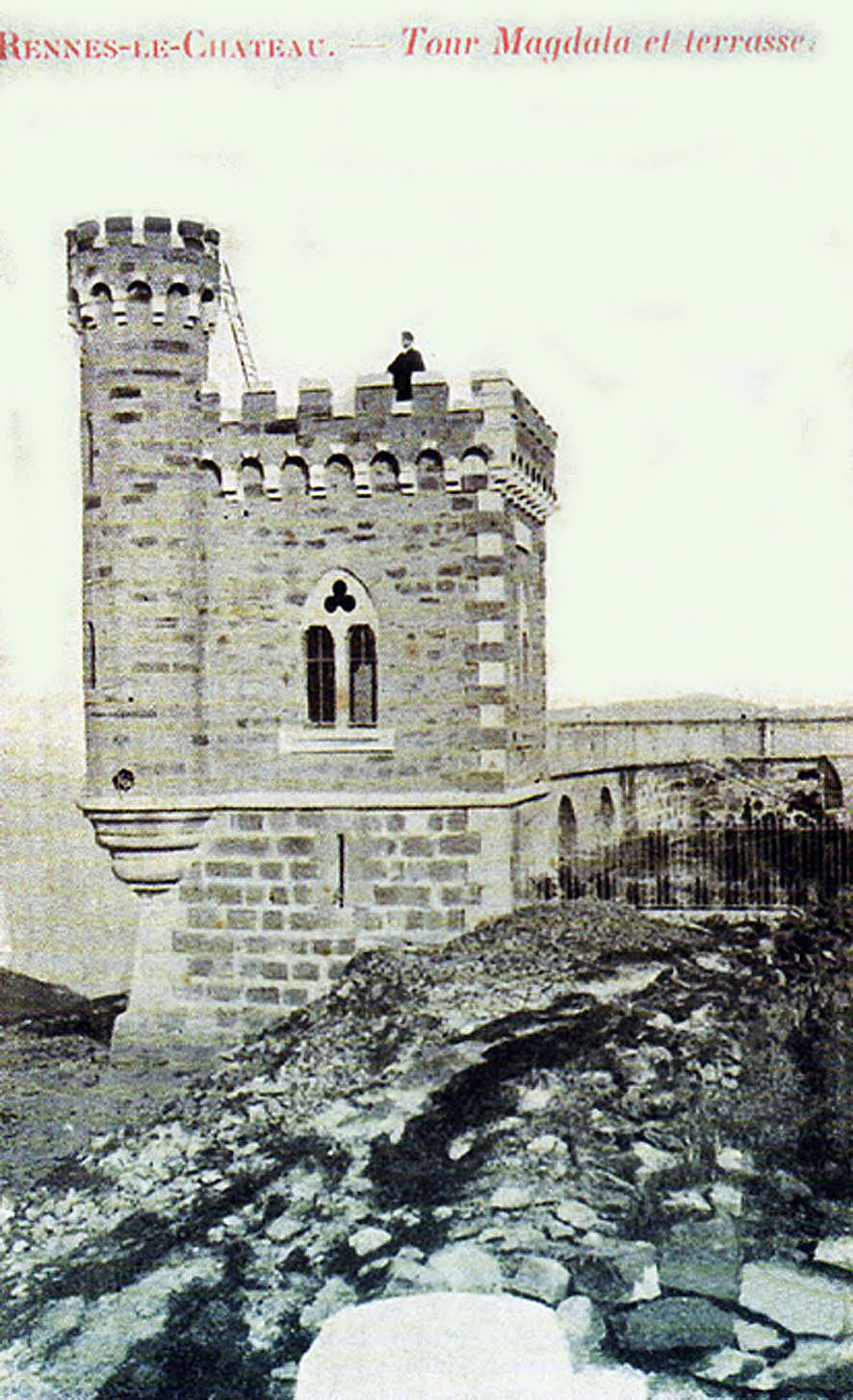
La Tour Magdala et Saunière.
Le remblai présent donne une idée du terrassement très
important
qu'il a fallu effectuer |

Bérenger Saunière est au sommet
de sa tour Magdala et scrute l'horizon
en direction du Sud
et le
plateau
des Bals de Couleurs |
Le jardin de l'église
Quatre
cartes sont
dédiées au jardin de l'église Marie-Madeleine, et deux
sont plutôt redondantes. ND de Lourdes posée sur son pilier
carolingien inversé est en effet présentée deux fois ;
sur la première carte seule, et sur la seconde avec le prêtre. Notons aussi
que ces photos n'ont pas été prises à la même période et
qu'elles sont de qualité différente. Il fallait ici
montrer le fameux pilier de l'ancien autel inversé et qui fut à
l'origine des premières découvertes dans l'église. |
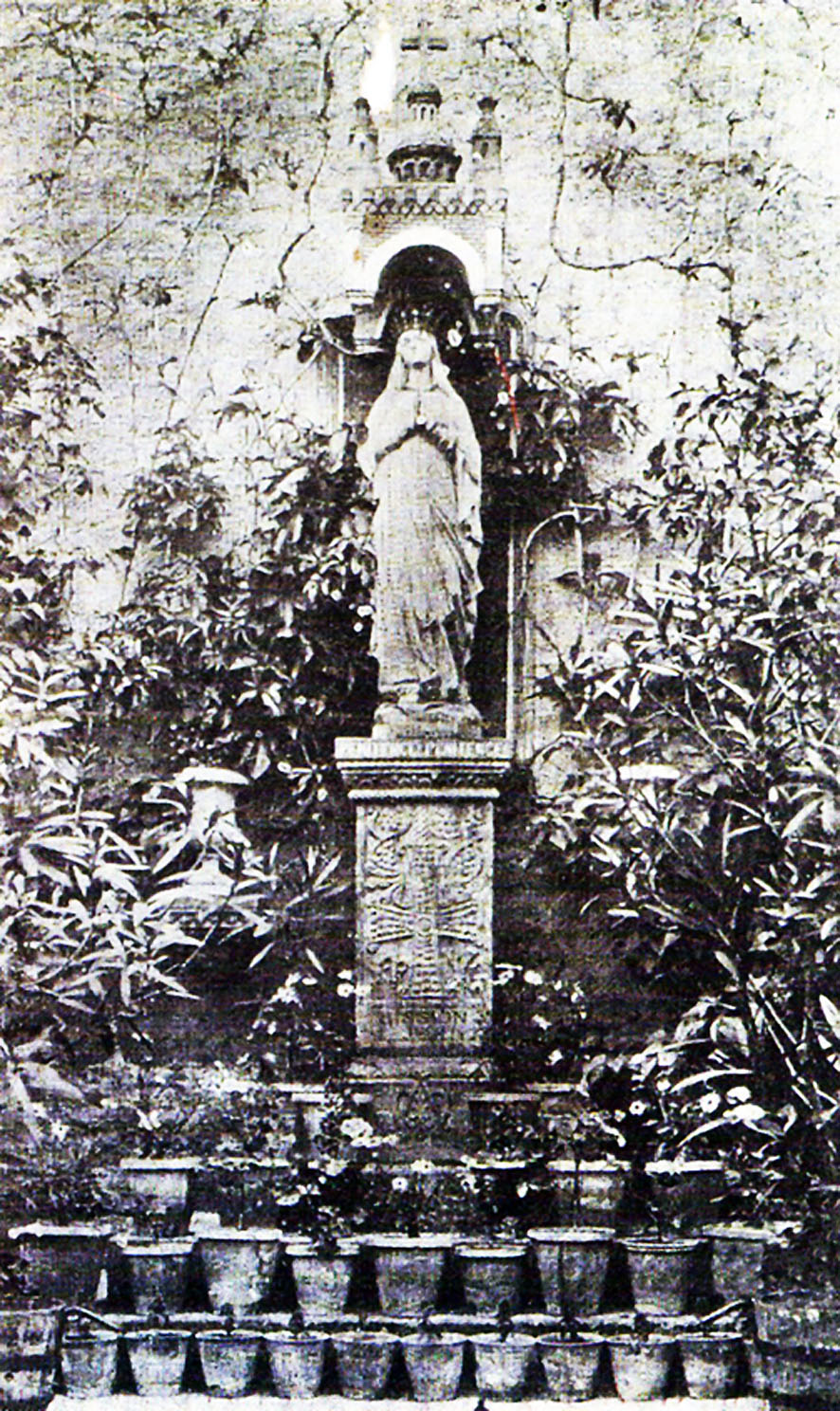
ND de Lourdes
sur son pilier
carolingien inversé |

ND de Lourdes
et Bérenger Saunière |
Les deux cartes suivantes présentent des éléments
fondamentaux du codage du Domaine. La première porte sur
le calvaire situé au centre du triangle équilatéral du
jardin de l'église. La grande croix est installée sur un
socle formant une tour.
|
Dans le
processus de calage du Domaine sur la carte
d'État major Quillan 254 datée de 1864, le
calvaire où plus exactement la tour du calvaire
doit être posée sur la tour d'Arques (*) |
La
seconde carte concerne les grottes
artificielles que Saunière fit construire dans le petit
jardin. La première forme une arche et
s'ouvre sur la seconde, la grotte ronde au banc. Une troisième
grotte non visible sur la photo était sur la droite à la pointe sud
du triangle. Elle a aujourd'hui disparu et il ne reste
que quelques pierres.
|
Le Domaine étant posé sur la carte d'État
major
1864,
la pointe sud du triangle équilatéral montre les
grottes du Bézis "La Cauno" dont l'une possède
un banc naturel... (*) |
(*) Pour plus de détails,
se reporter aux ouvrages "La Rennes d'Or ...là où dort
la Reine" Tome 1 et 2. Voir également les
conférences 2020 sur YouTube |

Le calvaire et la croix installée
sur un socle en forme
de tour |
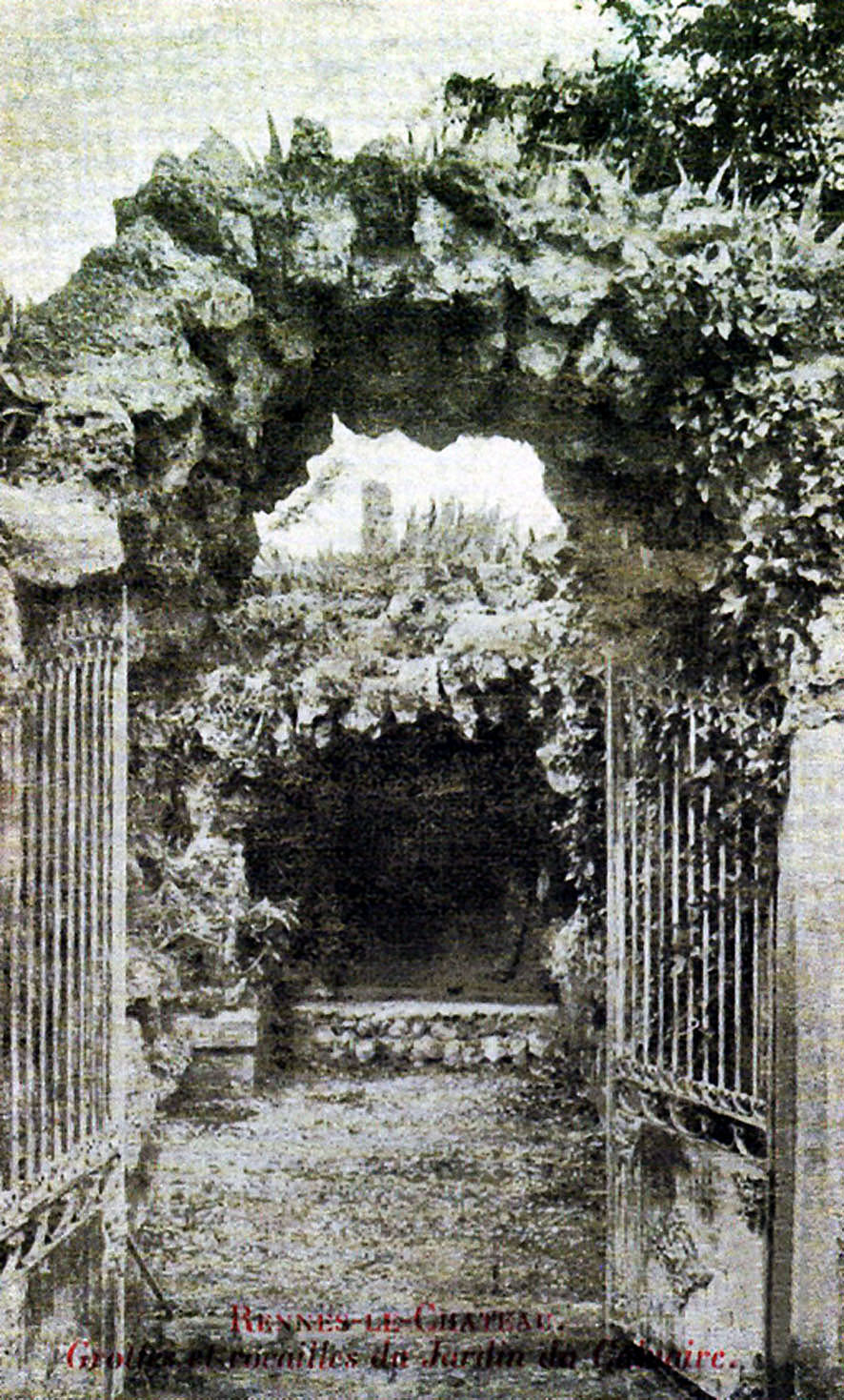
La première grotte arche s'ouvre
sur la seconde grotte au banc |
L'église
Marie-Madeleine
Cinq
photos sont dédiées à l'église restaurée. La paroisse
était la
fierté de Bérenger
Saunière et pourtant le prêtre n'y apparaît pas. Autre
curiosité, un sujet important n'a pas été
retenu : le bas relief Marie-Madeleine.
Il fallut sans doute faire des choix. À la place, le
baptême de Jésus et saint Antoine de Padoue fait partie
du jeu de cartes postales. Il est vrai que Saint Antoine
de Padoue est le patron des objets perdus... |

Le baptême de Jésus
par Saint Jean le Baptiste |

Saint Antoine de Padoue
sur son socle luxueux |
| Les trois cartes suivantes
sont importantes puisqu'elles concernent le
bénitier
avec Asmodée et les quatre anges, la
fresque haut relief "La Montagne fleurie",
et le tympan de
l'église. Chacun de ces éléments porte des codages
différents. |

Le diable Asmodée, le bénitier,
les salamandres, les quatre anges...
un symbole alchimique |

La fresque de la Montagne
fleurie
Il faut noter que le
carrelage en damier
n'était pas encore posé |

Le tympan de l'église
Marie-Madeleine |
Le
bénitier porte un
message alchimique avec les cinq éléments : de bas en haut, la Terre
(le diable, archange déchu), l'Eau (le
bénitier), le Feu (les deux
salamandres), l'Air (les quatre
anges), l'Éther (la croix celtique).
L’eau éteint le feu, le feu
brûle la terre et transforme l’eau en air, or l’air
n'agit pas avec la terre ou avec l’eau, mais ces
principes conditionnent l'Éther...
La fresque de la
Montagne fleurie porte deux codages qui sont les
peintures latérales gauche et droite.
Le tympan
présente Maria de Magdala montrant le
chemin en orientant une croix qu'elle tient à
l'horizontale. Ce chemin se comprend en observant le
Domaine fixé sur la carte d'État major puisqu'elle
pointe les grottes du Bézis... (*)
(*) Pour plus de détails,
se reporter aux ouvrages "La Rennes d'Or ...là où dort
la Reine" Tome 1 et 2. Voir également les
conférences 2020 sur YouTube |
Le château d'Hautpoul
Pas moins de six
cartes postales montrent le château du village.
Était-il nécessaire de présenter toutes les faces de ce
château seigneurial ? Visiblement oui. Il fallait
sans doute insister sur
l'importance de cette édification fortifiée qui a appartenu à la
baronnie des Hautpoul et qui
est très liée à la mystérieuse
stèle de la
marquise de Blanchefort.
Nous voici donc arrivés à cette fameuse
marquise,
dame de Niort et Roquefeuil qui cristallisa pendant
des dizaines d'années l'énigme de Rennes autour d'une mystérieuse pierre
gravée,
sa stèle mortuaire.
Marie de Négri d'Ables fut l'épouse de
François d'Hautpoul, dernier seigneur de Rennes‑le‑Château.
Les recherches historiques ont montré aussi qu'il y eut
un procès retentissant entre
Blaise d'Hautpoul
et Nicolas Pavillon,
évêque comte d'Alet; le baron se plaignant que des gens du roi
Louis XIV foulent ses terres...
Ce procès long et complexe se
terminera à Grenoble en avril
1666
à l'avantage de Nicolas Pavillon, mais après que le Roi
cassa les jugements en faveur de l'évêque. |

Vue ouest du château de
Hautpoul
Photo prise depuis le clocher
de l'église Marie-Madeleine |

Le château vu côté nord |

Le château et ses ruines |
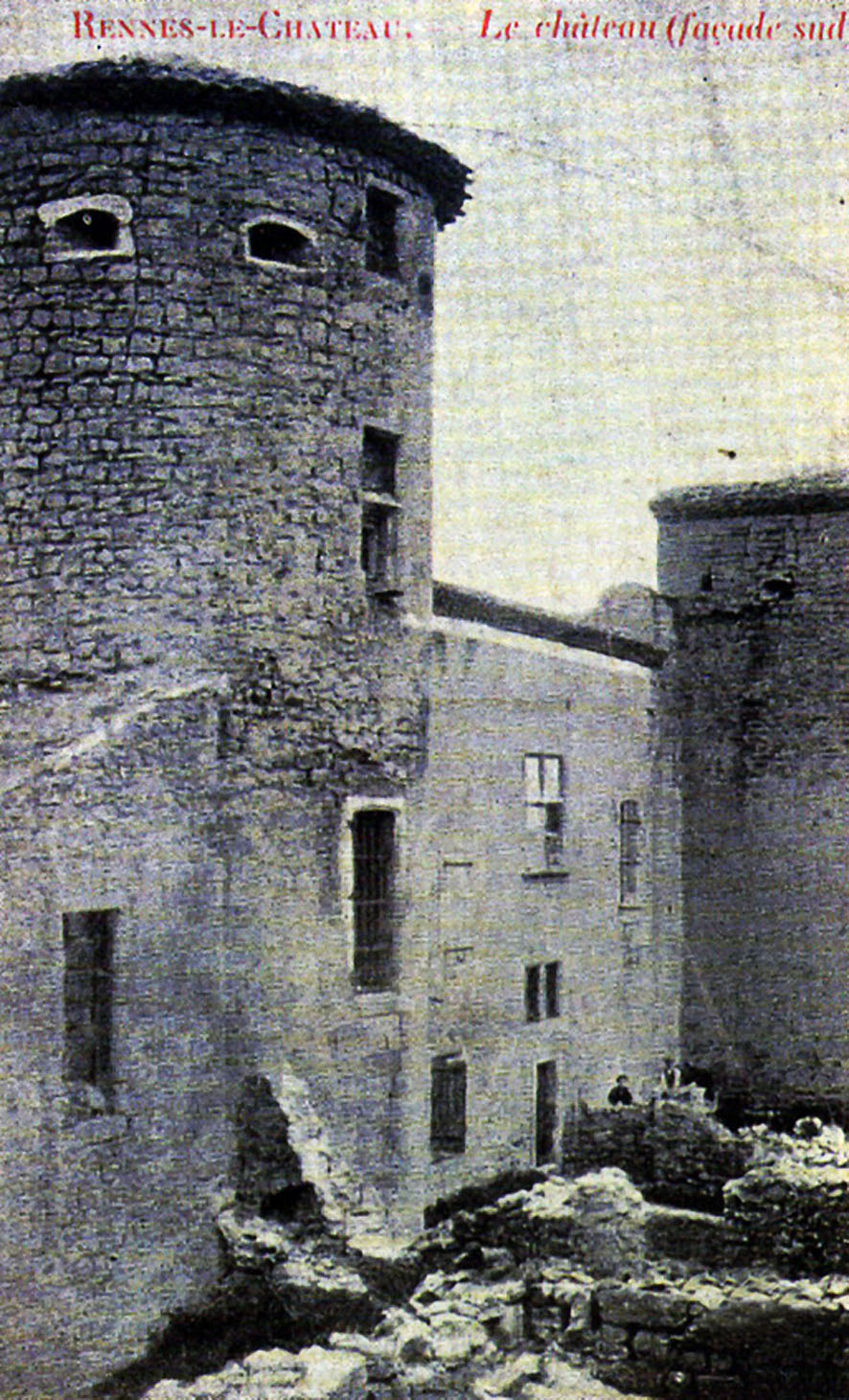
Le château côté sud
|

Le
château côté sud à midi |

Le château d'Hautpoul sur sa
face nord-ouest |
Rennes-le-Château
Il
n'existe qu'une seule carte postale montrant le village
de Rennes-le-Château dans son ensemble, et le moins que
l'on puisse dire c'est que le choix de la vue n'enchante
pas. En effet, la face nord-est ne met en valeur ni le
Domaine ni le château ni l'église. La
Tour Magdala et la
Tour de verre sont absentes et la photo ne montre aucun
point d'intérêt particulier.
Pourquoi ce choix ? Voulait-on montrer
l'aspect rude et isolé du village ? |
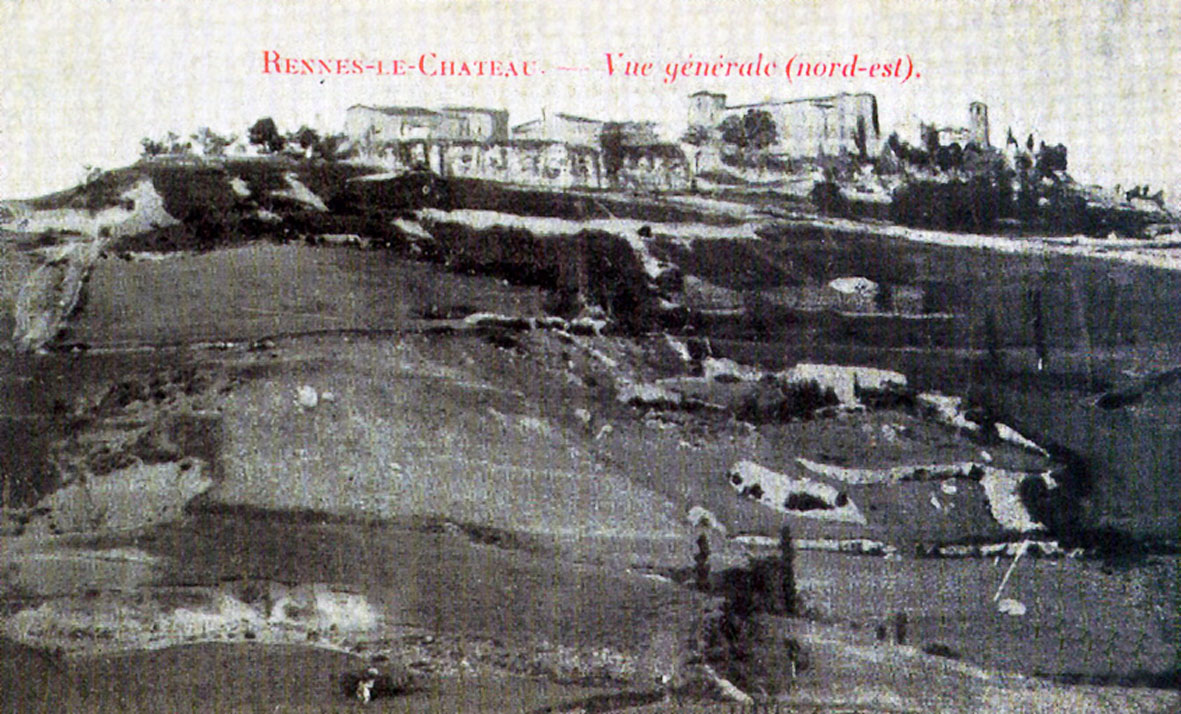
Vue nord-est de
Rennes-le-Château |
Pourquoi diable
Saunière a‑t‑il choisi de présenter certaines vues
avec un si faible intérêt pour les paroissiens, les
curistes et les visiteurs ? Les sujets ne manquent
pourtant pas autour de Rennes-le-Château. Bérenger
Saunière aurait pu choisir l'étonnant bas‑relief
Marie‑Madeleine
de son église,
ou la superbe vue du plateau des Bals de Couleurs
depuis le belvédère, ou bien encore les ruines de Coustaussa et le Cardou. Il aurait même pu réserver une carte montrant
la Sals ou les
thermes de Rennes‑les‑Bains. Et s'il fallait montrer une montagne caractéristique, pourquoi ne pas avoir
choisi un cliché du Bugarach plutôt que
la petite chaîne dentelée des Rochers de la Rouïre
nettement moins connue ?
L'ensemble de
ces cartes postales semble à première vue normal, mais à
y regarder de plus près, des curiosités apparaissent.
L'incohérence de la sélection montre toute sa pertinence et
les auteurs qui ont depuis longtemps présenté cette collection comme parfaitement anodine pourraient avoir des surprises.
Or, nous allons voir que les cartes suivantes sont
beaucoup moins banales... |
Le moulin et ses
dépendances
Les
deux cartes suivantes ont nécessité beaucoup de
recherche pour retrouver le lieu exact du moulin.
Sur la première, on peut découvrir un paysage plutôt aride et
deux bâtisses reliées par un chemin. Sur le coteau
gauche, des vignes sont probablement cultivées. Le
titre donne une indication : "Vue du moulin et de
ses dépendances". Mais où est donc situé ce
moulin ? |
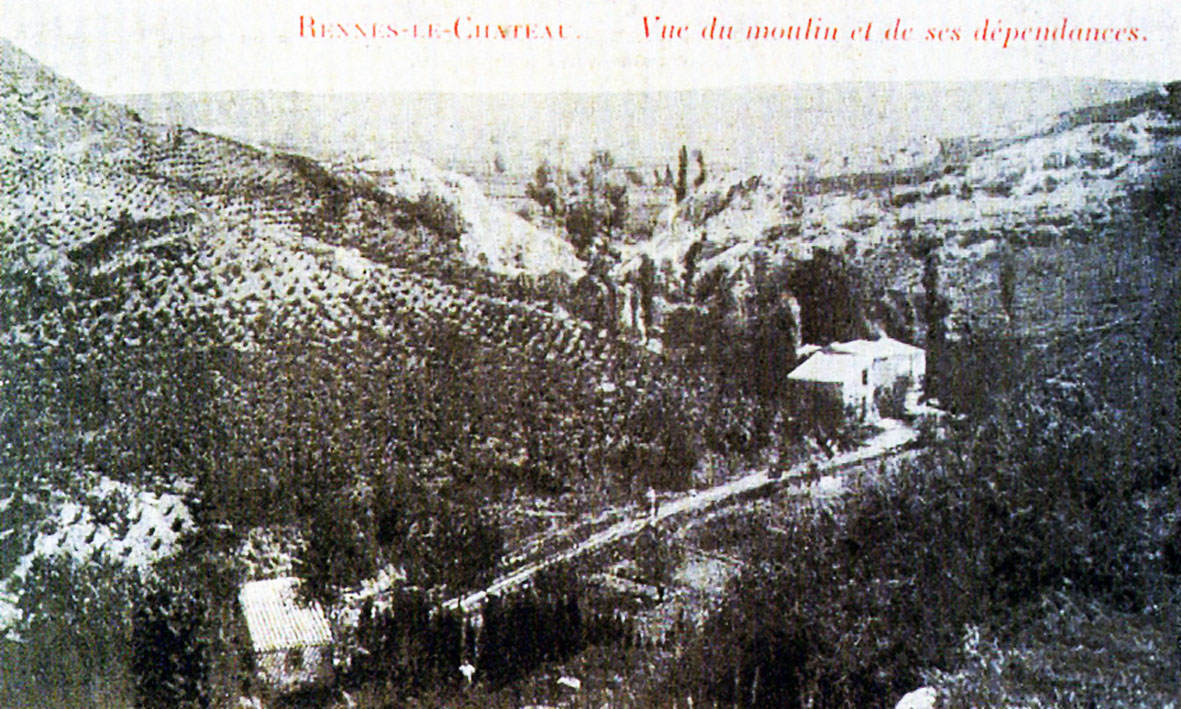
Vue du moulin dans son
ensemble |
| La seconde carte postale
zoom
sur la bâtisse principale, et cette
indication suggère que le concept de moulin est
important. Notons d'ailleurs que "Moulin" porte ici un
M
majuscule. Nous verrons d'ailleurs que
ce procédé consistant à présenter deux cartes d'un même
sujet est appliqué sur un autre lieu très symbolique. |
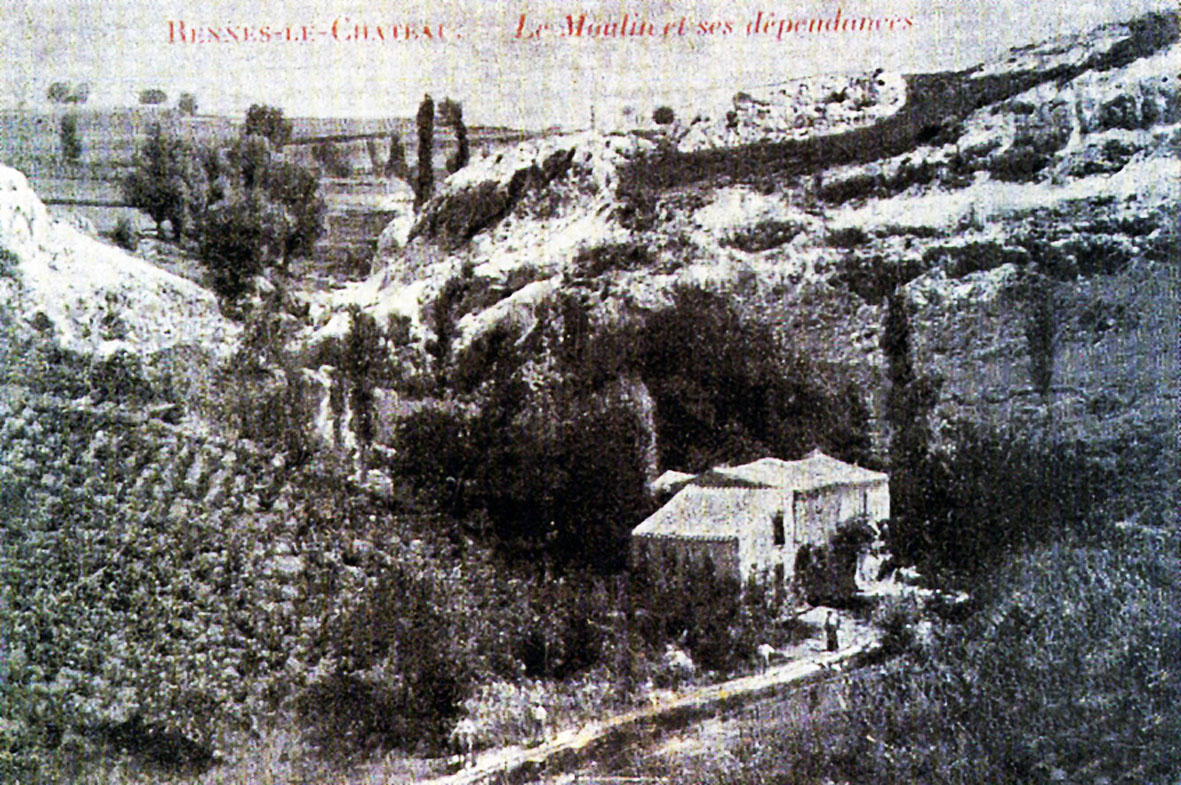
La seconde carte est un zoom sur le
"Moulin" |
| La présence
d'un moulin au creux d'une vallée implique
le passage à proximité d'un ruisseau ou d'un cours
d'eau. Or, il existe au sud de Rennes-le-Château, au
bord du ruisseau "Les Bals de Couleurs", les ruines d'une ancienne
construction accompagnées de plusieurs aménagements. Ce
vestige est confirmé sur la carte IGN par la mention "Moulins
Ruines". |

Le moulin de la carte postale est situé au sud de
Rennes-le-Château
et le long du ruisseau de Couleurs |
| Alors que la
carte postale présente un paysage aride parsemé de
quelques résineux isolés, le site est aujourd'hui
couvert d'une véritable forêt. Le ruisseau se cache
au fond de la vallée.
Il faut alors se rendre sur place pour espérer trouver
les ruines du moulin. |

Le site du moulin aujourd'hui
méconnaissable au sud de
Rennes-le-Château |

Le ruisseau "Les Bals de Couleurs" |

Les ruines ne sont plus très
loin... |
| Le site est
entièrement abandonné et le ruisseau se
transforme à certains endroits en marécage ou en eau
stagnante. Les coteaux sont couverts d'une garrigues
épaisse et il est difficile de croire qu'il existait ici
des cultures. |

Le ruisseau sous une
végétation dense |

Un coteau aujourd'hui
abandonné |
Caché sous
les arbres et les ronces, le moulin était bien là comme
le témoignent quelques murs de pierre encore vaillants. On
peut même y découvrir l'ancien tunnel voûté où était logée
la roue, une citerne,
et quelques aménagements, preuve que le temps
et la végétation n'ont pas terminé leur digestion.
Depuis des siècles, des dizaines de moulins à eau ont été édifiés
dans les Pyrénées au fil des torrents et des
rivières, utilisant la force motrice naturelle pour
moudre le seigle, le maïs, le blé ou les noix.
Malheureusement, ils furent progressivement abandonnés
au cours du temps. |

Les ruines du moulin |

Des murs sont encore debout |

La bâtisse principale |

Les ruines du moulin |

Il reste encore quelques
infrastructures |

Le tunnel voûté protégeant la
roue |

Les linteaux sont encore en
place |

Une citerne voûtée |

Quelques traces d'aménagement |

Restes de ferronnerie |
Le moulin trouve un
écho aux Pontils
En
suivant le raisonnement consistant à déterminer les
indices qui se cachent derrière chaque carte postale,
nous voyons ici que la notion de "moulin" est importante
confirmée par la présence d'un zoom sur la seconde carte. Or, il
existe un autre moulin qui occupe largement l'énigme de
Rennes. Ce
dernier est situé au lieu-dit "Les Pontils",
là où se trouvait le fameux
tombeau arcadien des
Pontils inspiré des
Bergers d'Arcadie de Poussin, là où à 250 m court le
méridien de Paris, là
où la vallée du Bézis ouvre ses portes
vers la Voie sacrée...
Et comme pour commémorer ce moulin des Pontils, une borne placée en face du
promontoire du tombeau indique clairement : "Le
Moulin"... Avec un M majuscule... |

Le lieu où se trouvait le
tombeau des Pontils est borné "Le Moulin" |
Ce moulin des Pontils existait-il du temps de Saunière ?
La réponse est oui, et depuis fort longtemps. En effet,
un ancien cadastre rapporte
qu'un moulin à blé était situé sur la
rivière "Le Rialsesse" et appartenait à
Mgr le duc de Joyeuse.
Nous sommes alors au XVIe siècle...
Le duc de Joyeuse,
en fait
Anne de Joyeuse,
est le plus représentatif des membres de la maison de Joyeuse,
filleul du connétable Anne de Montmorency. Il était
baron d'Arques, baron héréditaire de Languedoc,
vicomte, et duc de Joyeuse, dit Joyeuse, né en
1560 sans doute au château des ducs de Joyeuse à
Couiza. |
Autre question :
le
tombeau arcadien
existait-il du temps de Saunière ? La réponse est non
puisqu'il n'a été érigé qu'en 1931. Alors
pourquoi les deux cartes postales feraient-elles référence
aux Pontils à l'époque de Saunière ? Il faut savoir que
le lieu comportait déjà sur son promontoire un tombeau
accompagné d'une dalle précieuse. Ceci nous le tenons d'un ouvrage du
XVIIIe
siècle de l'abbé Delmas et
qui cite ce tombeau avec sur sa face nord une pierre verticale
portant la devise : "ET IN ARCADIA EGO".
Le caractère sacré du promontoire était donc connu
depuis fort longtemps... Cette dalle qui aurait été amenée en 1789 depuis
Serres à Rennes-le-Château serait devenue la fameuse
dalle de Blanchefort
N'oublions pas non plus que
tout près des Pontils se trouve la grotte de
Téniers, une grotte dont le
profil a été très exactement reproduit sur le tableau de
Saint Antoine "Les 7 péchés capitaux" (*) vers
1670
(*) Pour plus de détails,
se reporter aux ouvrages "La Rennes d'Or ...là où dort
la Reine" Tome 1 et 2. Voir également les
conférences 2020 sur YouTube |
Les Rochers de la Rouïre
dits "Roco-Bert"
Voici
la seconde paire de cartes postales dont l'une est un
zoom, signe d'un autre message important. Comme pour le
moulin, ce
montage prouve qu'il s'agit d'un jeu de piste
qu'il faut interpréter et suivre. Les deux cartes
postales affichent une partie remarquable de
la crête rocheuse appelée "Roco-Bert" ou
Rochers de la
Rouïre. Cette dentelure grise très particulière est nettement visible au
loin depuis Rennes-le-Château en observant le paysage
plein sud. |

La chaîne des Rochers de la
Rouïre
comme si on la regardait de près depuis Rennes-le-Château |
| Il est d'ailleurs étonnant d'observer comment la végétation
s'est développée depuis plus d'un siècle. Aux pieds des Rochers
de la Rouïre, une très importante forêt recouvre aujourd'hui
tout le secteur du bois du Lauzet et la partie
inférieure nord de la crête a littéralement disparu sous
les arbres... |

Les Rochers de la
Rouïre aujourd'hui |
| Où se trouvent
exactement les Rochers de la Rouïre ? La fracture
dentelée fait partie d'une longue crête
rocheuse bordant l'immense forêt "Les bois
du Lozet" et se termine à l'Est
par la Pique de Lavaldieu, point
remarquable puisque situé sur le cercle circonscrit du
Triangle d'Or des
Bergers
d'Arcadie. Roco-Bert est aussi très proche de
la fontaine des Quatre Ritous, une
source qui alimente le ruisseau du Carla. |
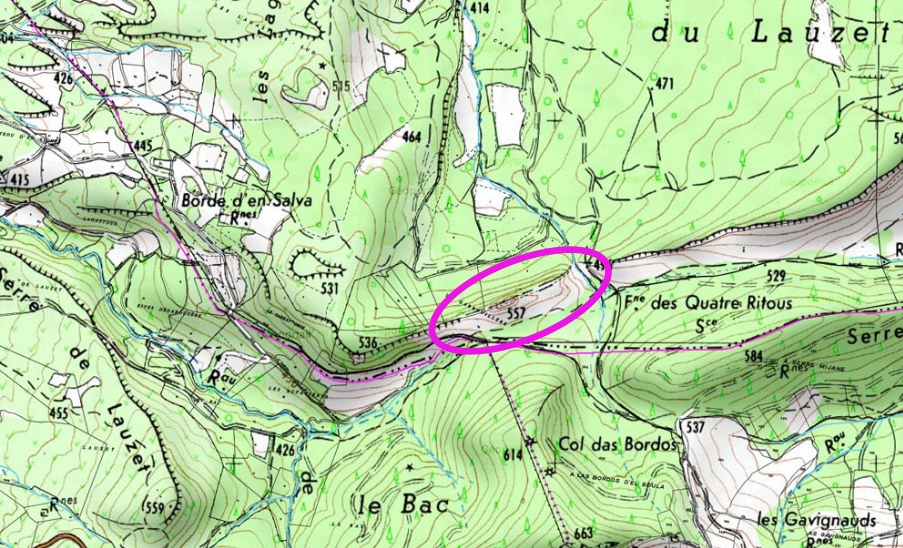
Localisation des Rochers de la
Rouïre sur la carte IGN Quillan
au sud de Rennes-le-Château |
La seconde carte
postale zoom sur un détail de la crête rocheuse
Roco-Bert.
À ce stade, il convient donc de
comprendre ce que l'on veut nous montrer... |
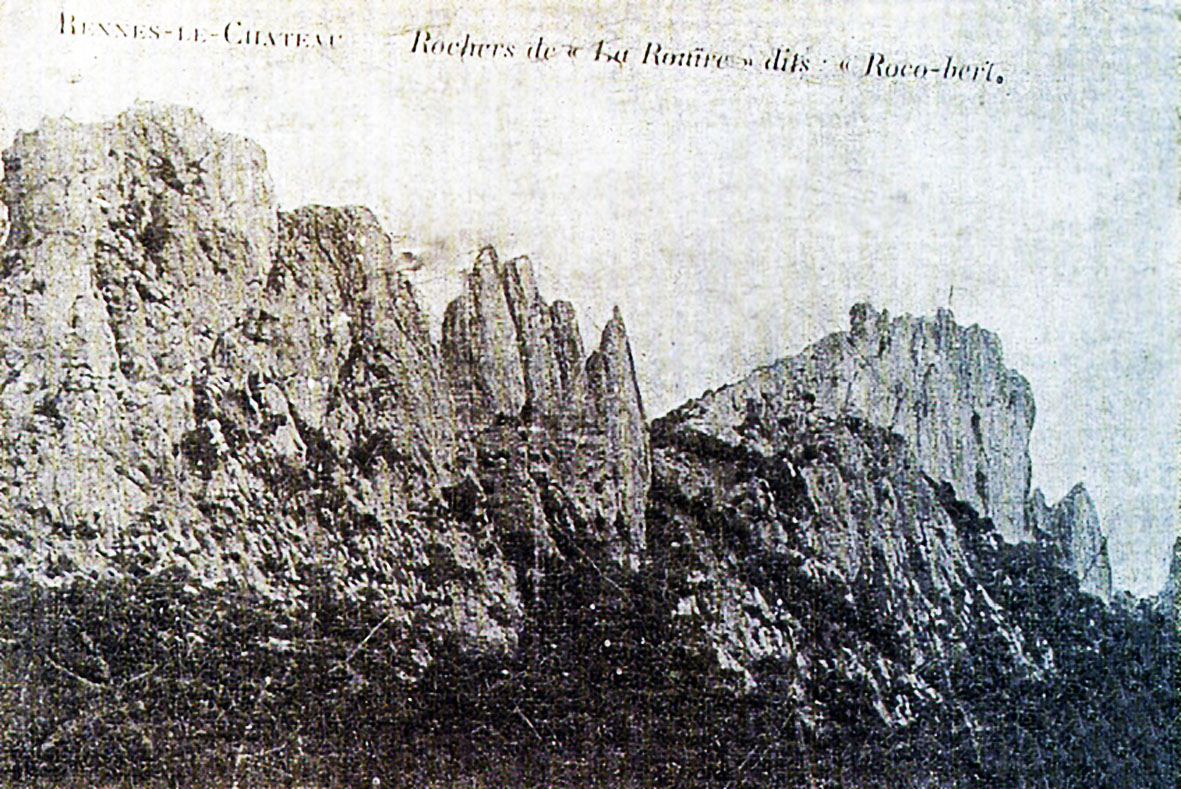
Zoom sur la chaîne des
Rochers de la Rouïre |
| Déterminons le centre de la
carte postale en traçant les diagonales et examinons le
détail central... |

Zoom sur la chaîne des
Rochers de la Rouïre
Une aiguille rocheuse trône
exactement au centre de la carte postale |
| Le photographe a visé
avec précision une roche très particulière... Une
grande aiguille. S'il faut bien reconnaître que l'image
noir et blanc met peu en valeur cette curiosité
géologique, la roche observée sur place ne fait plus aucun doute. Il s'agit d'une très
belle aiguille qui se détache du reste de la chaîne
rocheuse. |

Zoom sur la chaîne des
Rochers de la Rouïre
Une très belle aiguille trône
exactement au centre de la carte postale |
Nous avons
donc ici une volonté manifeste de nous montrer un détail
important, une aiguille ressemblant étonnamment à celle
du Bézis. L'intention serait
donc d'interpeller les curieux, les initiés et les
érudits, eux seuls pouvant
établir un lien avec "L'Aiguille creuse" de
Maurice
Leblanc et l'Aiguille du
Bézis... (*)
(*) Pour plus de détails,
se reporter aux ouvrages "La Rennes d'Or ...là où dort
la Reine" Tome 1 et 2. Voir également les
conférences 2020 sur YouTube |

Zoom sur la chaîne des
Rochers de la Rouïre
Une magnifique aiguille trône
exactement au centre de la carte postale
Il s'agit de l'Aiguille Roco-Bert |
Rochers et cascades du
"Saoutadou"
Voici
enfin l'analyse de la dernière carte postale qui resta longtemps sans réponse
à propos de sa localisation. Le lieu aurait-il disparu ? A-t-il été transformé ? Urbanisé ? Est-il éloigné de
Rennes-le-Château ? Certains chercheurs iront même
jusqu'à démontrer que le lieu de la cascade du Saoutadou est très
près de Brénac à 10 km au sud-ouest du village de
Saunière.
S'il existe bien une belle cascade à Brénac, la
chute d'eau et les roches ne rappellent en rien la scène
photographique. Il est vrai que le
terme "Saoutadou" a disparu des
toponymies locales
compliquant furieusement les recherches.
La
solution est en réalité beaucoup plus simple. Après des années de recherche et
de nombreuses hypothèses, la
confirmation du lieu vint finalement d'un enfant du
pays... |
Je veux remercier ici Rémi
qui aida très fortement à la localisation de cette carte
postale... |

Rochers et cascades du "Saoutadou" |
|
Le mot « Saoutadou » n'est pas
propre à ces cascades puisque l'on retrouve cette
appellation dans de nombreux lieux en France. Il
désigne simplement un « saut » ou une chute d’un
cours d’eau, naturelle ou artificielle. On trouve
par exemple le ruisseau de Saoutadou traversant
Marsa et Quirbajou dans l'Aude.
Deux personnages sont mis en scène
sur la carte :
Bérenger Saunière
se tenant assis sur un rocher avec son
parapluie blanc, et
le second debout sur la berge. Les cascades sont
composées de deux chutes d'eau visibles au centre de
la carte. En arrière-plan et surplombant les
cascades, un chemin traverse le
site. |

Saunière et un autre
personnage posent sur la carte (cercles magenta)
Les cascades se composent de deux chutes d'eau (cercles
bleus) |
|
Où a été prise la
photo ?
Il fallut
beaucoup de persévérance et de patience pour enfin
pouvoir repérer le lieu et comparer le paysage réel avec
la scène photographiée. Après plus d'un siècle
d'écart, les
chances de retrouver un tel site étaient minces et les
seuls éléments pouvant valider la recherche sont les
gros rochers, en supposant que ceux-ci n'aient pas été
déplacés, enterrés ou cachés sous la végétation.
C'est finalement au sud de
Rennes-le-Château que l'endroit exact a été retrouvé. La photo a été prise
au bord du ruisseau "Les Bals de
Couleurs" dans un secteur aujourd'hui
interdit et réservé au captage et au pompage
des eaux pour la commune. |

La photo a été prise dans un
secteur devenu aujourd'hui une station de captage
pour la commune de Rennes-le-Château, non loin des ruines
du moulin
La flèche indique la direction de la prise de vue |
|
Le lieu extrêmement bucolique
est aujourd'hui envahi par une végétation
dense qui empêche d'observer les roches et les berges.
L'eau est toutefois moins présente qu'il y a un siècle, mais
elle continue d'alimenter les cascades et les larges étangs. |

Les cascades du "Saoutadou"
se cachent dans le ruisseau "Les Bals de Couleurs" |
|
C'est en
remontant le ruisseau "Les Bals de Couleurs"
en amont que le site des cascades du "Saoutadou" se
révèle. La petite rivière prend un léger virage dans
une gorge et descend plusieurs niveaux produisant
deux cascades. |

Le site des cascades du
"Saoutadou" aujourd'hui, envahi par la végétation
Saunière se tenait assis à gauche sur les roches |
|
Du fait de la végétation et du
manque d'eau aujourd'hui, le site est moins
reconnaissable, mais les roches importantes sont
toujours présentes et les chutes d'eau coulent
toujours.
En arrière-plan, derrière les arbres, l'ancien chemin
existe encore. En comparant les photos, on
s'aperçoit vite que le ruisseau était plus large
créant une vaste retenue d'eau après les cascades. |

Les cascades du "Saoutadou"
aujourd'hui |

Le même site du temps de
Saunière
Le niveau d'eau était plus élevé |

Le ruisseau "Les Bals de
Couleurs" |
 Le site des cascades en aval
Le site des cascades en aval |
|
La localisation de cette
dernière carte postale confirme les dires de
Bérenger Saunière à savoir que...
|
"Les
cartes postales sont des vues de Rennes‑le‑Château, il y
en a 33 à 0,10 c l'une. Tous les baigneurs prennent la
collection complète. Ces cartes ont un tel succès que je
puis à peine leur en fournir. Ces cartes sont neuves et
ma propriété."
Bérenger Saunière |
|
Une curiosité
étonnante...
S'agit-il
d'un montage volontaire pour attirer l'attention ou
d'une simple coïncidence ? Le fait est qu'il
existe un tracé
topographique remarquable autour des cartes postales
Roco-Bert et Saoutadou. La
démonstration est facile à mettre en oeuvre sous
Google Earth. Il suffit de tracer un axe entre la
Tour Magdala et l'Aiguille
de Roco-Bert pour constater que cet axe
traverse très exactement les cascades du
"Saoutadou"... |

L'axe Tour Magdala - Aiguille
Roco-Bert traverse exactement
les cascades du "Saoutadou"
(image Google Earth) |

L'axe traverse exactement
les cascades du Saoutadou |
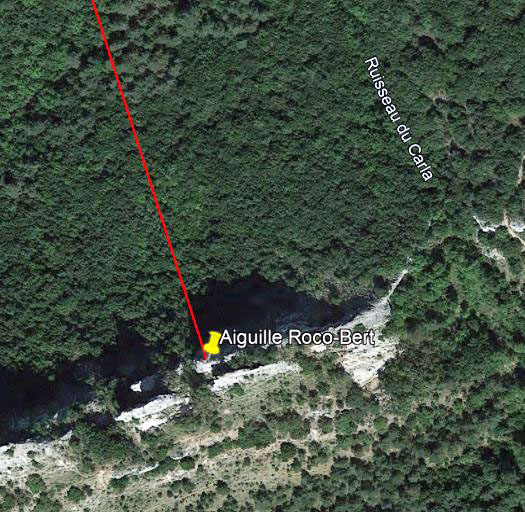
L'axe est exactement posé sur
l'Aiguille Roco-Bert |
|
La rareté de
ces cartes postales est aussi un élément à prendre
en compte. Comme l'affirme Saunière, le jeu se
vendait bien. Il est donc naturel de supposer
qu'avec le temps certaines photographies auraient dû
se retrouver sur le marché de la carte d'occasion,
affranchies d'un timbre de l'époque, ou parmi les
collectionneurs d'images anciennes. Or, rien. Tout se
passe comme si les acquéreurs avaient précieusement
conservé ces cartes pour leurs archives personnelles.
La question rejoint donc celle de Boudet à propos de
la diffusion de son livre codé "La Vraie Langue Celtique". Les ventes auraient‑elles ciblées des personnalités influentes, des érudits ou des notables ?
Autre interrogation : ces cartes postales ont elles vraiment été produites par
Bérenger
Saunière ? La question mérite d'être posée. Dans un contexte où tous les codages du Domaine furent mis en place par une autorité
lazariste ayant guidé le prêtre, l'hypothèse d'une production différente de Saunière est loin d'être absurde.
L'une des pistes consiste à rechercher
l'auteur et le dépositaire des droits d'images de ces cartes. Il s'agit de
Michel Jordy, un photographe
archéologue et amateur d'art. Connu dans le milieu de la carte postale, on trouve son nom sur certaines anciennes
photos
comme ici, sur une vue de Carcassonne. |
|

Ancienne carte postale du même
éditeur M. Jordy |
|
MICHEL JORDY
(1863‑1945)
ARCHÉOLOGUE ET PHOTOGRAPHE
Amateur
d'art, historien et archéologue, fondateur en
1911 de l'Hôtel de la cité, Michel Jordy se livra
pendant plus d'un demi‑siècle à des recherches dans le monument dont il entendait prouver l'origine romaine.
Il est l'auteur d'une "Histoire de la cité de Carcassonne" restée inédite. Il s'en fit aussi le photographe,
lui consacrant sa vie et œuvrant pour son rayonnement. Ses clichés surprennent par leur abondance et par
la répétition des angles de vue. Pour Michel Jordy, il s'agit de capter "la parole des pierres", de
rendre compte des variations qui, dans les jeux de lumière et les changements de saisons, affectent de façon
plus ou moins perceptible le monument... |
 |
|
Passionné par Carcassonne, il aimait aussi photographier des sites
archéologiques de l'Aude comme ici, le château de Thermes...
Le château de Termes, situé en territoire Narbonnais, à
cinq lieues de Carcassonne, était d'une force étonnante et incroyable.
Il semblait humainement
tout à fait imprenable.
Pierre des Vaux de Cernay, vers 121
|
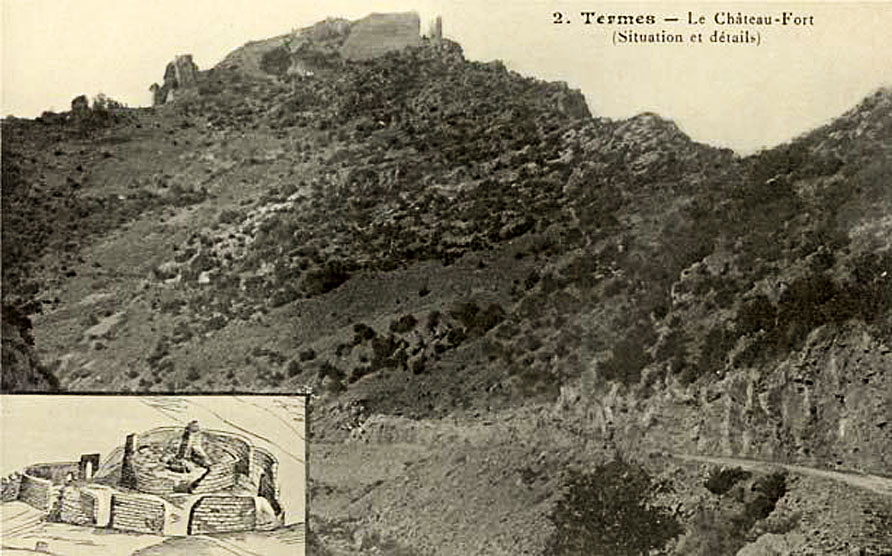
Le château de Termes (Aude) ‑ Édition
M. Jordy |
|
Saunière a‑t‑il demandé
les services de Michel Jordy pour éditer ses
33 cartes postales
? Qui décida des sujets à photographier ? Un rapide calcul permet d'observer que Michel Jordy avait environ 41 ans lorsqu'il édita les
photographies de Saunière entre
1904 et
1906. Était‑il aussi le photographe ?
Un dernier point
reste à évoquer et pas des moindres.
Michel Jordy était également
franc‑maçon à l'Orient de
Carcassonne "Les Vrais Amis réunis", la même loge qu'un personnage très célèbre :
Déodat Rochet
(1877‑1978), maire d'Arques, magistrat, philosophe, anthroposophe, et historien du catharisme.
Car il faut savoir
que l'énigme draine autour d'elle quelques personnages connus pour leur affiliation à la franc‑maçonnerie
comme Ernest Cros,
Dujardin‑Beaumetz,
Jules Doinel,
Chefdebien, et plus récemment
François Mitterrand...
Est‑il besoin d'ajouter que le nombre
33 est un symbole
essentiel pour les francs‑maçons correspondant aux
33 degrés que l'on doit gravir pour atteindre la perfection
suprême ?... Troublante coïncidence... De là à imaginer que ces
33 cartes postales sont porteuses d'un message,
il n'y a qu'un pas...
 |
|
|



