|
Les images offertes par la fresque de
la Montagne Fleurie
sont
sans doute les plus belles surprises visuelles de ces dernières années
dans le monde des deux Rennes.
Non seulement cette découverte était inattendue, mais sa richesse et son
imagerie émerveillent encore.
L'étude commença en
juin 2007 avec
Jean Brunelin et à partir d'une très
belle idée : photographier en haute résolution le
bas relief Marie‑Madeleine sous l'autel. Des détails
étranges étant
perceptibles, il fut naturel d'aller voir également de plus près la
fresque et ses
peintures d'un autre siècle. Très vite, une cascade de
surprises nous convainquit de l'importance de
la composition. Nous n'étions pas en présence d'une simple décoration
religieuse un peu trop voyante, mais plutôt devant un témoignage
important, déposé
discrètement à la fin du
19e siècle et destiné aux générations futures et aux curieux.
|
|

Sur le mur arrière de la paroisse, au‑dessus du
confessionnal
une fresque haut‑relief impressionnante |
|
Entre
2007
et 2008, un
travail d'inventaire et de recherche commença alors. Chacun à son tour nous étions
émerveillés de mettre à la lumière des images plus belles les unes que les autres. Ce travail a d'ailleurs été le
déclencheur d'un livre "Le Secret dans l'art ou l'art du
Secret" que j'eus le plaisir d'écrire et de publier en
mai 2008.
A‑t‑on déchiffré
totalement cette fresque ? Certainement pas ? Il reste encore
beaucoup d'étude qu'il faut corréler avec d'autres
indices. Mais une chose est maintenant certaine. Cette œuvre
a été laissée délibérément pour quelques curieux qui sauront
détecter les anomalies et les traduire.
Qui est à l'origine
de ce message ?
Bérenger Saunière ?
Henri Boudet ?
Jean Jourde ? Une
organisation religieuse ? Les Lazaristes? Difficile à affirmer puisque les
preuves n'existent pas, mais les faits sont là. Ces images
nous ont été laissées en héritage. Il existe toutefois
quelques indices qui suggèrent des pistes sérieuses.
Serons‑nous assez
responsables et assez mûrs pour accepter ce message ? Pourrons‑nous le comprendre
et le respecter ? Je me suis souvent posé cette question, car c'est de notre
patrimoine historique et sacré qu'il est question...

Je
remercie l'équipe municipale de Rennes‑le‑Château 2008 de
m'avoir accordé l'autorisation de photographier cette
fresque dans les meilleures conditions possible. Ce
travail que je livre aujourd'hui est le résultat de
nombreuses heures d'étude et de recherche.
C'est pourquoi tout le matériel photographique et ces études sont protégés
Copyright © RLC Archive ‑ Jean‑Pierre Garcia et Jean
Brunelin |
|

La peinture latérale gauche |
|
Contrairement à la peinture
latérale droite, l'atmosphère
à gauche est
plus chaude. Elle est aussi plus printanière ou plus automnale. Le paysage présente
quelques
fleurs et les arbustes sont parés de rouge et d'ocre. La couleur orangée du ciel montre qu'il s'agit de
l'aube ou de l'aurore et le relief est ici plus accidenté. À gauche,
perché sur un promontoire rocheux, un splendide
château domine la vallée. Il faut admirer les détails et leur précision comme ceux concernant les fenêtres sur les
tours de l'édifice... on peut même les compter.
Comme pour la fresque
droite, cette partie réserve d'autres surprises. Il suffit de la regarder
avec méthode pour qu'elle devienne très bavarde...
|
|

En travaillant la juxtaposition
des 2 parties du décor mural, voici un paysage saisissant
© rennes‑le‑chateau‑archive.com ‑ Montage photo
Jean
Brunelin
|
|
Ce montage suit le même principe que celui appliqué au
jumelage des
tableaux de Rennes‑les‑Bains.
En rassemblant les deux moitiés de décor et les
pierres centrales, on obtient un paysage saisissant... Un dolmen
apparaît au centre
du paysage. Les peintures murales prennent alors une tout
autre dimension. Nous avons peut‑être là un nouveau panoramique
à prendre en compte.
|
|
Un œil
discret
Le
premier détail qui nous interpella sur la fresque gauche fut cet
œil, caché derrière la végétation. Sa présence nous invitait à chercher
son propriétaire. Mais il nous signalait également qu'une grande quantité de travail était devant nous.
Il ne fallut que quelques minutes pour
trouver le deuxième œil et un peu de réflexion pour trouver son
visage. Vous avez deviné ? |

Un œil improbable |
|

L'œil est caché sous une feuille |
|
Nos chers
curés du Razès ont plusieurs tours dans leur sac, car pour
contempler le propriétaire de cet œil, il faut se souvenir de ce
jeu d'enfant dans lequel il fallait tourner et retourner une
image pour trouver un visage ou un personnage. Ici il
s'agit d'un animal particulier très lié à l'énigme...
Vous avez trouvé ? |
|
Il
s'agit bien sûr d'une jeune brebis, une allusion sans aucun doute
à celle du
berger Paris...
Admirer le travail de l'artiste qui redoubla d'efforts non
seulement pour fondre le dessin dans le paysage, mais aussi pour
le peindre à l'envers... Par le jeu des couleurs et des contours, on peut suivre le tour des oreilles, du museau et du cou. Une fois
découpée l'image de la brebis est bien visible avec son œil en place. |
|

La brebis à l'endroit (Détail inversé
fresque gauche) |
|
Un petit
personnage dans les arbres
Il fallait le
dénicher ce
petit personnage perché dans les arbres. Absorbés par la scène générale, il nous est très difficile d'imaginer un dessin dans le
dessin. Notre cerveau fait le tri sans que l'on ait conscience et se concentre sur l'essentiel en faisant disparaître tous les détails
qui ne cadrent pas avec l'image.
C'est pourtant en examinant un arbuste à droite que j'eus la joie de découvrir ce petit
personnage debout et fièrement appuyé contre la pierre centrale. Il est
quasiment impossible de le deviner à l'œil nu et seule une image agrandie et
inversée permet de le déceler. |
|

Un petit personnage inversé est caché dans
les arbres en haut à droite |
|
Son style sort
tout droit d'une bande dessinée : pantalon marron avec plis,
veste noire et jabot blanc, pochette rouge, visage caricatural, menton et nez effilé. Un chapeau noir complète le
tout. L'artiste utilisa son pantalon marron pour le confondre
avec deux branches de l'arbuste... Il fallait y penser... Bravo l'artiste... |
|

Le petit personnage (image inversée)
Les nouveaux détails apparus
avec les derniers clichés montrent que ce personnage n'est pas
si inactif qu'il en a l'air. En fait, il montre de son bras droit
un lieu ou une direction. La main (cercle bleu) est
nettement visible. |


Image retouchée pour
rehausser le visage |
|
La peinture se poursuit sur le rond de bosse
Il fallait s'en douter.
Certains décors continuent sur les côtés du rond de bosse.
L'artiste a visiblement profité du relief et de toutes les
surfaces pour exprimer en couleurs un panorama rocheux et
tourmenté. Chacun y verra son paysage, mais avec un peu
d'imagination vous apercevrez un cratère, de l'eau et des
stalagmites... |
|

Le paysage continue sur le rond de bosse |
|
Un sarcophage
et un panier
Au‑dessus du petit personnage
vu précédemment, un autre détail est perceptible.
Un coffre en forme de sarcophage est posé dans la verdure. On
devine même au‑dessus un couvercle ou une bâche légèrement
soulevée. À côté, un curieux panier en osier trop large semble
accompagner l'objet. |
|

Le sarcophage et un panier en osier ?
Détail inversé fresque gauche |
|
Un ours
Après
la brebis et son œil, les recherches qui suivirent consistèrent
à rechercher d'autres regards cachés dans les recoins du
paysage. L'idée porta ses fruits puisque rapidement je découvris un autre
œil,
moins visible certes, mais bien présent. Et pour observer son
visage, il faut également inverser la peinture.
Avez‑vous trouvé ? |
|

L'œil de l'ours |

L'ours détouré |
|
Un ours est effectivement
visible. Il semble sortir de sa cache parmi les roches,
une patte posée à l'extérieure. Le trompe‑l'œil est ici
remarquable. Non seulement le dessin est à l'envers, mais il se
fond complètement dans la roche, se mélangeant avec les alvéoles
décrites plus bas. Admirez ce bel œil bleu et sa pupille noire. |
|

Observez et essayez de repérer l'ours. Cherchez son œil puis sa patte... |
|
Que nous dit Boudet ?
Il
fallait aussi s'y attendre.
Boudet accorde une grande importance à l'ours et
aux méthodes de chasse. Il faut également apprécier ce beau jeu
de mots en rapport avec la fresque "La vallée de la Têt"... S'agirait‑il de la tête de l'ours ? À lire page 214 :
|
|
Avant l'arrivée des premiers
Celtes, les Pyrénées‑Orientales étaient occupées par les Ibères.
Les ours, sujet
ordinaire des poursuites de ces intrépides chasseurs, vivaient
nombreux dans ces parages. " Le prolongement apparent des
Pyrénées, à l'est de leur jonction avec la Montagne Noire et les
Cévennes, n'a lieu que par une chaîne latérale qui se détache au
fond de la " vallée de
la Têt, dans la Cerdagne française, et qui porte le nom
spécial d'Albères. " (1)
Dans les Albères, –
hall, (hâull),
habitation, – bear (bér), un ours, – les bêtes
fauves trouvaient des retraites profondes, et leur poursuite
présentaient assurément des danger considérables, que les Ibères
affrontaient avec le courage qui les distinguait.
Ces chasseurs
d'ours étaient‑ils le même peuple que les Bébriciens, dont la
cité principale aurait été Pyrène ? Cela parait certain, si l'on
dégage les traditions historiques de tous les ornements fabuleux
qui les rendent méconnaissables.
Extrait " La Vraie Langue
Celtique" 1886 Boudet |
|
Des
bouquetins
Il
faut beaucoup de patience pour espérer trouver un objet ou un
animal. Je découvris celui‑ci à la fin de l'année 2008. C'est en explorant le rocher en bas à gauche et que l'on associe
habituellement au "Fauteuil du diable", que je vis un petit animal
pointant son museau. Une fois repéré il se devine très
facilement avec ses cornes sombres, son œil noir et sa robe
chamois. Tout indique qu'il s'agit
d'un bouquetin, plus exactement d'une mère regardant ses petits dans le creux
de la roche. |
|
Le bouquetin comme le
cerf ou le chamois sont des animaux qui ont peuplé les Pyrénées
et l'Aude il y a des millions d'années comme l'indique cet
article très significatif : |
|
Un nouveau gisement paléontologique
à Capra caucasica praepyrenaica : la grotte de l'Arche
à Bugarach (Aude, France)
La grotte de l'Arche est un
nouveau gisement paléontologique découvert dans les Corbières.
Cette cavité a livré une faune de grands mammifères assez
abondante et bien conservée. Une première description des restes
de faune prélevés en surface est présentée. Une datation est
proposée sur la base d'arguments biochronologiques de la fin du
stade isotopique 5 au stade 4. L'intérêt du site réside dans
l'abondance du bouquetin du Caucase (93% de la faune),
Capra
caucasica praepyrenaica, rare dans la partie occidentale des
Pyrénées.
F. Rivals, A. Testu, C. R. Palevol 5 (2006). |

Le bouquetin |
|
Et que dit Boudet ?
Encore
une fois, on peut retrouver dans
La Vraie Langue Celtique de
Boudet cet animal,
preuve que son livre est extrêmement lié à la fresque.
On peut lire à la page
195 : |
|
La description de l'espèce animale, renfermée
dans Garumnites, se rapporte moins à l'isard qu'au
bouquetin. Les poils de celui ci sont un peu plus
longs : les cornes recourbées en arrière sont
surtout remarquables : elles sont composées de
nombreux anneaux, et la longueur totale en est si
considérable chez les vieux mâles, que les
extrémités atteignent l'origine de la queue, lorsque
leur tête est relevée.
Les bouquetins ont disparu des Pyrénées, ils
sont en petit nombre dans les Alpes.
Extrait " La Vraie Langue
Celtique" 1886 Boudet |
|
Une autre
coupe de terrain
Les
images du sous‑sol dans la fresque droite ne sont pas les
seules. Il existe aussi sur la fresque gauche une autre coupe verticale
montrant un réseau sous terrain non loin du château en ruines. Cette construction n'est peut‑être qu'un rébus
ou une allégorie à autre chose. Le fait est que le réseau est en tout cas bien
visible avec un canal vertical qui se divise en deux...
|
|

Un réseau sous terrain... |
|
De curieuses
alvéoles
Sous
la coupe géologique et comme s'il s'agissait d'une continuité,
nous pénétrons dans les entrailles de la Terre ou de curieuses alvéoles sont disposées les unes contre les autres.
De loin le trompe œil est saisissant puisque que l'on ne
discerne que des pierres reflétant la lumière ambiante. De
près, il s'agit de tout autre chose. Les parties sombres sont les
pleins et les parties claires les creux. Chaque alvéole possède
une ouverture constituant ainsi un curieux labyrinthe. |
|
Que contiennent ces
alvéoles ? Impossible de le dire. Néanmoins, chacune est
différente et l'artiste a clairement voulu les différencier pour nous apporter un témoignage visuel. |
|
Derrière les
images, d'autres objets...
La
fresque est complexe et se présente comme une superposition d'images
transparentes. Derrière chaque décor, sous une feuille, contre
une pierre, dans une ombre, des objets insolites apparaissent et
jouent avec la lumière et les couleurs.
Des objets peuvent en cacher d'autres, plus discrets,
plus détaillés et qui se mélangent entre eux. Il est étonnant de
voir parfois un détail qui une fois analysé et interprété vient
s'inscrire dans un autre, plus large, plus important et qui est
passé complètement inaperçu. Il est actuellement impossible de dresser un
inventaire complet. Voici un exemple montrant cette complexité.
Près de l'œil de la brebis,
d'autres objets se promènent. On aperçoit ici ce qui pourrait
être des clés ou des poignées et un petit fermoir... Mais
attention, ces détails font partie d'un ensemble plus vaste... |
|
Encore
d'autres images...
Les
images surprenantes ne manquent pas. Voici une petite
sélection parmi les plus étonnantes. Attention aux
interprétations... |
|

Un rouleau de tissu parmi un tas d'objets ? Détail d'une alvéole |
|

Une main tenant la tête d'un serpent ?
Détail d'une alvéole |
|

Une grenouille ? |

Un objet jaune‑vert dans les buissons ... |
|
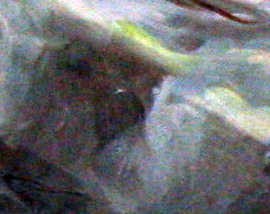
Une pièce de monnaie ? |

Un petit coffre ? |
|

La fresque dessinée et installée en
1897
fut probablement conçue vers 1890,
quatre ans après la
parution de "La Vraie
Langue Celtique" publiée par Boudet en
1886. Ce travail n'est
pas le résultat d'une improvisation artistique ou d'une quelconque
idée de décoration destinée aux paroissiens. Ces images prouvent enfin une
fois pour toutes que l'affaire de Rennes‑le‑Château est bien
réelle et qu'elle n'est pas issue d'une invention de quelques
illuminés comme certains aiment l'écrire.
C'est la concrétisation d'un projet
ambitieux qui demanda
certainement des heures de réflexion, d'étude et de
conception. Alors que sa réalisation murale nécessita peut‑être
quelques semaines, sa complexité prouve qu'il ne s'agit pas du
travail d'un seul homme. Plusieurs auteurs ont
certainement participé à l'ébauche de cette œuvre qui devait
parachever le codage de Rennes‑le‑Château. Son objectif est non
seulement de protéger la mémoire d'un évènement très particulier qui
s'est tenu dans le Haut‑Razès, mais également de confier aux
générations futures un témoignage unique et un héritage historique
de grande importance.
Ces quelques pages ne
montrent qu'un aperçu et beaucoup d'autres études sont
encore à venir. La fresque n'a pas livré tous ses secrets.
Soyez‑en certain... |
|
|



