|
|
L'énigme
des deux Rennes oblige les chercheurs à s'intéresser
à l'archéologie, surtout si celle-ci ne correspond pas
au modèle admis par les historiens et les scientifiques.
La France et le monde fourmillent de cas où les réponses
face à l'Histoire sont absentes, voire impossibles dans le cadre de nos
connaissances actuelles. Un bel exemple est celui du
Cercle des églises dans le Haut-Razès. Le sujet des
pyramides mises à jour peu à peu dans le monde entier est un autre exemple très démonstratif
prouvant combien nous sommes ignorants à propos des
anciennes civilisations et de la réelle chronologie de
notre Antiquité.
En
matière d’archéologie, si beaucoup de sites restent à
explorer, nombreux sont ceux pour lesquels les
archéologues et les scientifiques préfèrent attendre,
souvent très longtemps, pour mieux les analyser. Les
raisons sont simples à comprendre : manque de moyen
ou
d’effectif, pas ou peu de budget, pas de temps, terrains
difficiles, sécurisés ou conflits armés, sans compter
des outils encore inadaptés. Un autre choix
est celui de laisser aux générations futures le soin de
lancer les explorations. Pour
préserver ces sites précieux, beaucoup restent enfouis
lorsque c’est possible et sont tenus secrets afin d’éviter les pillages et les dégradations. Ceci
est bien compréhensible.
Néanmoins, il est beaucoup plus difficile d’admettre que
des sites importants, connus des habitants locaux, soient détruits pour des raisons
économiques ou pour de simples choix d’urbanisme, et
sans qu'aucune étude historique ne soit faite. Il existe un cas
d'école
qui illustre parfaitement cette situation, et c'est grâce à
l'incompréhension de la population locale relayée par quelques youtubeurs lanceurs
d'alertes qu'une étrange affaire a pu remonter à la
surface :
la Grande Pyramide de Nice…
|

La Grande Pyramide de Nice - Vue
aérienne (photo rare) |
| Cerise sur
le gâteau, nous allons voir que cette anomalie
archéologique possède un lien très inattendu avec
l'affaire de Rennes-le-Château, et pour comprendre cette
relation discrète, il faut reprendre l'histoire de
ND du Cros
et d'un certain ermite marcheur : le
Père Joseph Chiron... |
|
Le pays de Provence et son Histoire |
|
Depuis longtemps, la région niçoise est connue
pour son littoral, sa douceur de vivre, son ambiance
festive, ses villes portuaires comme
Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat,
Beaulieu-sur-Mer, Antibes, Juan-les-Pins. Il y a
aussi Nice et son carnaval, la Baie des Anges, sans
oublier Cannes et son célèbre festival du Cinéma...
|

Nice et la Baie des Anges
|
|
L’arrière-pays ne manque pas non plus de charme avec une
multitude de villages comme La Turbie célèbre par son
Trophée des Alpes, l'un des deux derniers
trophées romains avec celui situé en Roumanie ; le
village de Peillon
connu pour son aspect médiéval et en son sommet la
chapelle des Pénitents blancs ; Eze posé sur un piton
rocheux ; Peille et son église du XIIe siècle, son
clocher lombard et les ruines d’un château qui
appartenait aux comtes de Provence. Il y a aussi Falicon
perché sur un mamelon rocheux et où se cache une autre
pyramide… Nous y reviendrons. |

La Turbie et le Trophée des
Alpes (trophée d'Auguste) - La Toge et le Glaive
Symbole de la richesse
historique du littoral niçois |
|
L’Histoire de la
région est également très riche. Situé à l’extrémité
sud-est de la France, au sud des Alpes et au bord de
la mer Méditerranée, le Pays niçois n’est français que
depuis 1860. Ancienne possession
des comtes de Provence durant une partie du Moyen Âge,
il appartint de 1388 à 1860 à la maison
de Savoie (comté de Savoie, duché de Savoie
puis États-Sardes) avec cependant une interruption
française entre 1793 et 1814.
|
Appelé dans un premier temps
« terres neuves de Provence » par les nouveaux
souverains de Savoie, c’est en
1526
que ce territoire prend le nom de comté de Nice
avant d’être annexé à la France en
1860.
Mais l’histoire de la région niçoise s’inscrit dans une
zone beaucoup plus vaste et trouve ses racines dans
les âges les plus anciens. |
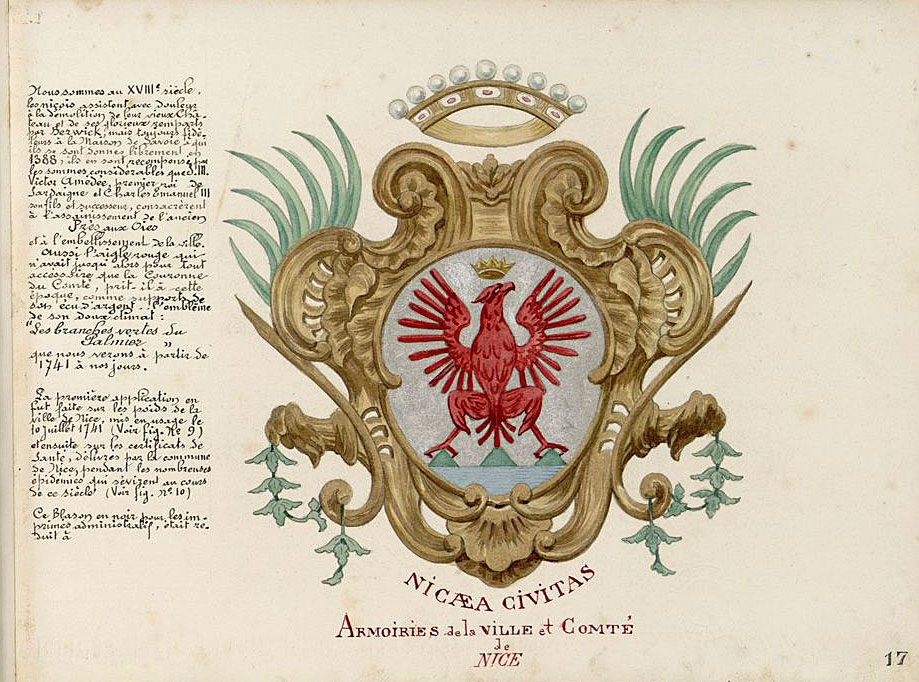
Les armoiries du comté de
Nice |
|
C’est un fait largement admis aujourd’hui ; toute la
région provençale a été habitée dès
le Paléolithique inférieur, et plusieurs grottes sont là
pour nous le prouver. La grotte du Vallonnet
au-dessus de la baie de Menton à Roquebrune cap-Martin
était occupée
il y a 1,15 million d'années, ce qui en
fait l'un des sites préhistoriques les plus anciens de
France. La grotte de
l'Escale à Saint-Estève-Janson montre des traces de feu
il y a plus de 700 000 ans. À Nice, les foyers de Terra Amata
sur les pentes du Mont Boron datent
de 400 000 ans.
Des sépultures mégalithiques
comme les Hypogées d'Arles-FontVieille (tombes
collectives) et des habitats perchés munis
d'enceintes à Miouvin et
à Istres apparaissent au Néolithique et au début de
l'âge des métaux. L'Hypogée de Cordes (Grotte des
Fées, ou Hypogée des Fées de Cordes ou encore
Épée de Roland) est l'un des plus impressionnants
monuments mégalithiques de l'Europe occidentale situés en
face du plateau du Castelet à côté d'Arles.
|

La pierre de la fée en
Provence
à Draguignan
Période néolithique
|

L'Hypogée de Cordes sur le
plateau du Castelet près d'Arles - Caveaux funéraires de
plus de 5000 ans |
|
À partir du IVe siècle av. J.-C., des Celtes arrivent en
Provence, laissant parfois subsister les tribus des
anciens occupants. Dans la basse Provence, ce peuple
celtique se
mêle aux anciens habitants et forme une population
celto-ligure. Quant aux Ligures autochtones,
ils commercent
avec des Étrusques et des colons grecs de Phocée.
Mais c'est par Marseille que les sites
gaulois de Provence entrent dans l'économie monétaire et
que s'élabore l'écriture gallo-grecque. C’est aussi à cette
époque que la colonie de Massalia est fondée par les
Grecs, issue de la cité de Phocée.
La colonie
part implanter depuis Massalia des comptoirs étalés le long de la côte,
de l'Espagne à l'Italie : Olbia (Hyères), Antipolis
(Antibes), Nicoea (Nice), Rhodanousia (Arles) ; c'est le
développement de l'empire massaliote. De l'an 185 av. J.-C. jusqu'en l'an
49 av. J.-C. Rome vient en aide à
Massalia contre les Celto-Ligures
qui ont envahi la Provence en l'an 400 av. J.-C.
En 49
av. J.-C., Massalia est même annexée par les Romains de
Jules César, la ville ayant pris le parti de Pompée. Mais c'est Auguste
qui décide d'englober, entre l'an 27 av. J.-C. et
l'an 14 ap. J.-C. la Provincia à l'Empire
romain. La région actuelle Provence-Alpes-Côte d'Azur fait
alors partie
de la province romaine transalpine dénommée Gaule
narbonnaise ou « Provincia Romana »
Il étend aussi la Provence en créant de nouvelles colonies : Avignon, Arausio (Orange),
Cavaillon... Arles devient alors la ville
principale de la Provence. C'est la Pax
Romana et les Romains construisent des ports, des voies
routières (Via Domitia), des théâtres, des aqueducs, des thermes,
des amphithéâtres, des forums.
Cette période prospère
durera jusqu'au IIIe siècle, début de la chute de
l'Empire au profit des invasions germaniques,
Ostrogoths, Burgondes, Francs, qui dureront jusqu'au
VIe siècle. La Narbonnaise est
toutefois épargnée par les Barbares qui ravagent la
Gaule. Au milieu du
IIIe
siècle, la christianisation est
en marche. Un évêque est en poste à Arles et la liste
des Églises représentées au concile d'Arles en
314 atteste l'existence de communautés à
Narbonne, Marseille, Nice, Apt, Orange et Vaison. Ces
communautés ne connaissent pas les grandes persécutions.
Le
IVe siècle
est aussi marqué par la conquête du pouvoir par
Constantin. En l'an 309 ou 310, il
met le siège devant Marseille où s'est réfugié
l’usurpateur Maximilien qui doit se rendre. Enfin, c'est
au VIe siècle que le dernier roi Ostrogoth donne
la Provence au roi des Francs pour obtenir une alliance.
Les Mérovingiens se partagent
alors la Provence qui devient un véritable carrefour
entre le Nord et le Sud et la route obligatoire entre
l'Espagne et Rome. Des conflits
éclatent, mais c'est Charles Martel puis son
fils Pépin le Bref, premier roi carolingien qui
ramèneront le calme et accrocheront la Provence à l'immense royaume de
Charlemagne en 739.
Il faudra attendre 1854 pour
qu'enfin
Frédéric Mistral contribue
à la renaissance de l'Identité provençale en fondant
le Félibrige.
De nos jours, plusieurs associations tentent de faire
reconnaître la culture provençale comme une culture à
part entière, et demande à ce que la région se nomme
Provence ou Pays de Provence...
|
| Une grande pyramide dans le
pays niçois ? |
|
Comme nous le voyons, l’histoire de Nice est
très riche. Ville frontière, elle a souvent changé de souveraineté devenant successivement ligure, grecque et romaine, avant de faire partie du Royaume ostrogoth d'Italie, puis de
l'Empire romain d'Orient et du royaume d'Italie
(Saint-Empire Romain), devenant
ensuite génoise, provençale, savoyarde, piémontaise et enfin française.
Cette courte parenthèse historique
est obligatoire pour tenter de comprendre l'importance
et les enjeux de l'anomalie
archéologique qui va suivre. Car, qui oserait imaginer que l’on puisse insérer
dans cette fresque historique bien rodée une grande pyramide
en plein pays niçois ?
Comment imaginer qu’une grande pyramide existait encore
il y a un demi-siècle au nord-est de la ville
touristique, une pyramide totalement oubliée ? Il est clair
que si sa présence est avérée, son explication est
particulièrement dérangeante. Les historiens et les
archéologues auraient-ils
raté un épisode ? Ou bien, fallait-il passer sous silence
ce monument particulièrement gênant en le faisant
discrètement disparaître ?
Une pyramide
qui fait débat
Sa présence sur le littoral ne cadre
pas avec l'Histoire, c'est une évidence, et le nom de
"pyramide" crée le débat. Pour certains, il s'agit d'un
véritable scandale archéologique, la pyramide étant une
preuve de l'existence d'une ancienne civilisation méconnue. Pour
d'autres, elle n'est qu'une simple colline aménagée en
terrasses de culture. Pour d'autres enfin, il s'agit d'une carrière
de pierres abandonnée. Heureusement, quelques rares photos témoignent
de son aspect impressionnant parfaitement incompatible avec une
quelconque carrière. Mais qu'en est-il réellement ?
Il existe très peu de traces de cette construction surprenante,
et seules quelques images permettent d’apprécier ses
dimensions en la comparant à des édifices immobiliers
très proches.
|

Une rare photo montre la
pyramide sur ses côtés les plus remarquables
Pas moins de 20 marches sont
nettement discernables |
|
Du fait de sa hauteur très importante, la construction que l’on nomme aussi
« La Grande Pyramide de Saint-André » peut même être
considérée, s’il s’agit bien d’une pyramide, comme l’une
des plus grandes structures pyramidales édifiées sur le continent européen,
semblable à celle de Barnenez en Bretagne, de Güímar sur
l’Ile de Ténériffe aux Canaries, ou celle de Monte D'Accoddi en
Sardaigne.
|
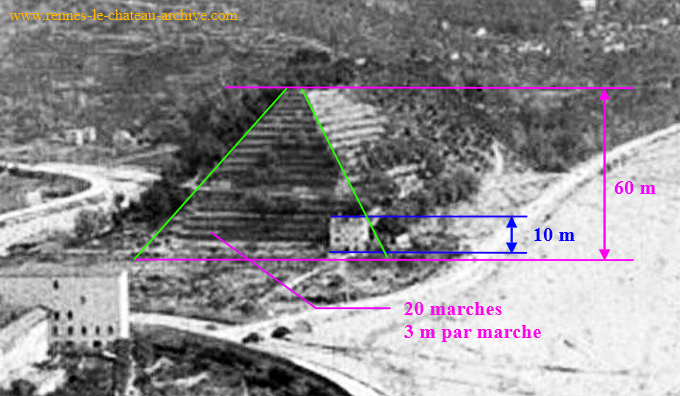
L'immeuble à deux étages au
pied de la pyramide permet une mesure approximative |
|
La pyramide n'était pas en pierres sèches comme on
pourrait le penser, mais taillée dans la colline, et mesurait environ 60 m de haut,
voire 70 m, s'étalant sur 200 m
en
épousant la face Est de la forte dénivellation. Présente encore il y a une
cinquantaine d'années, elle était située à l'est de
Nice
, non pas sur la commune de Saint-André-de-la-Roche
comme on peut le lire régulièrement,
mais sur la commune de Nice, au
confluent des vallées du
Paillon et de la Banquière. D'ailleurs ces cours d'eau
dessinent les frontières communales.
Néanmoins,
il est inutile
de se précipiter dans le secteur pour l’admirer. L’édifice a totalement disparu et
il a malheureusement laissé la place à un
vaste échangeur de l'autoroute A8 qui verrouille tous les
accès à l'ancien site.
À titre de comparaison, la grande pyramide de Kéops
en Égypte
s'élève à 150 m soit le double, sur une base carrée
d'environ 230 m. Et
pour témoigner des dimensions imposantes,
quelques rares photographies prises par des témoins avertis
nous la présentent peu de temps avant qu’elle ne soit
démolie. Les deux faces ouest et sud étaient encore bien conservées,
chacune étant constituée d'un escalier géant d'au moins
20 marches. Compte tenu de la hauteur
totale, on peut en déduire facilement la hauteur moyenne d'une
marche, entre 2,50 m et 3 m ce qui correspond à l'étage d'un
immeuble.
|

La pyramide de Nice et la
partie haute de sa
face ouest |
|
Comparons avec une
pyramide à degrés égyptienne
La structure
en escalier de la Pyramide de Nice
rappelle inévitablement les pyramides à degrés en
Égypte. Considérées comme les premières pyramides de
l'histoire égyptienne, elles furent construites durant
la première période de l'ère des pyramides et elles se
caractérisent par une succession de paliers-terrasses
que l'on retrouve dans d'autres civilisations comme chez
les Mayas.
La
toute première pyramide égyptienne est, selon les
connaissances actuelles, la pyramide de Djeser
au Caire. Nous sommes alors 2600 ans av. J.-C.,
mais il est difficile de connaître sa date exacte. C'est
le pharaon Djeser qui la fit construire, premier pharaon
de la IIIe dynastie. Ses successeurs
continueront à édifier des complexes
funéraires de grandes tailles basés sur une pyramide à
degrés, et ce jusqu'au premier pharaon de la dynastie
suivante, Snéfrou de la IVe dynastie, qui tentera un
modèle de pyramide à faces lisses.
|

La
pyramide à degrés de Djeser en Égypte |
La Pyramide à
degrés de Djeser Égypte est haute de
62 m
et possède une base de
125 m sur 109 m.
Composée de pierres calcaires, elle fut conçue par
l'architecte Imhotep au
27e siècle av. J.-C.
Si les
proportions de la pyramide de Djeser se rapprochent de
celles de Nice, cette dernière est beaucoup plus
impressionnantes du point de vue de son nombre de
marches... Mais peut-on les comparer ? Pas vraiment, car
si la pyramide de Djeser est une construction faite de
bloc calcaire, la pyramide de Nice n'est pas tout à fait
une construction puisqu'elle a été taillée dans une
colline préexistante, ce qui est très différent... |
L'histoire d'une
destruction annoncée...
La mort
lente de la pyramide commença en 1954,
date à laquelle le monument fut acheté par une entreprise
du bâtiment de travaux publics. Les vendeurs seraient
une communauté religieuse rattachée à l'hôpital
Sainte-Marie très proche. L'ironie est double puisque non seulement
cette transaction fut réalisée peu de temps après la
redécouverte de la pyramide, mais la vente se fit sans
tenir compte de sa valeur historique ni d'une quelconque
expertise scientifique. Un comble...
L'entreprise
commence alors un chantier de démolition et se charge de
déménager des tonnes de matériaux, de pierres et de
roches. Dès lors, on peut se poser la question de
l'intérêt de cette acquisition. L'entreprise a-t-elle vu
dans cette colline en escalier un potentiel pour
transformer les
pierres en remblais ou en sable ? A-t-elle été mandatée
pour effectuer une opération de démolition ? Nous n'en
savons rien. Le fait est que la partie supérieure
commença à fondre très rapidement
alors que des wagonnets de matériaux étaient acheminés vers une
destination inconnue. On distingue même sur une photo
le chemin permettant aux camions d'accéder au
sommet complètement dévasté. L'opération va d'ailleurs
ajouter à la confusion puisque de nombreux témoins
considéreront que ces travaux ne sont finalement que la partie
visible d'une exploitation de carrière de pierres... A priori, rien
d'anormal, et pourtant...
|

La Grande Pyramide de
Nice en cours
de destruction
Une route (la route de l'Abadie) contournait l'édifice
et permettait d'éliminer les matériaux |
|
La destruction est
toutefois bloquée en
1955 du fait d'une partie de la
population niçoise qui veut comprendre. Malheureusement,
le chantier reprend et à la fin de
l’année 1970, le couperet tombe. Malgré son
importance évidente, les autorités locales décrètent que
la pyramide devra être complètement détruite pour
laisser la place à un échangeur autoroutier chargé de
servir la ville de Nice.
Finalement, elle disparaît entièrement en 1970
et l'espace laissé libre devient un vaste chantier
destiné à transformer la zone en un
complexe routier bétonné et bitumé. L'autoroute A8
peut poursuivre son chemin.
|

L'échangeur autoroutier de
l'A8 où était située la Grande Pyramide |
|
Des photos satellites montrent clairement l’échangeur
autoroutier construit exactement sur le
site où se dressait l’ancienne grande pyramide de Nice.
Pouvait-on faire autrement ? Certainement, mais la
question a-t-elle été posée au moins une fois ? Il ne
reste aujourd'hui pratiquement aucune trace de ce témoin
du passé et son
expertise est définitivement impossible.
|

En superposant une photo
actuelle et une ancienne photo aérienne de 1953,
on peut voir l'emprise (en
bleu) de la
pyramide sur
l'échangeur autoroutier
|
|
Un compte-rendu officiel intriguant...
C’est en 2006 que le conseil municipal
de la commune de Saint-André réagit et publie un
compte rendu plutôt laconique. Il s’agit d’ailleurs d'un
rare document officiel public provenant de la commune
et attestant de la présence d’une structure historique
importante. Fallait-il communiquer face à certaines
questions issues de la population locale ?
|
[...]
La destruction du site du Mérindol, promontoire
caractéristique au confluent des vallées du
Paillon et de la Banquière qui possédait encore
des vestiges d'une forteresse médiévale, citée à
plusieurs reprises dans les documents depuis le
XIe siècle, place forte des Huguenots durant les
guerres de religions. Par ailleurs,
sa structure
de restanques en forme de pyramide aurait mérité
un autre destin que celui
que lui ont réservé les engins de démolition.
Projet de contournement routier de Nice
Extrait du compte rendu municipal de
Saint-André-de-la-Roche
(janvier 2006 n°9) |
|

Recto de la communication
du conseil municipal 2006 |

La Grande Pyramide près de
Saint-André-de-la-Roche à droite nettement visible
Sa structure pyramidale est
régulière et très bien dessinée |
|
Le communiqué a de quoi étonner… Nous serions en présence
d’une forteresse médiévale qui serait citée dans des
documents du XIe siècle et qui aurait
été utilisée comme place forte par les
huguenots.
Rappelons que les
huguenots sont les
protestants du royaume de France et du royaume de
Navarre pendant les guerres de Religion de la seconde
moitié du XVIe siècle entre
1562 et
1598
et au cours
desquelles ils étaient en conflit avec les catholiques. Les
persécutions amèneront la triste
Saint-Barthélemy, puis sous Louis XIV, les dragonnades.
En 1685, la révocation de l'Édit de
Nantes par Louis XIV supprime définitivement leur
liberté de culte, et leur survie dépend de leur
conversion au catholicisme. C’est alors la fuite des
huguenots vers les pays protestants
d'Europe (actuels Pays-Bas), l’Angleterre, la Suisse,
l’Allemagne. Presque 300 000 personnes
quitteront le royaume de France.
Organisées
par Louvois, alors secrétaire d'État de la
Guerre de Louis XIV, les dragonnades
dégénèrent en tortures, viols, violences, et
dépouillement des protestants de leurs biens. Le procédé
s'étend au Béarn, au Languedoc et à
la Saintonge, jusqu'à sa généralisation en mars 1685,
complétant les mesures discriminatoires. Fuir est puni
par la pendaison ou les galères à vie. Pour les femmes
c’est la prison à vie comme dans la Tour de
Constance à Aigues-Mortes. En août 1686,
245 huguenots de l’Oisans sont arrêtés dans le duché de
Savoie et jetés en prison ou envoyés au gibet.
Il existait donc sur le sommet pyramidal de
Nice
une poche de résistance protestante installée dans le
château ? L’histoire niçoise
ne révèle en tout cas aucune rébellion ni guerre
huguenote marquante pouvant justifier une telle place
forte. Le comté de Nice qui n’appartenait pas encore
à la France servait plutôt de base arrière pour fuir par voie
de mer ou par voie de terre vers les États de Savoie (la
Suisse), vers l’Allemagne, la Hollande ou
l’Angleterre.
Il est de plus très étonnant que des documents
médiévaux soient cités sans référence...
Dommage, ceux-ci auraient accrédité la
communication du conseil municipal. Pyramide
ou forteresse ? Le fait est que la commune semble
faire son Mea Culpa à propos d'une bavure
archéologique qui ne dit pas son nom et d'une démolition
"qui aurait mérité un autre destin" dixit
le communiqué...
|

La base de la Grande Pyramide
sert aujourd'hui de carrefour autoroutier |
|
Autre curiosité selon ce même communiqué : la
structure de restanques en forme de pyramide ferait
partie du château. Mais, qu’est-ce que des restanques ?
Ce terme utilisé en
basse Provence désigne un mur de retenue en pierres
sèches, parementé sur les deux côtés, et permettant de créer
une terrasse de cultures dans des endroits escarpés. Cet
aménagement permet aussi parfois de barrer le lit d'un torrent
intermittent tout en laissant passer l'eau. Les restanques se
généralisent en Provence à partir de la fin du XVIIIe siècle avec la conquête des terres incultes suscitée par
l'accroissement démographique.
|

Restanques dans le Tarn |

Autre exemple de restanques
|
|
Les restanques et les cultures en terrasses sont en
général édifiées sur des pentes douces et aménageables, et
la première raison est simple à comprendre. Plus la
pente est importante et plus la dangerosité augmente
puisque les terrasses deviennent étroites et les murs
hauts, ce qui est le
cas des deux faces de la pyramide de Saint-André.
D'autre part, les terrasses devenant étroites, elles
offrent peu de surface cultivable rendant l'aménagement
très peu rentable. Autre
question : pourquoi avoir entrepris des travaux pharaoniques
avec des restanques de 2 m à 3,50 m
de haut alors que des espaces de cultures nettement plus
accessibles et plus vastes existent autour de la pyramide ?
En clair, s’il s’agit de restanques, elles n’ont pu
apparaître qu’à partir du XVIIIe siècle et ne
peuvent donc
faire partie d'une quelconque place forte utilisée au
XVe siècle. Il
n’existe d’ailleurs aucun exemple connu de château
médiéval bâti sur des formes de restanques ou des terrasses en
escalier. À ce stade on peut donc affirmer que les
informations officielles fournies par le conseil
municipal sont soit non vérifiées par des experts, soit
destinée à éteindre une possible polémique. L’enjeu est
de toute façon nul pour les autorités puisque tout a
disparu et qu’aucune étude ne semble avoir été réalisée
pour dater sérieusement le monument disparu de Saint-André.
|
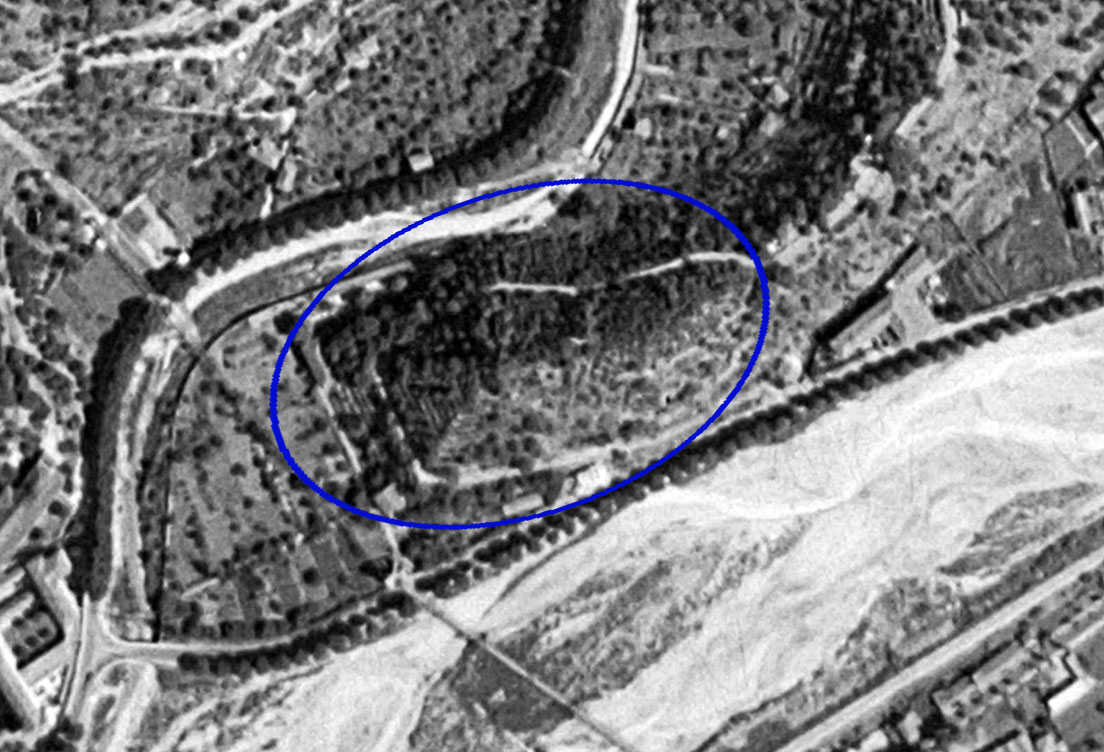
Photo aérienne 1953 - L'angle
sud-ouest est très bien dessiné |
Des témoins
confirment que des terrasses étaient utilisées pour y
produire de la vigne, mais rien ne prouve que ces
terrasses aient été construites pour les cultures et
qu'elles n'existaient pas déjà bien avant. Si
l'hypothèse des restanques est envisageable, leurs
structures extrêmement régulières, alignées et se
terminant vers le haut en pointe posent
problème. Les photos montrent en effet des arêtes très
bien dessinées. Les terrasses étroites sont parfaitement
parallèles et la partie visible sud-ouest forme un angle
droit avec une pente rectiligne qui est difficilement
justifiable pour une simple culture de vignes. De plus, il faut
avoir à l'esprit le volume colossal du monument, sa
hauteur et sa pente abrupte rendant très difficile et
très périlleuse la construction de telles marches. Imaginez ce que
peut représenter la taille de 20 murs
en escalier sur chaque face, parfaitement parallèles,
haut de 2,50 m à 3 m, formant un angle droit, et bâti en respectant
une pente rectiligne. Pour quelle raison une simple mise
en culture de vignes nécessiterait-elle de tels travaux
pharaoniques et aussi précis ?
Il ne faut pas non plus perdre de vue que s'il s'agit bien d'une
ancienne pyramide, son érosion due aux saisons, son âge
et la végétation pourrait largement expliquer son aspect
actuel. |
| Un lien inattendu avec
l'affaire de Rennes-le-Château |
| Nous avons
vu précédemment qu'une entreprise de BTP acheta le
site de la Grande Pyramide en 1954 et
que les
anciens propriétaires étaient une communauté
religieuse rattachée à l'hôpital Sainte-Marie
situé à côté. |

La Grande Pyramide de
Saint-André-de-la-Roche nettement visible à droite
À gauche, l'un des bâtiments
de l'hôpital. La partie centrale deviendra
un parking privé du centre hospitalier |
|
Or, il faut savoir que cet
hôpital situé au 87 avenue Joseph Raybaud est
aujourd'hui un hôpital
psychiatrique, plus précisement un centre
hospitalier. Or, chose étonnante... Son histoire est
liée à l'affaire de Rennes-le-Château !
Pour comprendre ce lien
aujourd'hui oublié, il faut remonter le temps, et revenir
au début du XIXe siècle,
où un
aumônier exerçant à la prison de Privas
dans l'Ardèche découvre
la maladie mentale dans le milieu carcéral. Cette prison comme
beaucoup d'autres à cette époque faisait cohabiter les
délinquants et les aliénés. Cet aumônier connu
des aficionados de Rennes
s'appelle
Joseph Chiron, et il eut un parcours particulièrement
atypique, devenant ermite de Galamus
près du Bugarach et investissant
dans l'immobilier pour créer des centres pour aliénés, sans que l'on comprenne
réellement d'où il trouvait ses ressources financières.
Il s'éteindra à
ND du Cros, un lieu culte de l'énigme où se
croisèrent Gaudéric Mêche
et Henri Boudet...
Reprenons
très brièvement son parcours et voyons comment sa piste mène
à la Pyramide de Nice (sa biographie
complète est ici :
ND du Cros)
|
|
Qui était Joseph Chiron ?
Né à
Bourg‑Saint‑Andéol dans l'Ardèche, le 19
novembre 1797, il est le fondateur de
la Congrégation Sainte‑Marie de l'Assomption.
Son parcours atypique et
totalement méconnu fait
partie des grands bienfaiteurs du XIXe
siècle puisqu'il est à l'origine de la création
des premiers asiles pour aliénés en France. Il reste pourtant totalement
oublié et absent des
livres d'Histoire...
Le Père Joseph Marie Chiron vers
1843 et son lourd Crucifix de
un mètre
de haut qu'il ne quitta
plus
jusqu'à sa mort
|
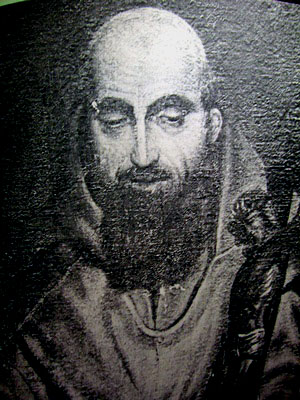
|
Il entre au grand séminaire de Viviers
en 1819 et reçoit les ordres mineurs,
un séminaire où il rencontre l'abbé Vernet.
Or, ce dernier voue une véritable vénération pour
Agnès de Langeac (1602‑1634)
Supérieure des Dominicaines, une religieuse très proche d'Olier
qui fonda Saint-Sulpice en
1646. D'autre part, des liens sont
nombreux entre Viviers et Jean-Jacques Olier, disciple de Saint Vincent de Paul
et qui
connut si bien Nicolas Pavillon.
Très vite, grâce à un charisme hors du commun, Joseph
Chiron crée le 25 novembre 1824 la
Congrégation Sainte‑Marie de l’Assomption soumise à la règle de
Saint‑Augustin. Pour cela, il réunit une quarantaine de ses
plus ardentes paroissiennes avec qui il fonde "Les
enfants de Marie". Ces quelques jeunes filles du
pays qu'il détermine à se consacrer à la Sainte Vierge
sont baptisées" les Saintes Marie ".
Le
1er janvier
1827, le
Père Chiron
est nommé aumônier de la prison de
Privas dans l'Ardèche
et cette nomination va être pour lui une révélation.
Cette prison, comme
beaucoup d'autres à cette époque, fait cohabiter les
délinquants et les aliénés. Ces
derniers, en l'absence totale de structure médicale et de
soins adaptés, sont traités comme de vulgaires prisonniers
de droit commun et internés sans le moindre soin eu égard à
leur souffrance.
Le hasard d'amis
communs va faire rencontrer Joseph Chiron et Paul de
Magallon d'Argens (1784-1859), restaurateur en
France de l'ancien Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu
créé par Juan Ciudad (1495-1550).
|
|

Joseph Chiron à 44 ans
(Archives Gandon)
|
Et c'est à partir d'une idée du
R.P.
de Magallon et du
frère Hilarion
que Joseph Chiron crée avec
les Saintes
Marie
venues le rejoindre le
premier asile Sainte Marie
pour les femmes aliénées.
Ainsi, le
1er mai 1827 né l’Hôpital
Sainte Marie de Privas.
Or, son idée fait du chemin et
en 1836,
l’Hôpital Sainte Marie de Clermont‑Ferrand (Puy‑de‑Dôme) ouvre ses portes.
Le Père Joseph Marie Chiron est donc
l'un des trois
hommes d'Église qui fondèrent les maisons
d'aliénés en France au
XIXe siècle, avec le très fantasque
frère Hilarion et le R.P. de Magallon.
|
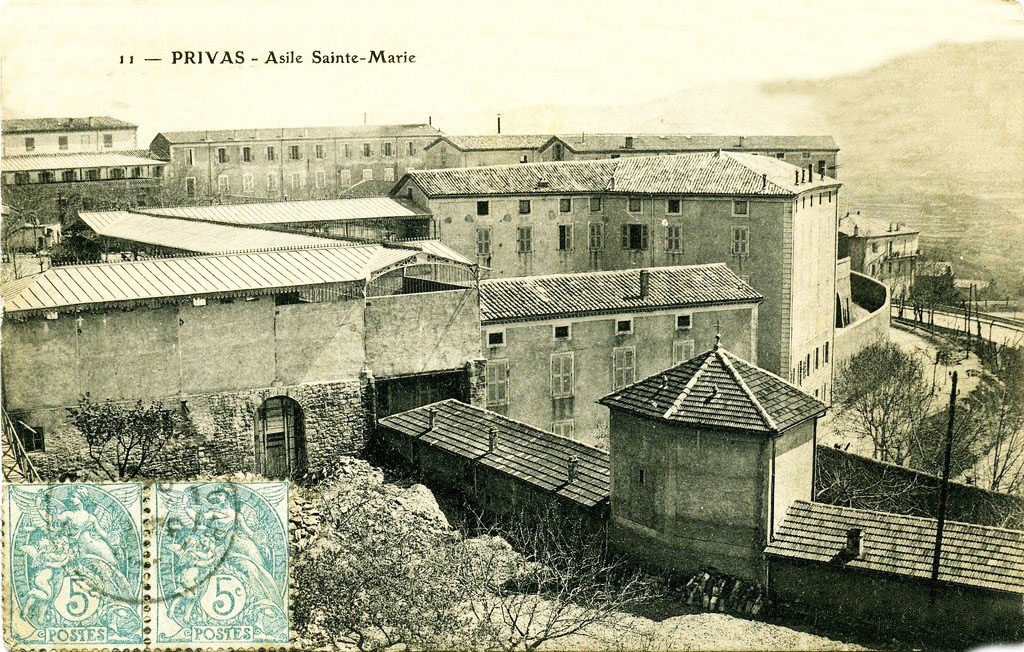
L'asile Sainte-Marie à Privas
créé par Joseph Chiron en 1827 |
Néanmoins, le
Père Chiron possède
une caractéristique épuisante pour ses proches : il a la
bougeotte, et toute sa vie n'est que déplacements et marches
interminables.
1830 - Des ressources financières inexpliquées
L'année 1830 marque toutefois un changement dans son
comportement. Alors que jusque là le Père Chiron
présente tous les signes d'une pauvreté exemplaire,
certains faits à cette époque montrent qu'il détient tout
d'un coup des ressources pécuniaires conséquentes permettant
de poursuivre sereinement son œuvre en achetant des
propriétés pour les convertir en hôpital.
Un exemple concerne une offre ferme que Joseph
Chiron fit d'un montant de 120 000 francs comptant,
une somme énorme pour l’époque, au propriétaire de l’ancien
monastère de St‑Alyre. La tractation secrète
n’aboutit pas, mais laissèrent perplexes les historiens de la
Congrégation Sainte‑Marie bien des années après la mort de
son fondateur lorsqu’ils purent mettre la main sur sa volumineuse correspondance.
1839 - Le Père Chiron
poursuit ses investissements
Malgré un travail incessant, usé,
poursuivant des marches interminables, fatigué par l'ascèse,
le Père Chiron
continue son oeuvre.
En
1839,
il installe à
La Cellette
en Corrèze une communauté de
frères servants dans les bâtiments que
Frère Hilarion avait réservés
sept ans
auparavant pour la création d'un asile en
1831. Un siècle plus tard,
leur communauté deviendra l'Ordre de
Saint Jean de Dieu.
Il finira enfin par ouvrir l’Hôpital Sainte Marie dans
le Puy en 1850.
1840 - La société civile Sainte Marie
Afin de protéger les établissements appartenant à l'institution
Sainte-Marie, le Père Chiron crée le 28 août 1840 la
Société Civile Sainte Marie. Cette dernière
est composée
d’un administrateur aidé d’un conseil et de
sociétaires. En 1843, le Père Chiron laisse la direction des
établissements au Père Jean-Marie Bal
et la Société Civile
Sainte-Marie acquiert l'Asile de La Cellette (Corrèze)
en
1842,
Puy-en-Velay en
1850,
l'Asile de Saint-Pons en
1862 à Nice, et l'Asile
de Rodez situé à
Cayssiols (Aveyron) en 1931.
Nous y voilà...
Le site de Nice
Saint-André fut acheté en 1862 par la société civile
Sainte Marie dont le fondateur est le Père Joseph
Chiron, avec les terrains comprenant la fameuse
colline pyramide aujourd'hui disparue...
1843 - Une pause à l'Ermitage de Galamus
Le 24 février 1843
l'infatigable marcheur va effectuer un
périple impensable : Valence, Avignon, Nîmes, Montpellier,
Béziers et Narbonne, pour finalement aboutir un mois plus
tard à
l'Ermitage de Galamus
le
24 mars
1843
à côté de
St‑Paul de Fenouillet non loin du
Bugarach, un
lieu
extraordinaire creusé dans la roche à flanc de falaise. Le Père Joseph Chiron s'y retire
alors en tant qu'ermite anonyme sous le nom de
Père Marie. Cette vie
d'ermite ne l'empêchera pas de garder certaines
relations repérées par les historiens comme un certain
Mr Pasquier,
orfèvre et spécialiste dans la reconversion
d'objets précieux...
1852 - Joseph Chiron s'éteint à ND du Cros
À
55 ans,
Joseph Chiron est fatigué et usé.
Affaibli par sa vie érémitique, ses privations et ses
longues marches, il ressent une fin proche. Courant
1852, il prend
alors la décision de rejoindre ND du Cros et il y arrive
avec le Père Eugène de Potriés le 18 juin 1852. L'objectif officiel
est de fonder un ermitage avec l'aide de Mgr de Bonnechose.
Eugène de Potriés tombe sous le charme du lieu et
fait les démarches auprès de
l'évêque de Carcassonne pour obtenir la jouissance du
sanctuaire.
Mais, épuisé par une vie de peine et de sacrifices, terrassé par
la maladie, le
Père Joseph Chiron dit
Père Marie
s'éteint finalement en odeur de sainteté le 27 décembre
de cette même année. Et c'est
avec l'autorisation de l'évêque de Carcassonne Mgr de Bonnechose qu'il
est inhumé sous le porche d'entrée du sanctuaire de ND du
Cros.
Ses obsèques auront lieu le
30 décembre 1852
et une foule innombrable
rejoindra le sanctuaire dès l’annonce du décès. Sa tunique
sera partagée entre les fidèles.
|
|

La sépulture de Joseph Chiron
sous le porche à ND du Cros
|
|
Pourquoi le Père Joseph Chiron
est‑il lié
à
Rennes‑le‑Château ?
Joseph
Chiron est associé à ND du
Cros, ce lieu représentant la dernière étape du prêtre
marcheur. Or, l'église de
ND du Cros est non seulement citée dans l'opuscule du
Serpent Rouge, mais
également par
Henri Boudet dans son
livre codé "La Vraie Langue Celtique".
Il faut dire que la chapelle est sentimentalement importante
pour Boudet puisque l'un de ses ancêtres, Antoine Boudet, sauva le sanctuaire de la destruction
révolutionnaire.
Ajoutons
à ceci un épisode important :
Gaudéric Mêche fut
de 1831 à
1838 aumônier à
ND de Marceille
et son histoire fut remarquée pour avoir
facilité de façon très mystérieuse la rénovation du
sanctuaire de Limoux. En
1838, il quitta contre son
gré ND de Marceille et devint chanoine à
ND du
Cros à partir de
1854. C'est alors qu'il engagea également des
travaux de rénovation dans le sanctuaire sans que l'on
connaisse ses ressources financières.
Et à partir du
16 juin 1862,
un évènement crucial pour l'histoire de Rennes‑le‑Château va
se dérouler ici, car ce fut à cette époque qu'il reçut en
formation un tout jeune prêtre,
Henri Boudet,
installé en tant que vicaire à quelques kilomètres, à l'abbaye de
Caunes-Minervois.
Or, ces liens
n'auraient pas été faciles à mettre en évidence sans
l'ingéniosité de l'abbé Boudet. En effet, il est passionnant de retrouver le
Père Chiron déguisé en
Saint Antoine Ermite
dans l'église de Rennes‑le‑Château
ou sur la station XIV
du chemin de croix
assimilé à Joseph d'Arimathie.
Joseph Chiron fut en effet ermite à Saint Antoine de
Galamus. Il était donc aisé de le mettre en scène
en tant que saint Antoine Ermite. Quant à son effigie
sur
la station XIV, l'astuce du codage est de rapprocher
Joseph Chiron de Joseph d'Arimathie.
|
 |
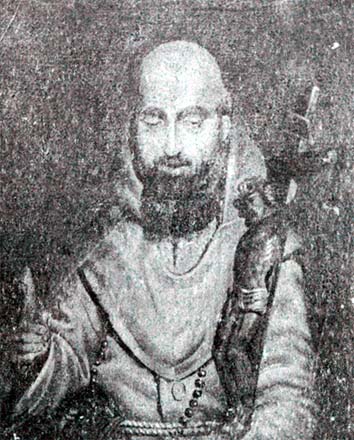 Le
Père Joseph Chiron Le
Père Joseph Chiron
À gauche, Saint Antoine Ermite
en habit franciscain et son cochon (sanglier)
La ressemblance est criante
|
| A noter que
de nombreuses références au livre culte de
Boudet "La Vraie Langue Celtique"
ont été glissées dans les ornements de l'église
Marie-Madeleine. C'est le cas ici avec le cochon de
Saint-Antoine déguisé en sanglier par l'ajout de
deux défenses. Pour plus de détails sur la
signification de ce codage, voir
ND du Cros
Joseph Chiron, et
Boudet et ses écrits, le sanglier
d'Hérymanthe.
|
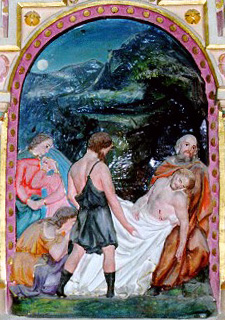
La station XIV dans l'église de
Rennes‑le‑Château
et Joseph d'Arimathie portant Jésus |

On retrouve le visage de
Saint Antoine Ermite
alias Joseph Chiron
|
L'hôpital Sainte Marie de Nice
Saint-André
Nous voici donc en
présence d'une connexion improbable, d'un point de
rencontre étonnant entre deux histoires qui n'ont a
priori aucun lien entre elles et pourtant... Qui aurait
pu croire qu'un ermite marcheur,
Joseph Chiron, codifié dans l'église de
Rennes-le-Château, serait à l'origine d'une acquisition
pour aliénés à Nice comprenant une curieuse structure
pyramidale aujourd'hui disparue ?
Une chose est sûre : la communauté religieuse Sainte Marie
ex-propriétaire de la fameuse pyramide devait posséder
quelques informations sur son histoire. Avouez que le sujet ne manque pas
de sel. Il est surtout fascinant de
voir ce qu'est devenue cette acquisition à Nice. Une ancienne gravure
montre le vaste domaine médical Sainte Marie installé au bord du
Paillon à l'époque, et on ne peut qu'être étonné de son
importance... Comment la communauté a-t-elle pu être
aussi prospère ?
|

Le centre hospitalier
Sainte Marie à Nice Saint-André
La pyramide non visible sur la gravure se trouve à droite
en prolongation des bâtiments |
| En comparant
l'entrée principale actuelle du centre hospitalier et
l'ancienne gravure, on peut facilement retrouver la
façade du bâtiment perdue au milieu des nombreuses
dépendances. |

Le centre hospitalier
Sainte Marie à Nice Saint-André
L'entrée principale aujourd'hui |
|
Le domaine Sainte-Marie était immense et s'étalait sur
la rive du Paillon, englobant la mystérieuse colline
pyramidale aujourd'hui remplacée par un vaste réseau
autoroutier et un parking. |

Vue actuelle du site de
Saint-André à Nice
À gauche le centre hospitalier
Saint-Marie
À droite, le parking privé de l'hôpital et le site de la Grande Pyramide |
|
L'histoire de l'hôpital
Sainte Marie de Nice
En 1860, un certain
Père BAL
rencontre Mgr SOLA, évêque de
Nice,
en vue d’ouvrir un nouvel asile.
Or,
rappelez-vous...
Afin de protéger les établissements de l'institution
Sainte Marie, le Père Chiron crée le 28 août 1840 la
Société Civile Sainte Marie. Et en 1843, le Père Chiron laisse la direction au Père Jean-Marie Bal
et la Société Civile
Sainte-Marie acquiert entre autres
l'Asile de Saint-Pons en
1862 à Nice.
|
Trois premières religieuses y arrivent le
7 décembre
1862 et elles baptisent les lieux « asile Saint-Michel-la
Beaume ».
L’inauguration a lieu le 8 mai 1867,
mais pour les Niçois, il devient « L’asile de Saint-Pons » en
raison de sa proximité avec le monastère de Saint-Pons.
Plusieurs bâtiments sont construits pour répondre aux
besoins. Malheureusement, le 3 avril 1875, un terrible incendie détruit
le bâtiment principal. Il est alors reconstruit en
1876. Mais, soubresaut de l'Histoire,
le 18 février 1944, l’Hôpital Sainte Marie
de Nice
est évacué pour se consacrer aux malades détenus
politiques de décembre 1944 à novembre
1945. |

Mgr Sola - Premier évêque de
Nice |
|
A la fin de
la guerre, l’activité médicale reprendra et les patients réintégreront les locaux le 1er mars
1946.
À partir des années 1960, d'autres bâtiments seront
construits donnant à l’hôpital son aspect actuel. Il
finira par prendre en charge tous les patients du
département des Alpes-Maritimes jusqu'en 1975.
Une rare
photo montre le domaine Sainte Marie de
Nice en 1930 avec sa mystérieuse
pyramide nettement visible à droite.
|
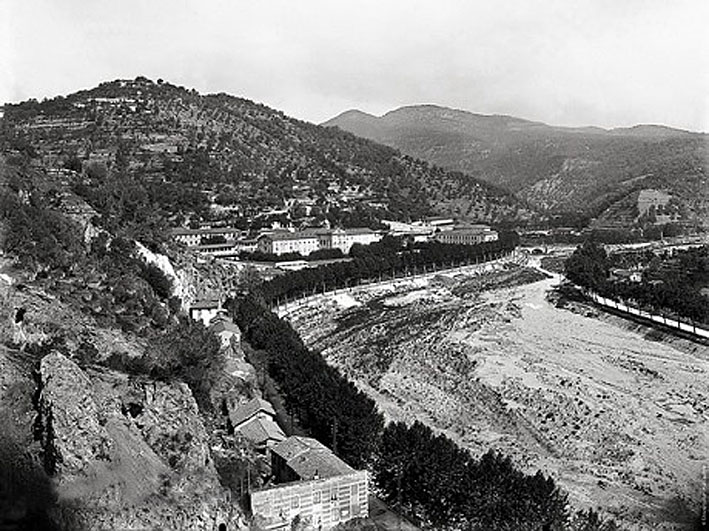
La vallée du Paillon en 1930
- La pyramide est visible à droite
Le centre hospitalier
Sainte-Marie au centre s'étale le long du Paillon
La communauté religieuse était propriétaire des terrains, Pyramide incluse... |
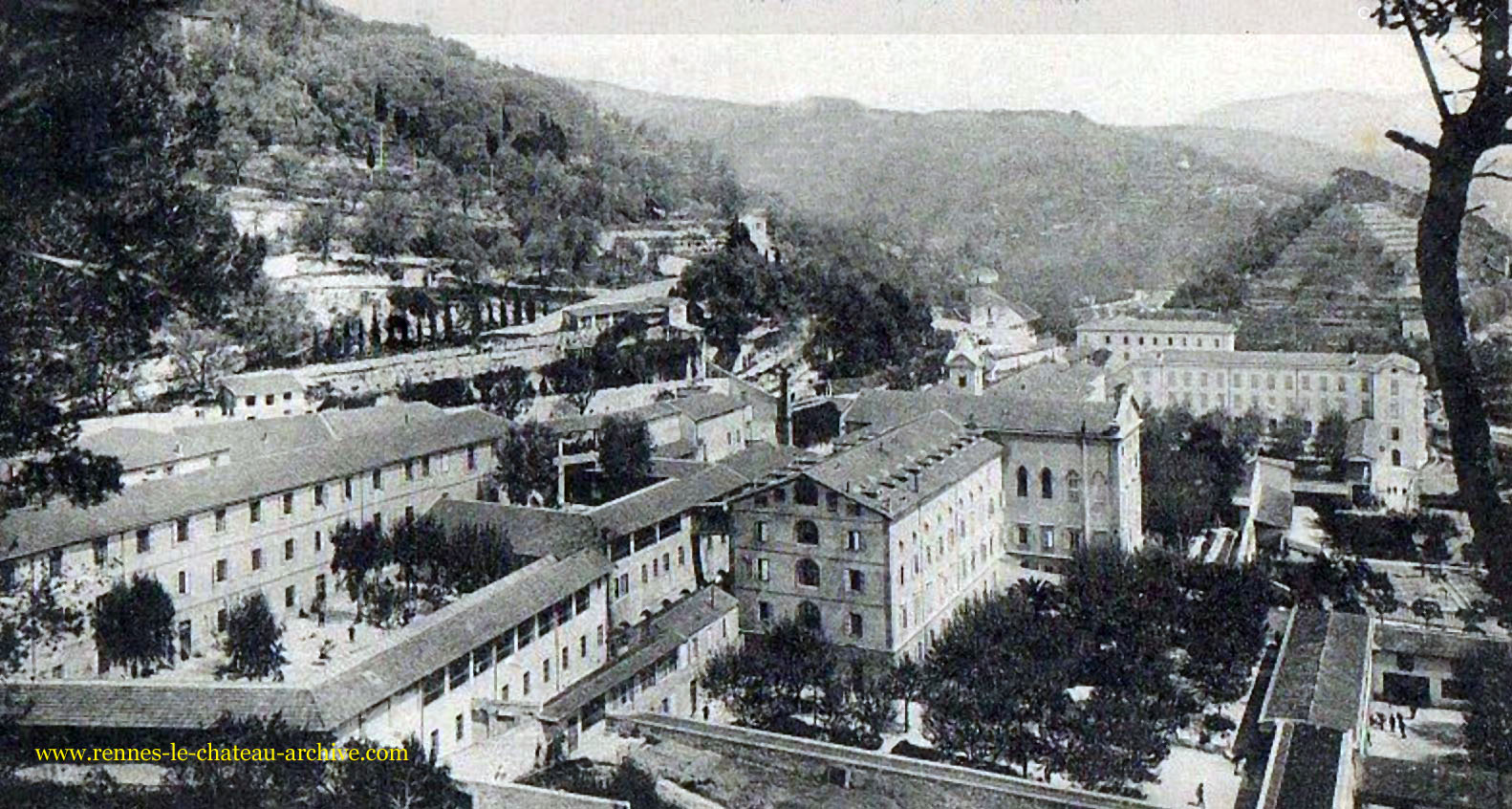
Le centre hospitalier était
auparavant l'asile des aliénés Saint-Pons à Nice
La pyramide qui fait partie du domaine est visible en
arrière-plan à droite |
|
Finalement, la Loi du 22 novembre
1972 abroge les sociétés
civiles non commerciales et oblige l’institution à
changer de statut.
C’est donc en 1974 que l’institution, alors Société Civile
Sainte Marie fondée en 1827, devient l’Association
Hospitalière Sainte Marie (AHSM).
Depuis, elle assure
dans le cadre de sa mission de service public,
des activités de prévention, de soin, de post-cure en
psychiatrie générale et
infanto-juvénile, prenant ainsi en charge des publics
divers : enfants, adolescents, adultes et
personnes âgées.
Aujourd'hui, l’Association Hospitalière Sainte Marie gère
46 établissements (sanitaires, sociaux, médico-sociaux,
instituts de formation) répartis sur huit départements :
Allier,
Alpes-Maritimes,
Ardèche,
Aveyron,
Drôme,
Haute-Loire,
Puy-de-Dôme et
Rhône.
De plus, cinq établissements
psychiatriques dépendent de l'Association
Sainte‑Marie :
Privas (Ardèche), Clermont‑Ferrand (Puy‑de‑Dôme), Montredon
(Le‑Puy‑en‑Velay, Haute‑Loire),
Nice (Saint‑Pons,
Alpes‑Maritimes) et Cayssiols près de Rodez (Aveyron)
Le moins que
l'on puisse affirmer c'est que Joseph Chiron, prêtre
marcheur pratiquant l'ascèse et la pauvreté extrême, nous
a laissé derrière lui des valeurs immobilières et un empire hospitalier
insoupçonné... Malheureusement, qui s'en rappelle
aujourd'hui ?
|
| Une pyramide
méditerranéenne qui bouscule l'Histoire |
Comment l'insérer dans l'Histoire ?
S'agissait-il d'une pyramide ? L'intérêt
que porte aujourd'hui le grand public sur l'archéologie
dite "interdite" est grandissant, et la seule hypothèse
de la présence d'une pyramide dans la région niçoise
provoque réactions et controverses. Il est
malheureusement trop tard pour qu'une analyse de terrain
puisse être conduite.
Sa
disparition est
choquante, inexplicable, incompréhensible, et soulève de nombreuses
questions. Comment a-t-on pu laisser
s’installer une telle indifférence de la part des
historiens, des
archéologues, des élus
et des autorités ? Comment peut-on imaginer que les
institutions de recherches archéologiques n'est pas
été alertées lors de la mise en place du programme de destruction ? Car nous ne sommes pas en présence
d'une simple ruine ou d'un
chantier qui aurait mis à jour quelques vestiges. Le monument est immense, connu
depuis longtemps par la population locale, et intégré
dans le patrimoine de la région. Il présente deux faces caractéristiques
qui ne peuvent passer inaperçues, et même si la qualification de « pyramide »
est abusive, il s’agit bien d’une perte irremplaçable pour
la science et l’Histoire en général.
Quelques structures pyramidales existent en Europe comme celle de
Barbenez en Bretagne.
La construction date du Néolithique entre 4500 et
3500 ans av. J.-C. une période correspondant à la
sédentarisation de l'Homme
éleveur-agriculteur. Signalé comme tumulus en 1850,
le site est redécouvert en 1955 lors d'une
exploitation de carrière. Et de 1955 à 1968, les
fouilles vont redonner son aspect d'origine. D'une
longueur de 75 m,
deux cairns en pierres sèches accolés recouvrent onze
dolmens à couloir, et l'ensemble représente tout
simplement le plus grand mausolée mégalithique après
celui de Newgrange. L'édifice extérieur prend la forme
de grands paliers en terrasse, et s'il avait été placé
en Provence, on les aurait qualifiés de restanques. |

Le cairn de Barnenez en
Bretagne, un immense monument mégalithique
du Néolithique aux accents de pyramide |
|
Il
y a aussi le site de
Güímar sur l’Île de Ténériffe
aux Canaries. Les pyramides
se trouvent dans le village de Güímar situé sur la côte
Est de l’Île de Tenerife, sur l’archipel des Îles
Canaries en Espagne. Il existe au total
six pyramides à marches en
pierres sèches dont
l'origine est inconnue. Leur construction pourrait
remonter au
XIXe siècle, mais
rien ne le prouve. |

L'une des pyramides de Güimar
sur l'Île de Ténériffe aux Canaries |
Un autre exemple est celui de
Monte d'Accoddi en Sardaigne
ou une pyramide à marches déconcerte les archéologues.
Le mont d'Accoddi est
un site mégalithique situé en Sardaigne entre Sassari et
Porto Torres. La première phase de construction est sans
doute contemporaine de la culture d'Ozieri entre
4300 et 3700 av. J.-C.
Le site fut découvert en
1947 et exploré en
1954.
Diversement décrit comme un autel, un temple, ou une
pyramide, il a été partiellement reconstruit pendant les
années 1980.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la partie
supérieure de la pyramide a malheureusement été
endommagée. |

La pyramide de Monte
d'Accoddi en Sardaigne |
|
Selon des témoignages, au sommet de la pyramide
de Nice se trouvait un grand
dolmen, ce qui pourrait indiquer que le site était
important, voire sacré. On peut aussi supposer que sa construction se situerait
entre 4000 et 3500 ans
av. J.-C. une période où l'on trouve d'autres pyramides européennes.
La pyramide de Nice
constituerait alors un témoignage important d'une
civilisation européenne qui vécut sur le continent
avant l’apparition de l’Empire romain et du
christianisme. Elle rejoindrait alors le mythe des
Pelasges appelés aussi "les peuples de la mer" qui
auraient abandonné les terres fertiles du bassin de la
Mer Noire pour s'installer sur la côte méditerranéene.
|

Photo aérienne 1953 (image
Google Earth)
La pyramide est nettement
visible sur ses deux faces sud-ouest |
|
La pyramide
de Nice était sur le site de l'Abadie
(l’Abadia ou la Badia) qui veut dire «
l’Abbaye » en niçois, une vaste colline longtemps délaissée
entre l’Observatoire de Nice et Rimiez, et dont la vue s'étend
jusqu'à l'Estérel. Quatre communes se partagent encore son territoire :
Nice, Saint André de la Roche, Tourrette-Levens et
Cantaron. On y trouvait quelques
cabanons pour y faire pousser des légumes. Après la
Guerre, on y allait encore à pied chercher le lait chez
"Tante Honorine", une des rares fermes qui demeuraient
encore. D’abord jardin potager des moines, la colline
était surtout
consacrée à la culture de l’olivier à partir du XVIIe siècle. On y rencontre encore aujourd'hui de magnifiques
spécimens au milieu des villas. Jardin potager des
moines ? En effet, la Badia
était une
puissante abbaye, dépendance de l’Abbaye de Saint-Pons,
dont on peut voir encore la très belle église sur la
colline au-dessus de l’hôpital Pasteur. Nombre d’actes
notariés et d’allégeances aux Princes de Savoie dont
Nice dépendait l'attestent.
|

Peinture montrant l'abbaye de
Saint-Pons au XVIIe siècle
Observez bien... On devine la pyramide et ses
marches
en arrière-plan derrière la végétation... |
|
L’abbaye Saint-Pons est l'un des plus
anciens monastères de la Côte d'Azur avec l’abbaye des
îles de Lérins. Selon la tradition, la paroisse aurait
été construite sur le tombeau du martyr Saint-Pons. L'église est classée au titre des monuments
historiques depuis 1913.
|
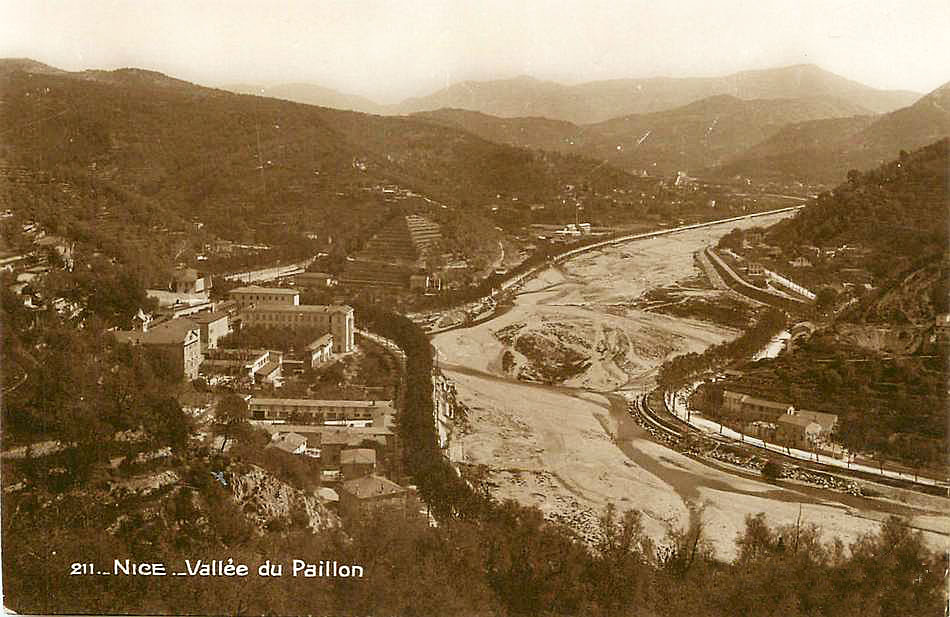
La vallée du Paillon -
L'hôpital Sainte-Marie à droite et la pyramide |
|
La mystérieuse
pyramide était située sur la première collinette de
la montée de l'Abadie, au
confluent du Paillon et de la Banquière, le Paillon
de Saint-André. Avant d'être complètement détruite,
elle servait de carrière au début du XXe siècle. Des
camions venaient y extraire la roche pour la
construction des immeubles niçois. Cette destruction
programmée rappelle malheureusement celle du Trophée
d’Auguste à la Turbie, dont les blocs récupérés
servirent à l’édification de nombreuses maisons du
village.
La pyramide s'appelait "la pyramide du
Merindol". Le nom lui a été donné il y a un
millier d’années par le seigneur Rostaing, vicomte
de Nice, qui fit donation du territoire
saint-andréen et abadien à l’abbaye de Saint-Pons
en 999. Il se prénommait Miron et
son épouse Odile, d’où le nom de « merindol ».
Faut-il en déduire que la pyramide existait déjà à
cette époque, balayant l'hypothèse de restanques
construites au 19e siècle ?
Le site
de l'Abadie possède aussi un passé antique important. La
colline était en effet traversée par une voie dallée édifiée par les Romains.
De plus, un oppidum existe à son sommet. Cette voie
romaine qui reliait Cimiez aux Alpes passait par le
site de la pyramide. Cette voie est devenue aujourd’hui le Vieux chemin de
l’Abadie.
|

Sur la carte d'État Major 1820-1866,
à l'emplacement de la
pyramide (en jaune)
une forte surélévation
a été
notée avec un point culminant |
| D'autres curiosités
dans le secteur de Saint André |
La pyramide de
Falicon et sa grotte
Les alentours de Saint André de la Roche ne manque pas non plus d'intérêt puisqu'une autre
pyramide très proche existe, celle de
Falicon. La commune est située sur l'une
des collines qui surplombent Nice, entre Aspremont,
Saint André de la Roche et Tourrette-Levens, face
au Mont Chauve. A une altitude de 434 m, sur les
pentes du Mont Chauve, une petite pyramide très
dégradée excite les imaginations depuis 1920.
L'histoire débute en 1803 alors que l'ancien Comté de Nice est devenu un
département français. Un curieux personnage à la fois
poète et écrivain, passionné d'archéologie, se promène
sur le terroir de Falicon. Il s'agit de
Domenico
Rossetti, un italien en vacances.
Apprenant
l’existence à flanc de colline d’une mystérieuse
excavation d’où s’échappent le soir des chauves-souris
(ratapignata), il décide d’explorer l'aven. La faille
mène à une quinzaine de mètres de profondeur à une vaste
grotte garnie de stalactites et de stalagmites, et
une large colonne de calcite joint le sol au plafond.
Mieux encore, dans un coin de la grotte, une ouverture
au ras du sol donne accès à un puits vertical étroit qui
débouche plus bas dans une autre excavation, une faille
qui semble se prolonger dans les entrailles de la terre.
Le fond est aujourd'hui évalué à 44 m de l’entrée. L'avocat,
émerveillé par sa découverte, tient absolument à
l’officialiser et écrit un livre en prose et en vers
« La Grotta di Monte Calvo » qui sera édité à Turin
un an plus tard en
1804. |

La grotte de Falicon -
Gravure extraite du livre de Rossetti |
Et ce n'est pas
tout. L'entrée de la grotte des « Ratapignata » est
surmontée par une structure pyramidale
tronquée actuellement en fort mauvais état. Sa
forme pointue à l’origine ne devait pas excéder une
hauteur de dix mètres. Construite à la romaine à l'aide
de pierres liées par un mortier avec colmatage de
briquettes et de morceaux de tuile, la pyramide était
certainement recouverte jadis par un
enduit dont il reste çà et là quelques
vestiges.
Quelle est la date de cette pyramide ? Personne ne le sait, mais
une chose est sûre : dans son livre, Domenico
Rossetti en fait mention au travers d'une
gravure (ci-contre). On y voit l'auteur pointant
l'édifice sous sa forme d'origine. Pourtant, son récit
ne la mentionne pas. |

Domenico Rossetti |
|
Faut-il en déduire qu'il serait
l'artisan de l'édifice ? Rien ne le prouve,
mais il
est difficile d'imaginer que ce poète archéologue
ait pu se lancer dans une telle entreprise dans un
endroit aussi difficile d'accès... N'oublions pas
que sa découverte date de 1803 et
qu'il édita son livre en 1804. Le
mystère est donc entier.
Durant
un siècle, des ouvrages ne manqueront pas de mentionner le site
en décrivant tous les détails
de la salle principale la plus visitée.
Paradoxalement, rien n'est dit sur la curieuse
construction protégeant l'entrée du gouffre. En
1901, un
spéléologue, Jules Gavet, organise une exploration
de la grotte. Des croquis et des
mensurations sont produits. Par contre, aucun dessin ou
aucune photo ne montre la pyramide. Il faudra
attendre 1928 pour que l'étrange
structure retienne toute l'attention, reléguant le
gouffre au second plan. La pyramide de
Falicon garde décidement son mystère...
|

La pyramide de Falicon proche
de la pyramide de Nice |
La grotte de
Saint-André
Autre curiosité, la présence d'une grotte remarquable : la grotte
de Saint-André, une arche naturelle de 50 mètres
constituée par une perte du torrent de la Banquière.
Le pont naturel ainsi formé permet l'accès sud à la
carrière de Saint-André. Près de l'entrée amont de
la galerie, en rive gauche, une source délivre une
eau tiède à température constante entre 17°C et 18°C
qui est connue depuis le
XIXe siècle.
Lamartine lui dédiera même un poème...
|

La grotte de Saint André non
loin de la Pyramide de Nice |
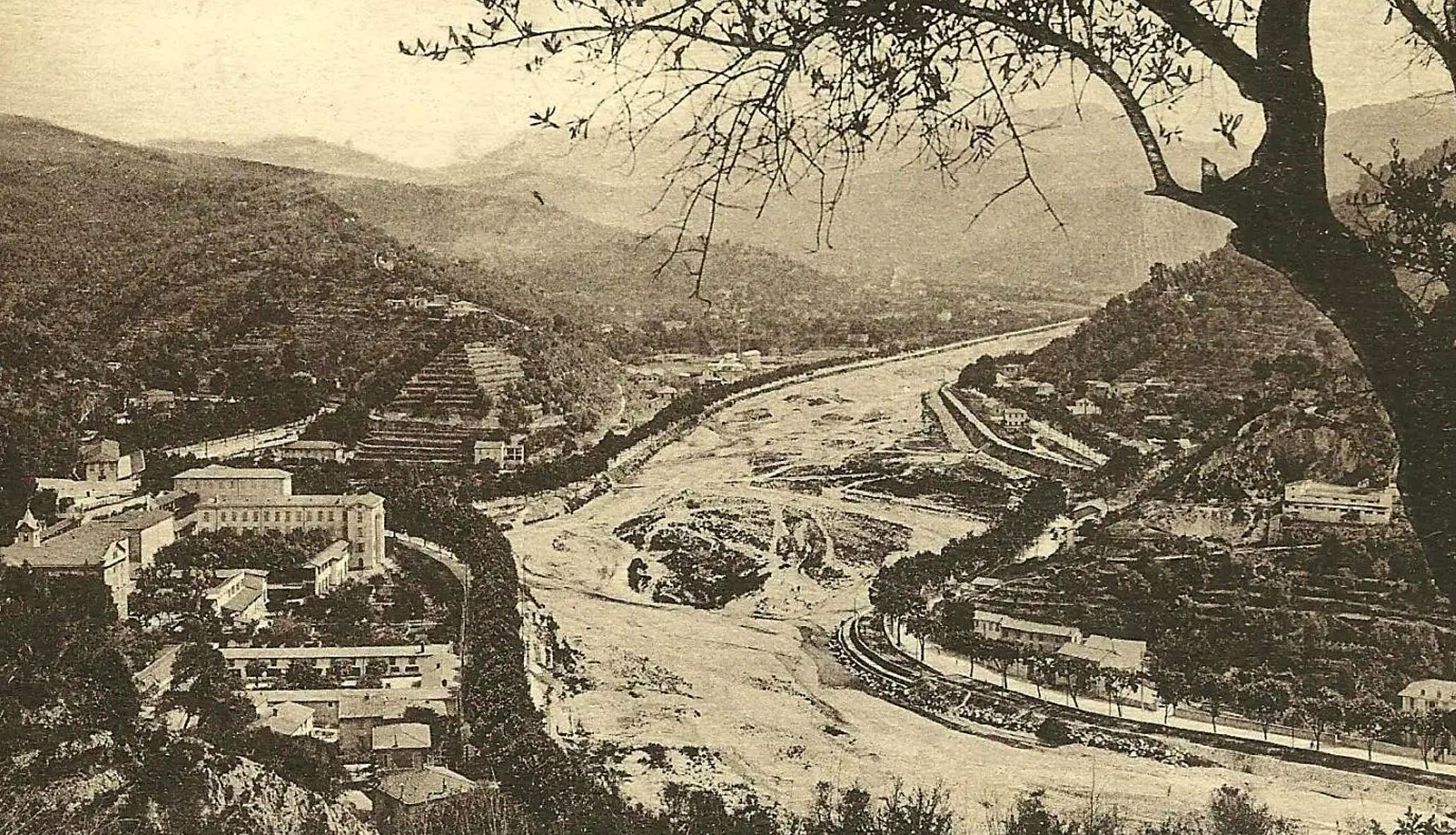
La vallée du Paillon du temps
où la pyramide existait encore |
Finalement, peut-on résumer la pyramide à degrés de Nice
par un agencement de simples restanques provençales comme certains
l'affirment ?
Ce dossier montre combien il est difficile
de juger un fait d'Histoire
ou une curiosité
hypothétiquement archéologique sans en apprécier
tous
les contours, même improbables...
Qui aurait pu
imaginer que la colline basse d'Abadie à Nice avait été acheté en
1862 par la société civile
Sainte Marie, une communauté religieuse fondée par le Père Joseph Chiron,
un prêtre ermite lié à l'affaire de Rennes-le-Château et
codifié dans l'église Marie-Madeleine ? Qui
aurait pu croire que ce monumental escalier pyramidal détruit en
toute discrétion allait réveiller quelques consciences
et soulever bien des questions ?
Assurément, la pyramide de Nice demeure un mystère : qui l’a construite ?
Quand ? Pourquoi ? Selon certains, elle aurait été érigée avant
les invasions romaines, il y a plus de 2000 ans. On retrouve
en effet des pyramides de ce type au Proche
Orient, datées de trois ou quatre mille ans.
D'autres la font remonter aux Ligures, des Celtes de
l’Antiquité qui colonisaient la région niçoise. Et si
cette structure était la trace d'une civilisation
encore plus ancienne et méconnue ? Une civilisation
capable de tels ouvrages ? Nous voici devant une
véritable lacune historique que l'on aura beaucoup de
mal à combler.
Ce dossier
devait être publié, une manière de montrer et de
conserver la mémoire d'un lieu historique effacé à
jamais. Dans quelques décennies, les témoins
de sa présence auront aussi disparu et on ne saura plus
rien de ce monument incroyable. La pyramide deviendra alors une
légende liée à une autre, celle des deux Rennes...
Pyramide ? Structure
à degrés
? Ancienne
forteresse ? Vestige antique ?
Traces celtes ?
Anciennes terrasses de cultures ? Peu importe... Le fait est que ce
témoin du passé n'aurait jamais dû disparaître
sans un minimum d'étude et d'expertise. Mais voulait-on vraiment examiner
de près cette anomalie niçoise au risque de stopper net
un projet urbain d'envergure ?
|

Article du journal Nice-Matin
paru en 2017 |
|
|



