|
|
Quelle curieuse excursion que celle
décrite par Elie Tisseyre dans sa note publiée au
bulletin annuel 1906 de la
S.E.SA. (Société d'Étude Scientifique de l'Aude), une note qui fut envoyée à tous les
membres.
Rappelons les faits : un
petit groupe de la
S.E.S.A. part en excursion le
25 juin 1905. Le but est, semble‑t‑il, de
prendre connaissance de l'environnement archéologique de
Rennes‑le‑Château. La visite est organisée depuis un point
de rendez‑vous situé à la gare de
Couiza et va durer
une journée.
Derrière le récit d'Elie Tisseyre
empreint d'une certaine nostalgie se cache un texte
curieux. Pourquoi ? Si on analyse son contenu, il est facile
de s'apercevoir de certaines incohérences dans les propos.
La description générale est futile et ressemble à une
rédaction scolaire écrite par un jeune écolier décrivant sa
journée à la campagne. Le style est en tout cas très éloigné
d'un rapport d'étude archéologique. Mais le plus curieux est
l'absence d'étonnement devant le site de Rennes‑le‑Château.
La découverte du village ne produit aucune réaction, aucune
surprise parmi les membres. Tout est normal, et seule la vue
exceptionnelle sur la petite colline "le Casteillas"
semble impressionner nos touristes archéologues. La Tour Magdala
devient ici "Une tour de construction récente"
et
l'église Marie Madeleine
est une paroisse classique avec "ses jolies peintures
fraîches et riantes". Pas un mot sur
Bérenger Saunière, le seigneur des lieux. Aucune
allusion sur ses mystérieux agissements. Pas une phrase sur
son
Domaine
extraordinaire qui fera l'attraction de tous les visiteurs.
Nous sommes en
1905, un an tout juste après la fin des travaux du
Domaine. Les constructions de Saunière respirent le neuf et
les jardins tirés à la règle sont du plus bel effet. Voilà
donc un sujet d'étonnement qu'Elie Tisseyre et ses
collègues auraient pu souligner, plutôt que de décrire le
nombre de tibias contenus dans l'ossuaire.
Tout serait donc normal
dans cette publication surréaliste ? Pas vraiment. En fait
le texte donne le ton et joue avec les contradictions. Car
le petit groupe va regarder de près certains détails et pas
n'importe lesquels. Pourquoi relever une dalle brisée en
deux que l'on comprend être la
stèle de la Marquise de Blanchefort ? Pourquoi ne
décrire que celle‑ci alors que les membres de la
famille se trouvent dans le petit cimetière où les
sépultures abondent ?
Mais il y a plus
étonnant, et ceci montre à quel point on doit lire mot à mot
ces quelques pages remplies d'enseignements.
|
Une visite au cimetière nous fait découvrir
dans un coin une large dalle, brisée dans son
milieu, où on peut lire une inscription gravée
très grossièrement. Cette dalle mesure 1m3o sur
0m65. |
|
|
Comment peut‑on croire à de telles incohérences puisque, associé
à cette dalle brisée en deux et qui a été mesurée avec
précision, on trouve plus loin quelques lignes avec un relevé
dessiné très précis.
Le moins que l'on puisse dire est que l'inscription gravée
soi‑disant
"très grossièrement" est particulièrement lisible,
suffisamment pour en proposer une copie parfaite.
Curieux aussi cette publication de la stèle émanant d'une équipe
d'archéologues qui ne décrit même pas la fracture de la pierre.
Et que dire de la célèbre
dalle de Blanchefort
qui
semble inexistante ? Elle ne devrait pourtant pas être très loin
? |

La stèle de Blanchefort
(Pierre tombale verticale)
Version de la S.E.SA 1906
|
|
Ceux qui ont
pratiqué les techniques de relevé archéologique savent qu'il
est extrêmement difficile de recopier un texte ou un dessin
en respectant toutes les proportions et les imperfections,
le tout sur un support fragmenté et irrégulier. Ce travail
demande souvent quelques heures et un outillage particulier,
ce qui est parfaitement incompatible avec le programme
minuté de cette excursion.
Or nous
savons aujourd'hui que le relevé de
la stèle
publié par
Gérard de Sède en
1967 dans "L'Or de Rennes" est d'une précision
remarquable. Ses nombreuses propriétés géométriques en sont
la preuve. Il est donc évident que ce dessin n'est pas la
copie exacte de la stèle, mais plutôt son modèle qui est
aussi un savant codage et qu'il faut relier à d'autres
indices...
La stèle
n'existerait donc pas ? Ce n'est pas simple. En fait,
l'authentique stèle de Blanchefort aurait disparu dans les
années 1905, et il faut relire les classiques et
redécouvrir certaines images pour créer le doute. Il existe
en effet deux photos importantes aujourd'hui oubliées. Elles
montrent la stèle ornée de l'épitaphe que nous connaissons
bien... |
|
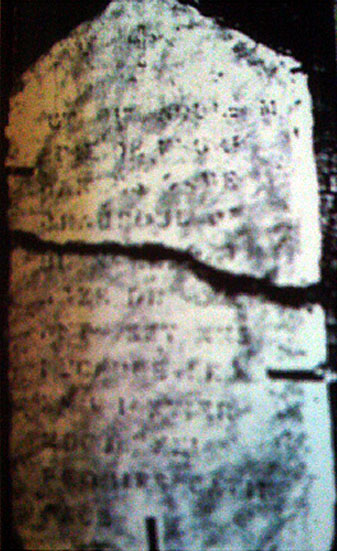
Extrait des archives de
Pierre Plantard
(BNF)
Les crochets muraux sont
nettement visibles
|

Photo présumée de la stèle
(Extrait du livre de JP Deloux et
"RLC Capitale secrète" 1982
par J. Brétigny |
|
La première
photographie (à gauche) provient du dossier d'archive "Le
Cercle" de
Pierre Plantard déposé à la BNF. On y voit la stèle, brisée
en deux comme le décrit la note de la S.E.S.A. et maintenue par
des crochets muraux. L'épitaphe est légèrement visible et la
photographie est accompagnée d'un commentaire : |
| La dalle portant l'épitaphe
de Marie de Negri d'Ables, dame d'Hautpoul, était brisée en son
milieu. Elle gisait, abandonnée, dans un coin du cimetière. On
l'a soustraite, en la mettant à l'abri, aux dommages qu'elle
aurait encore pu subir. Qu'on en soit sûr, elle existe toujours.
Mais on ne la montre pas, car on préfère, et on a pour cela de
nombreuses raisons, ne point la livrer sans protection à la
curiosité des dévots de Rennes‑le‑Château.
La pierre tombale
Négri n'appartient pas à la commune de Rennes‑Le‑Château, ni à
la nation, mais à la Maison directe des Hautpoul de Rennes qui a
autorisé René Descadeillas à retirer cette dalle du cimetière en
1971.
Extrait "Le Cercle" de P.
Plantard |
|
Il faut ajouter à cette étrange
publication de la S.E.S.A. des erreurs grossières. Il y a par
exemple l'excursion du 25 juin qui s'est déroulée dans la
note le
24 juin. Il y a aussi ce trajet depuis la gare de
Couiza qui passe devant le château des Ducs de Joyeuse, alors
que la route en 1905 n'existait pas. Nous avons également
la visite de la Tour Magdala
qui n'était pas encore accessible en
juin 1905 du fait des planchers qui ne seront posés qu'en
1906.
Le panorama qui est décrit est
tout aussi fantaisiste puisqu'il est impossible de voir
Couiza ou le château en ruines de
Coustaussa
depuis la Tour Magdala. Même l'église Marie‑Madeleine
n'est pas épargnée avec cette
date de
1740 alors que sur le pilier droit du porche il
existe une autre date très évocatrice :
1646... |
|

Photo prise de la Tour Magdala en
1905. Les ruines de Coustaussa sont impossibles
à observer puisque situées complètement à gauche sur la
photo derrière le village
|
|
Il faut donc reconnaître
que ces excursionnistes pseudo archéologues, membres
scientifiques de l'Aude, accordaient bien peu d'importance à
un rapport publié dans un bulletin officiel de la région et
comportant autant d'énormités. Tous les bulletins annuels de
cette association scientifique seraient‑ils du même niveau
d'incompétence ?
En fait, il ne s'agit pas
d'incompétence, mais plutôt d'un plan très bien orchestré,
destiné à produire des éléments clés. Toutes ces erreurs
sont volontaires et cette excursion n'a certainement jamais
eu lieu telle qu'on veut nous la présenter. Le but de la
publication était tout simplement d'attirer l'attention sur
quelques détails importants comme l'église Marie‑Madeleine,
les roches tremblantes, et surtout la
stèle de Blanchefort
qui, on le sait aujourd'hui, est une pièce fondatrice de
l'énigme.
Voici donc l'extrait du Bulletin de la Société d'études
scientifiques de l'Aude t.XVII, année 1906... un tiré
à part très particulier...

|
|
Allusion au livre de Boudet ?
Si on s'amuse à lister
tous les détails relevés dans la note, il est évident que
certains sont traités de façon disproportionnée par rapport
à d'autres. La stèle occupe sur ce point une place à part.
Mais le site des
Roulers près du "Pla de la côte" semble tout
aussi important.
Ceci nous ramène bien sûr
à "La Vraie Langue Celtique"
de Boudet
et
à l'une de ses illustrations.
|
|

Les Roulers (appelées aussi "roches
tremblantes") près de Rennes‑Les‑Bains
sont certainement un autre élément de repérage très
important (E. Tisseyre)
|
|
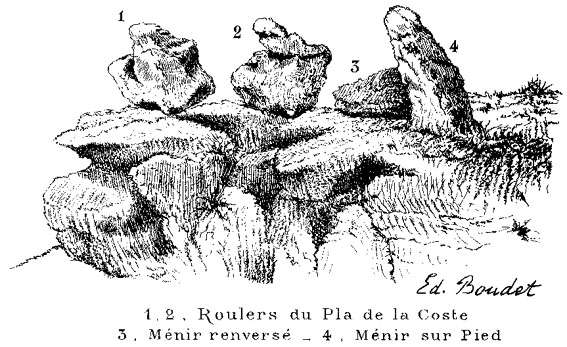
Illustration extraite de "La Vraie Langue
Celtique" par Boudet et son frère |
|
Propos de Franck Daffos (Extrait du forum)
L'original de cette communication
fut encarté (et donc ajouté) à la
va‑vite dans le bulletin de cette vénérable assemblée, au
dernier moment et avant son expédition à ses abonnés. Ceci
fait, le véritable instigateur de ce message :
Frère Jean
(Jean Jourde), quittait la
région à peine quelques jours plus tard pour ne plus y
revenir qu'au départ à la retraite de
Boudet en
1914 et faire nommer son successeur à la cure
de Rennes‑les‑Bains, l'abbé Rescanières, qu'il avait
formé.
Nous étions à l'automne
1906. Il venait d'assurer le règlement de la
toute dernière facture du
Domaine de
Saunière, et avait terminé les parchemins, concluant en
beauté avec cette communication le codage relatif à
certaines dalles qu'il avait prévu de mettre en place depuis
3 ans.
Mais chose curieuse, cet article fit
l'objet d'un tiré à part d'une dizaine de pages qui fut
édité à un grand nombre d'exemplaires, pour ne pas qu’il se
perde (???) et ce chez l'imprimeur
Bonnafous‑Thomas (le même qui imprima
la Vraie Langue Celtique de Boudet
20 ans
auparavant). Chose encore plus étonnante, ce tiré à part
n'émane pas de la S.E.S.A.
Le bulletin de la S.E.S.A.
était alors envoyé à trop peu d’exemplaires, mais permettait
d’amener une caution historique à cette stèle. C’est la
raison pour laquelle ces personnes ont, à leur frais, fait
faire un tiré à part indépendant du bulletin de la S.E.S.A. et ce comme par hasard
chez le même imprimeur qui avait imprimé à compte d’auteur
le livre de Boudet juste 20 ans auparavant. Il ne fallait
pas que cette
communication
se perde, ce qui aurait été le cas si elle n’était
restée que dans le bulletin annuel de 1909 de la SESA.
Personne ne serait jamais allé la chercher.
Gérard de Sède avait un exemplaire de ce tiré à part
qui faisait partie d’un « dossier »
qu’avait récupéré Pierre Plantard dans lequel se
trouvaient (entre autres) les parchemins, des explications
sur la VLC de
Boudet,
sur le
calvaire Vié et le
cimetière avec quelques tombes particulières de
Rennes‑les‑Bains, et des documents du XVIIe
siècle permettant de retrouver la cache de Rennes‑les‑Bains,
ceci grâce à deux tableaux de
Poussin
et
Téniers,
les Bergers d'Arcadie et
Saint Antoine et les 7 péchés capitaux, et un tableau
d'un artiste anonyme "le pape Célestin V".

|
|
|



