|
|
Mgr Paul‑Felix Beuvain
de Beauséjour
Né le 16 décembre 1839
Mort le 4 avril 1930
Évêque de Carcassonne de 1902 à 1930
Connu pour avoir été le
successeur de Mgr Billard, il fut celui qui commença
à s'intéresser de très près aux agissements étranges de
Bérenger Saunière. Les premiers différends entre ces deux
hommes d'Église se terminèrent dans un long procès‑fleuve
qui précipita Bérenger Saunière dans une déprime jusqu'à
la fin de sa vie.
Alors que Mgr Billard s'affiche comme un personnage ambigu,
complexe et plutôt en faveur de Saunière, Mgr de Beauséjour
est tout son contraire. Il représente une hiérarchie droite, brutale, ennemie de
Saunière et ne comprenant
rien à l'affaire des deux Rennes...
|

Mgr de Beauséjour
(1839‑1930)
|
|
Toute l'énigme est
émaillée de dualités qui n'en finissent pas de nous étonner.
Coïncidences ou facéties de l'histoire, l'affaire est
constamment entre le blanc et le noir (l'échiquier), entre
le curé d'en haut (Saunière) et le curé d'en bas (Boudet),
entre Rennes‑Le‑Château et Rennes‑les‑Bains, entre
la
Tour
Magdala en pierre et
la
Tour de l'Orangeraie en verre, entre
Mgr Billard complice obscur de Saunière et
Mgr de Beauséjour
son adversaire. Tout balance entre l'endroit et l'envers,
le pour et le contre, le vrai et le faux. Nous avons ici encore un exemple.
Après une vie luxurieuse et insouciante, voici le revers de la
médaille, une autre vie pleine d'amertume, de solitude et
d'accusations qui enfoncent un peu plus chaque jour Saunière dans la déprime.
Mgr de Beauséjour ne
compris certainement rien à cette affaire mystérieuse et il est
admis aujourd'hui que son implication fut surtout
juridique. Néanmoins, le procès qu'il déclencha est hautement
enrichissant lorsque l'on examine de près les longues
procédures et les nombreux échanges de lettres. Pour les détracteurs de l'affaire, il s'agit
simplement de la mise en lumière d'un immense trafic de messes, source de
la richesse soudaine du prêtre. Pour d'autres, ce n'est que de la poudre
aux yeux, car la vérité est ailleurs...
Derrière l'énigme se cache aussi une
fin de vie dont on parle peu. Saunière vécut en effet une
véritable descente aux enfers et un acharnement juridique
considérable. Jouait‑il un double jeu ? Certainement, mais
il le fit en toute bonne foi, persuadé qu'il agissait dans
une parfaite honnêteté vis à vis de ses donneurs d'ordre. Ce procès montre surtout qu'il
préserva jusqu'au bout un secret qu'il ne pouvait dévoiler à
une autorité juridique. Pourquoi ? Pour protéger qui et quoi ? Voici de vraies questions...
Enfin nous verrons que
cette dualité va jusqu'aux sépultures de
Mgr Billard
et Mgr de Beauséjour, où d'ailleurs une
surprise attendait les chercheurs depuis longtemps.

Je remercie
Christian
Doumergue ("L'affaire de Rennes‑Le‑Château" 2006)
et Franck Daffos ("L'affaire des carnets" 2008)
pour leurs recherches fructueuses
sans lesquelles ce
thème n'aurait pas pu être aussi complet.
|
|
Paul‑Félix Beuvain de Beauséjour
naquit à Vésoul (Haute‑Savoie) le 16 décembre 1839.
Son père Louis‑Ernst (1811‑1859) exerce la profession
d’avocat et sa mère Eugénie, née Fyard de Mercey
(1813‑1907), élève ses quatre enfants. Après des études à
Saint‑Sulpice, le futur évêque de Carcassonne est ordonné
prêtre le 6 janvier 1863 et débute comme professeur à la
« Catho ». C’est ainsi que l’on appelle l’Institution
Saint‑François‑Xavier de Besançon.
Son parcours se poursuit à
Vitrey en Haute‑Saône, où il devient curé entre
1874 et 1876.
Puis c'est comme doyen qu'il
occupe une cure à Luxeuil entre
1876 et 1887.
|

Mgr de Beauséjour |
|
De retour à Besançon,
il prend
ensuite une nouvelle responsabilité ecclésiastique en devenant
archiprêtre de sa cathédrale de
1887 à 1892. Et le
7 mars 1892, il devient vicaire général.
Or, sa
carrière va soudainement prendre un tournant inattendu. En
mai 1902, suite au décès de
Mgr Arsène Billard,
il est nommé évêque de Carcassonne, devenant ainsi le
responsable hiérarchique direct de Saunière. Cette date,
très importante pour notre curé de Rennes‑le‑Château,
va sonner non seulement le glas de sa vie fastueuse, mais
aussi le début d'un long tourment judiciaire.
Car la fortune du curé attire
inévitablement l'attention de ce nouvel évêque de Carcassonne et du nouveau pape
Pie X (1903 à 1914) qui
considère moins favorablement les activités exubérantes du prêtre.
Apprenant la vie de son curé de Rennes‑le‑Château,
Mgr de Beauséjour
reçoit donc la mission de ramener au bercail cette turbulente brebis.
Après une première enquête, il constate que ce qu'on lui avait rapporté est bien en
dessous de la vérité. La réaction est alors immédiate. Des comptes sont demandés au prêtre et
les réponses
vont être plutôt laconiques :
«
J'ai reçu de nombreux dons qui m'ont permis de réaliser
l'embellissement de l'église du village...
Mes donateurs souhaitent rester dans l'anonymat »
Mgr de Beauséjour insiste et demande des comptes précis,
mais l'attitude de
Saunière reste étrange. Il griffonne rapidement des comptes qu'il remet au
prélat et qui de toute évidence semblent truqués. Le plus incroyable est
que Bérenger Saunière ne minimise pas ses dépenses. Bien au contraire, au lieu de
faire croire qu'il n'avait pas d'argent, il met en évidence, au travers de ces
lignes comptables truquées qu'il en possède énormément.
Mgr de Beauséjour lui envoie ordre sur ordre et à chacun d'eux Saunière
répond par un regret ou une excuse de ne pouvoir y obéir. Après avoir vu ses
ordres et ses requêtes éludés pendant environ une année, l'évêque finira par le
prendre de front et lui demandera directement d'où provient sa fabuleuse fortune.
Saunière répondra que des legs lui avaient été faits personnellement et que
c'était à lui seul de décider comment il dépenserait cet argent. Inutile de dire
que l'évêque ne sera ni satisfait ni impressionné par cette réponse et cette
attitude désinvolte.
Il n'en fallait
pas plus pour courroucer un peu plus l'évêque de
Carcassonne et ce successorat n'est décidément pas
dans l'intérêt de
Bérenger Saunière. Devant l'attitude insolente du prêtre, il attente un
procès pour trafic de messes, mais qui n'est qu'un
prétexte pour y voir plus claire dans cette affaire bien
brumeuse.
Mgr de Beauséjour confira même en particulier :
"... cette accusation de trafic de messes est
illusoire
et elle n'a aucun intérêt..."
La remarque est très claire. Mgr de Beauséjour suspecte autre chose. Ce trafic de messes n'est certainement
qu'une illusion, qu'un rideau de fumée pour cacher un autre
trafic. Quoi qu'il en soit,
Bérenger Saunière ne cède pas et tient tête à sa hiérarchie
jusqu'au bout.
L'évêque, las de ces longues années de procès, demande
pourtant une dernière
fois à Bérenger Saunière des explications. Et une nouvelle
fois, Bérenger Saunière refuse.
Devant cette réaction, les
autorités de l'Église prennent la décision de suspendre
Bérenger Saunière de ses fonctions sacerdotales. Saunière se
retrouve seul face à une hiérarchie implacable. Cette
suspension modifiera
son attitude et le fera entrer dans une profonde
déprime qui lui sera fatale. |
 |

Mgr de Beauséjour
veut comprendre l'énigme
Saunière
|
|
La vie de Bérenger
Saunière pourrait se résumer en trois étapes distinctes :
une première période pleine de découvertes et de mystères, une
seconde luxueuse, mondaine et insouciante, enfin une
troisième période sombre, dépressive, nettement moins faste, et surtout assortie d'un procès qui dura plus de
10 ans.
Tout commence
quatre ans après la nomination
de
Mgr de Beauséjour,
le 19 novembre 1906,
une date à laquelle il
visite Rennes‑le‑Château. À cette époque, le Domaine est terminé, flambant neuf.
Les jardins sont luxuriants et l'eau coule dans les fontaines.
La Villa Béthanie s'impose entre une
église Marie‑Madeleine neuve et
flamboyante, et le château de Hautpoul en ruine. Le
Domaine est une véritable oasis au milieu d'un
Haut‑Razès aride et où une tour néogothique étrange
nommée Magdala surplombe la vallée. |
|

Le Domaine de Saunière en 1904 |
|
Et
l'histoire montre que sa réaction est complètement à l'opposé
de celle de Mgr Billard lorsqu'il vint visiter l'église
fraîchement terminée le 6 juin
1897. La vision de ces jardins
idylliques et de ces constructions énigmatiques laisse l'évêque
de Carcassonne dans une consternation totale. Vient s'ajouter à
ceci un mécontentement de la population
de Rennes‑le‑Château qui n'a pas oublié la vie insolite de leur
curé. Rappelons‑nous ; Saunière commença sa cure par un sermon franchement anti
républicain, puis ce fut les coups de pioche la nuit dans le
petit cimetière, puis un incendie dans le village que
Saunière refusa d'éteindre en interdisant l'accès à son réservoir
d'eau sous le reposoir. Tous ces faits dérangeants appartenant
à un prêtre bâtisseur de
l'étrange firent naître chez les villageois une
certaine incompréhension. Enfin, il y a toutes ces
demandes de messes adressées par
différents diocèses de France...
Que peut bien conclure
Mgr de Beauséjour ? Par quel truchement
Saunière est‑il parvenu à monter tout un réseau de trafic de messes ?
Pourquoi et pour quelle finalité ? Et surtout, pourquoi son
prédécesseur, Mgr Billard, ferma‑t‑il les yeux ?
Les questions se
bousculent et hantent le prélat dès
1906. Il faut prendre une
décision, agir pour le bien de l'Église, pour la paix du village et des paroissiens.
|
|
15 janvier 1909 ‑ Saunière est nommé à Coustouge
L'année
1909 représentera
pour l'abbé une réelle rupture. C'est la charnière entre un passé
heureux, insouciant et une nouvelle période austère et pénible. C'est ainsi que le
15
janvier 1909, une nouvelle
affectation tombe dans les mains du curé de Rennes :
Coustouge près de Dourdan. La lettre
est signée par son responsable ecclésiastique et l'ordre laisse
une semaine à Saunière pour se préparer avant son exécution.
Il est clair que Mgr de Beauséjour cherche par tous les moyens à
détacher Saunière de son environnement. La réponse à son évêque
sera cinglante :
|
« Monseigneur, j'ai lu votre lettre avec le plus extrême respect et j'ai pris
connaissance des intentions dont vous voulez bien me faire part.
Mais, si notre religion nous commande de considérer avant tout nos intérêts
spirituels, et si ceux‑ci sont assurément là‑haut, elle ne nous ordonne pas de négliger nos intérêts
matériels qui sont ici bas.
Et les miens sont à Rennes et non ailleurs.
Je vous
le déclare, Monseigneur avec toute la fermeté d'un fils respectueux, non
Monseigneur je ne
m'en irais jamais »
|
Mgr de Beauséjour qui
connaît mal cet homme plein de tempérament ne fait qu'enfoncer une
porte ouverte. Et Saunière, persuadé d'être incompris, va immédiatement
entrer dans une farouche résistance et entamer une lutte judiciaire qui durera une décennie... |
|

La lettre de nomination pour
Coustouge
|
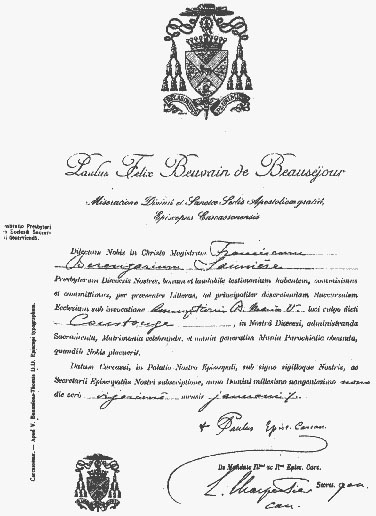
Le titre de nomination à Coustouge
|
|
Saunière confiera d'ailleurs dans son
journal :
« Les mesures exceptionnellement
rigoureuses,
qui sans aucun avertissement m’ont frappées au début
de l’année,
m’ont tellement troublées. Bouleversé, effrayé…
» |
Coïncidence ou non, il se
trouve qu'un autre curé décéda étrangement quelques jours
avant cette mutation. Le plus connu
reste bien sûr
Antoine Gélis
du fait de la brutalité de son assassinat. Or, il
existe un autre prêtre dont on ne parle jamais et qui décéda le
9 janvier 1909 :
l'abbé Gaudissard. Il fut curé
d'Antugnac
à partir du
1er
janvier 1897 et le successeur de Saunière avant que ce dernier ne soit
muté à Rennes‑le‑Château. L'abbé Gaudissard disparut jeune à
l'âge de 49 ans et on sait très peu de choses sur les circonstances exactes
de son décès. On peut en tout cas s'étonner non
seulement de cette coïncidence, mais aussi du délai d'une
semaine laissé à Saunière pour déménager et quitter
définitivement sa colline. Pourquoi tant de hâte ?
|
|
Le maire s'en mêle...
Alors qu'à son arrivée à Rennes‑le‑Château, Bérenger Saunière était en opposition
radicale avec la mairie, les opinions évoluent. Le jeune curé n'est plus vu
comme un fervent politique royaliste et opportuniste, mais comme un prêtre
enfant du pays, victime d'acharnement. Saunière recevra d'ailleurs plusieurs
lettres de soutien et d'incompréhension de ses amis prêtres.
Devant
cet acharnement ecclésiastique, la conséquence est
rapide. Le
maire de Rennes‑le‑Château, M. Rougé qui ne l'entend pas de
cette oreille, prend sa plume et n'hésite pas à écrire à l'évêché pour faire part du
mécontentement des habitants du village à propos de cette nomination. Voici la lettre
qu'il
écrivit le 6 février
tout aussi savoureuse que virulente :
|
|
Le Maire de Rennes‑le‑Château à Monsieur l'Évêque à
Carcassonne.
Monsieur,
En réponse à votre lettre du 31 janvier dernier, j'ai
l'honneur de vous faire savoir que je regrette le
maintien de la décision prise à l'égard de M. l'abbé
Saunière. En ne donnant pas à la démarche que le Conseil
municipal de Rennes‑le‑Château a faite auprès de vous,
les suites que nous vous demandions vous et votre
Conseil avez été mal inspirés. Nous n'obtenons pas
satisfaction ; tant pis ! Tant pis aussi que vous ayez
retiré à M. Saunière ses pouvoirs. Quant à l'attitude de
la population vis à vis de M. le curé d'Espéraza et du
successeur de M. Saunière, elle sera tout à fait simple : l'Église désertée et les cérémonies religieuses
remplacées par les cérémonies civiles. Vous voyez,
Monsieur l'Évêque, que vous n'aurez pas à vous armer
contre nous des foudres de l'Eglise. Quant au
presbytère, il est loué pour une durée de cinq ans, à
partir du 1er janvier 1907 à l'abbé Saunière. Mais je
dois vous faire connaître qu'après l'expiration du bail
et même actuellement, s'il devenait libre par suite du
départ du locataire actuel, le Conseil municipal se
refuse formellement à passer un nouveau bail avec
le desservant que vous nous enverrez.
Je vous prie, Monsieur l'Evêque, d'agréer l'assurance de
ma considération très distinguée.
Rennes‑le‑Château, le 6 février 1909
Le Maire |
|
Une anecdote amusante raconte que
le maire n'hésita pas à signer un bail de location du presbytère
à Bérenger Saunière de 5 ans, et ce à
partir du 1er janvier 1907, empêchant ainsi tout logement à un futur
prêtre.
C'est ainsi que le
9 février 1909,
le successeur de Saunière,
l'abbé Henri Marty,
Aumônier des Orphelins à Espéraza, devra se loger à Carderonne et
donc sera contraint de monter à
pied à Rennes les jours de messe.
Ce n'est que le 4 juillet 1909 que l'abbé Marty s'installera à
Rennes‑le‑Château. Les deux hommes d'Église ne s'entendront
guère, Marty apparaissant sans doute à Saunière comme un concurrent à la solde de la
hiérarchie. |
|
28 janvier 1909 ‑ Saunière donne sa
démission
Saunière visitera tout de même
Coustouge, sans doute pour démontrer sa bonne foi,
mais son plan est
ailleurs. Après avoir consulté quelques prêtres des paroisses environnantes
qui le soutiennent comme l'abbé Rouanet de Bages‑les‑Flots, Saunière
envoie sa démission le 28 janvier 1909,
soit 14 jours après la
missive.
Ce choix dut être difficile, car il
n'avait que deux options : accepter la mutation ou démissionner en considérant
qu'il pourrait être financièrement indépendant jusqu'à la fin de ses jours.
La démission s'imposera à lui, son projet étant très simple : rester à
Rennes‑le‑Château à tout prix. Considérait‑il que sa vie
était là ? Certainement. Voulait‑il continuer cette existence insolite ?
Sans aucun doute. Avait‑il des revenus suffisants ? Il faut croire que oui. Il répondra en ces termes :
|
Monseigneur,
En présence de la décision maintenue de Votre
Grandeur au sujet de mon départ de Rennes, il me
reste un parti à prendre suggéré d'ailleurs par
Votre Grandeur elle‑même alors que vous avez dit
aux représentants de la commune en parlant de
moi : "Qu'il prenne sa retraite". C'est pourquoi
vous voudrez bien agréer ma démission et ne plus
me compter à partir du 1er février au nombre des
prêtres de votre diocèse qui exercent le saint
ministère..." |
|
|
Des prêtres réagissent de façon étrange
Si nous savons que
l'abbé Rouanet
encouragea Saunière à entrer en résistance, c'est qu'une lettre datée du
22 janvier 1909 fut retrouvée indiquant à
son ami Bérenger qu'il avait
craint pour lui dans le passé et qu'à présent il ne comprenait pas ce nouvel
acharnement. À quelle affaire
l'abbé Rouanet faisait‑il allusion ? Son
conseil est en tout cas sans équivoque : démissionner, car l'évêché ne céderait
pas...
Serait‑ce tout ? Non, car d'autres
courriers possèdent ce même ton étrange comme celui du
23 janvier de
l'abbé Gazel,
curé de Floure, et qui écrivit en parlant de l'évêque :
" Le temps passé lui reviendrait‑il à
la mémoire ? "
Un peu plus tard, le 1er
février, ce même prêtre écrivait à Saunière :
" Si les prêtres qui reçoivent un
secours de la Caisse sont un peu forcés d'accepter ses volontés [de
l'évêque], il n'en est pas de même pour toi.
Tu as tes coudées franches... "
Ces courriers laissent entrevoir derrière Saunière des manipulations et des connivences
restées longtemps secrètes et qui étaient en train de remonter à la surface grâce à
Mgr de
Beauséjour.
|
|
D'autres
accusations...
En
décembre 1909,
Saunière reçoit à nouveau une lettre l'accusant de recevoir des
commandes de messe alors que cela lui est scrupuleusement
interdit. Or, en 1910, l'existence d'autres factures
prouve que l'abbé continuait tranquillement son rythme de
vie. Des commandes d'alcool, de Porto et de digestifs continuent à
arriver. On note également l'achat d'un service de faïence et
même d'un buste à son effigie chez le statuaire Monna. Saunière
dispose visiblement encore de quelques revers de fortune.
Voici deux courriers très
significatifs que reçut Saunière en
décembre 1909
et provenant du Vicaire général :
Évêché de Carcassonne, le 18 Décembre 1909
Monsieur l'abbé Saunière,
La supérieure de l'Hôpital St
Joseph, rue Pierre‑Larousse n. 7 à Paris, a écrit à
Monseigneur, pour lui demander, si elle pouvait vous
envoyer des honoraires de Messe, en toute sûreté de
conscience. Vous devinez la réponse qui lui a été
faite :
"Gardez‑vous bien de continuer à faire de pareils envois ; parce
que nous n'avons aucune confiance de la manière dont ce Prêtre
acquitte les intentions de Messes, qu'il se procure partout où
il peut."
Monseigneur constate avec peine, que vous continuez à demander
des honoraires de Messes en dehors du Diocèse. Et cependant vous
aviez promis et protesté que désormais vous n'en demanderiez
jamais plus qu'à lui seul, personnellement.Voilà comment vous tenez votre promesse. Sa Grandeur se demande, si sa conscience ne lui fait pas un
devoir de prendre des mesures efficaces pour faire cesser, une
manière d'agir si déplorable.
Je vous offre mes sincères salutations.
H. Rodière
|
Et quelques jours plus tard, un second
courrier :
Évêché de Carcassonne
Carcassonne, le 22 Décembre 1909
Monsieur l'abbé Saunière,
Vous affirmez, que depuis la promesse que vous avez faite à Mgr
vous n'avez plus demandé des honoraires de Messes à la
Supérieure de l'Hôpital St Joseph, à Paris. Or voici ce qu'elle
nous écrit, à la date de 28 octobre dernier... "Pendant qu'il
était encore à Rennes‑le‑Château, comme Curé, Mr l'abbé Saunière
s'était adressé à moi, sans me connaître (il avait eu mon
adresse par quelqu'un), pour me demander si je pourrais lui
procurer quelques honoraires de Messes... Il m'a écrit
dernièrement qu'il était maintenant Prêtre en retraite, restant
dans son ancienne Paroisse, et qu'il pourrait toujours acquitter
les Messes, qu'on lui enverrait. Comme je n'ai pas l'avantage de
le connaître, je vous serai reconnaissante de me dire, si on
peut en conscience, lui envoyer des honoraires de Messes. "
Voilà, deux affirmations, évidemment contradictoires.
Monseigneur vous sera reconnaissant, si vous voulez bien lui
dire, qu'elle est celle, qui est conforme à la vérité.
Recevez Monsieur l'abbé Saunière, mes sincères salutations.
H. Rodiére
|
C'est à partir
de mai 1910 qu'une longue et pénible affaire va commencer puis déstabiliser
Saunière. Le procès durera près de huit ans et il ne sera clos que le jour de
sa mort, du moins pour l'autorité diocésaine... |
27 mai 1910 ‑
Citation à comparaître
Mgr de Beauséjour change alors de
stratégie et accuse Saunière de se faire payer pour dire les messes. L'accusation
ne tient pas et est peu crédible. Un rapide calcul montre qu'il aurait dû dire une messe pour chaque habitant du village
24h sur 24h et 365 jours par an pendant mille ans pour obtenir une somme qui n'aurait
représenté qu'une infime partie de sa fortune. Ces accusations montrent
cependant jusqu'où l'Église était prête à aller.
En fait, il faut comprendre que sa hiérarchie directe
était dans l'incapacité de comprendre comment, sans
trafic et avec uniquement 75 francs‑or par mois, Saunière
peut‑il poursuivre sa vie insouciante.
L'affaire ne pouvait en
rester là et le 27
mai 1910,
Mgr de Beauséjour
saisit le tribunal de l'Officialité pour traduire Bérenger
Saunière et lui interdire les demandes d'intentions de messes hors du diocèse. Le vicaire général,
G. Cantegril et le commis à la Cour, M. Charpentier, vont ainsi amener Saunière à
comparaître devant le tribunal ecclésiastique. Il doit faire
connaître son avocat avant le 12 juillet 1910, car sa
convocation est le samedi 16 juillet
au matin. L'officialité du diocèse de
Carcassonne adresse à Saunière une citation à
comparaître : |
|
Je soussigné S.
Pennavaire,
promoteur de l'officialité du diocèse de Carcassonne :
Considérant que Monsieur l'Evêque avait à plusieurs
reprises ordonné à Monsieur l'abbé Saunière de ne plus
avoir à demander des intentions de messes à qui que ce
soit en dehors du diocèse ;
Considérant que Monsieur Saunière avait bien promis de s'en tenir
scrupuleusement aux ordres de sa Grandeur ;
Considérant qu'en fait M. Saunière a continué malgré tout à agir à
l'encontre des ordres reçus et des promesses faites à
l'honneur de prier Monsieur l'Official de vouloir bien
traduire Monsieur Saunière devant le tribunal de
l'officialité.
Signé Pennavayre, promoteur
|

Mgr de Beauséjour veut un
procès |
 |
|
16 juillet 1910 ‑ Procès pour trafic de
messes
En réalité, l'accusation porte sur trois points :
1) Trafic de messes
2) Refus de fournir des détails et des justificatifs de ses
comptes à sa hiérarchie
3) Poursuite des
demandes de messes malgré l’interdiction de l’évêché.
Malgré les conseils de
son ami Rouanet, il refusera de s'y rendre, prétextant des ennuis de santé.
Et encore une fois, il anticipera puisque le
15 juillet,
il envoie ce courrier : |
Rennes‑le‑Château, le 15 juillet 1910
Monseigneur
Comme j'ai eu l'honneur de le dire à Votre Grandeur
dernièrement, ainsi qu'à Monsieur le Vicaire général, pour les
motifs que je vous ai exposés, je ne viendrai point demain
samedi, 16 courant, devant le tribunal de l'Official, non pas
que je ne le veuille point, mais parce que je ne le puis. Pour
paraître devant mes juges avec quelque chance de succès, comme
m'y invite la citation du 7 juillet, il me faudrait d'abord être
autorisé à faire connaître les noms des personnes qui m'ont
donné les fonds nécessaires à mes divers travaux, or cette
autorisation je ne l'ai point.
Il me faudrait ensuite le courage et l'énergie
nécessaire, la présence d'esprit, le sang froid et
surtout la facilité de m'exprimer et je ne possède
absolument rien de tout cela. ‑ Je sais bien ce que
vous allez me dire :
pourquoi ne pas prendre un avocat pour me représenter ? Oui tout
cela est fort bien, mais qui choisir ne connaissant, parmi le
clergé aucun membre apte à ma défense ? Et puis cet avocat en
supposant que j'eusse réussi à en trouver un susceptible d'être
agréé par le tribunal, vous aurait‑il appris autre chose que ce
que vous savez déjà ? Non. Enfin, comme je vous l'ai encore dit,
les fortes émotions, avec mon naturel impressionnable, étant
excessivement contraires et nuisibles à mon état de santé,
d'après les conseils et les ordres de mon médecin, je dois à
tout prix les éviter, si je ne veux pas m'exposer aux pires
catastrophes. Et maintenant quant à la question des honoraires
de messes, laissez‑moi vous redire, Monseigneur, que depuis
votre défense, je n'en ai plus demandé, bien que certaines
pièces de mon dossier semblent prouver le contraire et que ma
conscience n'est pas aussi coupable que ce que vous paraissez
croire. Avant de clore ces quelques lignes que j'ai cru bon de
vous adresser, je demande à Dieu de pardonner à mes ennemis et à
tous ceux qui ont cherché à me nuire et à me faire du mal, et je
le prie, en même temps de m'accorder la force nécessaire pour
faire sa sainte volonté et accepter en esprit de pénitence, ma
condamnation quelle qu'elle soit.
Daignez agréer, etc ..
B. Saunière
P‑S‑ La maison que j'ai construite avec toutes ses dépendances,
comme semble l'insinuer un passage de la citation, n'a pas été
édifiée pour m'enrichir et pour y couler mes jours dans le luxe
et la mollesse, ma pensée, Monseigneur, comme il y a quelques
années j'ai eu l'honneur de vous le communiquer, était de vous
l'offrir pour une maison de retraite en faveur des prêtres âgés
et infirmes ‑ habitation confortable ‑ chapelle, bibliothèque,
promenade, jardin, terrasses, bon air, splendide panorama, rien
n'aurait manqué aux pauvres vieux, pas même une place réservée
dans le cimetière de la paroisse. Je persiste toujours dans mon idée première, bien que le ciel
semble aujourd'hui se mettre en travers de mes projets et ne pas
vouloir les agréer. |
|
L'administration judiciaire reste en marche et une nouvelle date
est proposée au prêtre : le 23 juillet au matin.
Or, toujours conseillé par
son entourage, et voyant que l'autorité judiciaire ne faiblit
pas, Saunière va anticiper le déroulement.
Le
20 juillet, il écrit
à son évêque que l'abbé Molinier, doyen d'Azille, sera son avocat ainsi que
Maître Mis, avocat à Limoux. Il demande également 8 jours
supplémentaires
afin de préparer sa défense. N'ayant pas de réponse de
l'évêché, il
renvoie une lettre le 22 juillet.
Saunière ne se rendra pas
non plus à la seconde convocation, et le
23 juillet
une
première condamnation tombe. Il la reçoit le
29 juillet
avec l'annonce d'une "Suspense a
divinis" pour une durée d'un mois. Saunière est
désemparé, car un premier jugement est tombé sans qu'il est pu se
faire représenter par son avocat. |
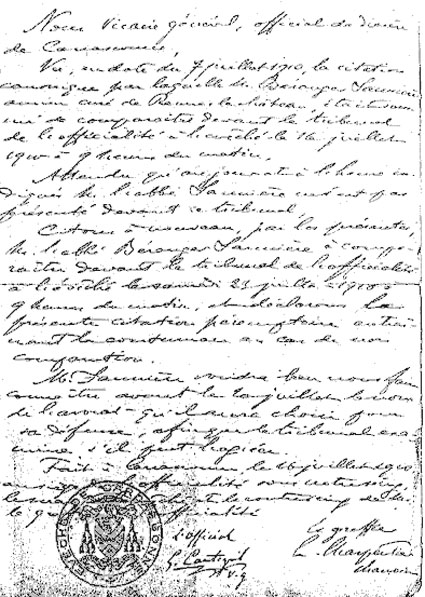
Nouvelle convocation de Saunière
le 23 juillet 1910 |
Jugement contre Bérenger Saunière défaillant.
Nous Official du Diocèse de Carcassonne, au nom de la Sainte
Trinité et n'ayant en vue que la gloire de Dieu et le bien de
l'Église.
Attendu que M. l'abbé Bérenger Saunière cité péremptoirement à
comparaître à ce jour devant notre tribunal a fait défaut et a
été déclaré contumace ;
Ouï l'acte d'accusation de M. le promoteur reprochant à M.
l'abbé Saunière le trafic des messes, la désobéissance à son
évêque et des dépenses exagérées et non justifiées auxquelles
semblent avoir été consacrés les honoraires des messes non
acquittées.
Après avoir pris l'avis de messieurs les assesseurs, jugeant par
défaut,
Condamnons M. l'abbé Bérenger Saunière à une suspense a divinis
pour le diocèse de Carcassonne d'une durée d'un mois.
De la sentence qui va vous être faite, je mets un délai de 15
jours pour la rendre exécutoire.
Votre tout dévoué en N.S
G.Cantagril v.g
|
|
Saunière demande alors le "Restitutio
in integrum"
(annulation du jugement) qu'il obtient, et il est de nouveau
cité à comparaître le 23 août 1910. |
|
Changement d'avocat
Devant
l'acharnement de sa hiérarchie et de son évêque
Mgr de Beauséjour,
Saunière s'enfonce dans la déprime. Il est clair qu'il ne peut
plus compter sur ses revenus et envisage même la vente de son
Domaine. Mais l'homme est un battant, et il fait remplacer
Maître Mis
par un avocat ecclésiastique, ce qui est en soi une idée de
génie : l'abbé Huguet.
Recommandé et conseillé
par son ami l'abbé Grassaud, le recrutement d'un avocat
spécialisé dans les affaires de l'église va rendre la tâche de
l'évêché plus difficile.
Surtout,
l'abbé Huguet est une personnalité très forte
et très combative. Il écrit dans
plusieurs journaux catholiques et son ton est souvent acéré et
contestataire. |

L'abbé Huguet, avocat
(photo P. Jarnac © Pégase) |
|
Son parcourt
est aussi exceptionnel : Docteur en théologie et droit canonique, postulateur de la cause de Pellevoisin devant le Saint‑Office,
chanoine, curé d'Espiens par Nérac dans
le Lot‑et‑Garonne, ancien professeur de l'université de Paris. Il est
aussi l'auteur de
deux thèses et participe à des congrès très réputés. Spécialisé
dans le culte marial, il dirige la formation des prêtres et ses
relations montent très haut dans la hiérarchie catholique. Il
voyage également beaucoup, surtout à Rome. Il pratique la
médecine parallèle et conseillera Saunière à de nombreuses
occasions. Enfin, et c'est peut‑être le point le plus important,
il fit ses études au séminaire de Saint‑Sulpice. Tiens ?
Un saint‑sulpicien, une coïncidence de plus...
A‑t‑il connu Jean Jourde ?
Saunière et Huguet vont alors nouer une certaine complicité. Il
est vrai que l'abbé Huguet profite des bons repas du prêtre et
de ses alcools...
Saunière est maintenant assisté d'un avocat
confirmé
et ce dernier va utiliser la lenteur administrative pour prendre
connaissance du dossier déjà bien chargé et surtout plutôt
mystérieux. Mgr de Beauséjour
accepte finalement que le procès soit repris
et convoque Saunière le 23 août. Or, ce sont les vacances et le procès est reporté au
15 octobre 1910.
Le
5 octobre 1910, l'abbé Huguet demande
à Saunière de lui fournir tous les renseignements qui pourraient
aider à rédiger un mémoire : |
|
" Afin de bien établir la situation, je désirerais
savoir le nombre de messes que vous avez confié à des
confrères, peu importent les reçus, donnez‑moi seulement
les noms et les chiffres approximatifs... " |
|
Saunière va
alors fournir des explications à son avocat, mais elles seront
largement insuffisantes. Selon sa version, depuis
1885, il
se serait associé à d'autres curés de campagne pour demander de
l'aide à des communautés religieuses. Ces dernières auraient
répondu en grand nombre. Pour lui, il n'aurait s'agit que
d'une aide ne mettant en aucune façon ces agissements dans
l'illégalité et œuvrant pour le bien de l'Église. Mais
malgré les interdictions de l'évêché, il continuera. Surtout,
il va affirmer que cet argent récolté n'a pas servi à la
construction du Domaine. Car Saunière base sa défense sur trois
sources de revenus : son salaire de prêtre, ses économies, et des
dons forts généreux...
Néanmoins, personne n'est dupe, et sûrement pas
son avocat. Comment imaginer construire tout un Domaine avec des
économies et quelques dons, même bien pesés. Alors ? Que croire ?
Qui croire ?
Depuis le
début de ce procès, Saunière nage en plein paradoxe et les
contradictions s'accumulent. Il avoue avoir participé à un
trafic de messes, mais la somme reçue est dérisoire. Il avoue recevoir
des dons, mais qui ne participèrent pas à la construction du
Domaine. Il donne même un montant pour ces dons,
71 600 francs‑or, mais il doublera ce nombre plus tard. Pourtant, l'homme est
rigoureux et méthodique. Il a noté toutes ses dépenses dans des
carnets que l'on retrouvera bien plus tard. Il
affirme à son avocat ne posséder aucune trace comptable, aucune
facture des travaux, aucune trace des demandes de messes. Or, nous
savons aujourd'hui que tout ceci est faux puisque nous
connaissons ses carnets et ses cahiers de messes qu'il tenait
scrupuleusement à jour.
Un trafic de messes existait réellement
et il était de grande ampleur. Mais alors, pourquoi autant de prêtres et des communautés
religieuses choisir d'envoyer des mandats à un unique petit curé
de campagne ? |
|
15 octobre 1910 ‑ Un second procès
Un nouveau procès a finalement lieu en
octobre 1910
et les accusations sont les suivantes : trafic de messes, dépenses
exagérées et non justifiées, désobéissance formelle à Mgr
de Beauséjour. Saunière n'est toujours pas présent et c'est
Huguet qui le représente.
Le jugement est rendu le 5 novembre 1910
et une réponse est donnée pour chaque accusation :
1.
Pour la désobéissance, Saunière est condamné à se rendre dans
une maison de retraite sacerdotale ou dans un monastère de son
choix pour y faire les exercices spirituels d'une durée de dix
jours et dans un délai de maximum 2 mois.
2.
Pour le trafic de messes, le tribunal n'a pas été
"suffisamment et juridiquement convaincu qu'il y ait eu trafic des
honoraires de messes".
3.
Pour les dépenses excessives, Saunière est condamné à
communiquer ses comptes précis à son évêque dans un délai
maximum d'un
mois.
Le 17 novembre 1910, le
curé de Couiza notifie à Saunière la sentence, et ce dernier
dispose de 10 jours pour faire appel, ce qu'il fait le
30 novembre, mais trop tard. La sentence est malgré
tout légère et l'accusation la plus grave retenue, puisque
prouvée par Mgr de Beauséjour, est la désobéissance.
Saunière doit donc communiquer ses
comptes sous peine d'y être contraint par une autre décision de
justice.
|
|
Le
30 décembre 1910, l'évêché menace le prêtre de
censure et en janvier 1911, Huguet décide de porter
l'affaire à Rome devant la Sacrée Congrégation du Concile. Sa stratégie de défense est de montrer au
Pape
le calvaire que subit Saunière depuis le début du procès et
l'acharnement de son évêque. Il
plaide début février 1911, mais
malheureusement rien n'y fait et la hiérarchie reste sourde et intransigeante, réclamant
des comptes précis pour mieux étayer son accusation.
Le
9
mars 1911,
G. Cantegril de la Cour de Carcassonne, reçoit
de
Saunière un certificat médical du docteur Roché, déclarant que la
santé de l’abbé ne lui permettrait pas d’entreprendre la retraite à laquelle il
a est condamné pour les charges 1. et 3.
|
Finalement, Saunière cède, et le 13 mars 1911, il envoie au Vicaire Général
Jean Saglio
qui dirige maintenant la commission d'enquête, un dossier de 61 pages contenant plusieurs dizaines de
justificatifs et propose de faire sa retraite dans le grand
séminaire de Carcassonne comme lui conseille son avocat.
Parallèlement à ce geste, il déclare également qu'il ne
pourra fournir les reçus et les certificats
d'enregistrement d’hypothèques de ses propriétés,
prétextant qu’il les a égarés, fait incroyable pour un
homme aussi méticuleux que Saunière...
L'analyse par la commission d'enquête de ces papiers permit de
justifier environ
36 000 francs‑or ce qui est dérisoire. Encore une fois,
Saunière tire un rideau de fumée. Surtout, des
contradictions existent avec les pièces fournies à l'époque par
Maître
Mis. Et que dire des
200 000 francs‑or que l'abbé
reconnut avoir dépensé ? Où est passé la différence ?
Quelle est son origine exacte ? |

Jean Saglio
Vicaire général |
Une peu de calcul et du bon sens :
Supposons que Saunière pratiquait le trafic de messes entre
1890 et 1902 soit 12 ans et que l'on admette qu'il
promettait 3 messes par jour (ce qui est déjà excessif), nous
avons :
12 ans x 365 jours x 3 messes =
13140 messes
sur 12 ans
Si une messe représente 1,50
francs‑or le gain est alors de :
13140 x 1,5 =
19 710 francs‑or
Le principe de trafic de
messe est donc un faux problème, car comment expliquer l'écart
avec les 200 000 francs‑or que Saunière déclara avoir dépensé ?
D'autant que l'estimation actuelle des dépenses s'approche
plutôt de 600 000 francs‑or entre 1887 et 1917, date de sa
disparition... |
|
En clair, le
tribunal veut non seulement comprendre où a été dépensé la somme de
200 000 francs‑or, mais surtout qu'elle est sont origine ? Or Saunière pour sa
défense ne peut prouver sa version, car d'après lui, il aurait jeté les
justificatifs de plus de deux ans (aujourd'hui, ce cas aurait été réglé par
une commission rogatoire ordonnant une perquisition).
Malgré
cela Saunière
essayera de justifier l'origine en dressant une liste à la Prévert : fonds
de caisse soumise à la générosité des visiteurs de Rennes‑le‑Château et ses
visites guidées, la vente de meubles, une loterie en 1887, la générosité de
son frère, la vente de cartes postales, la vente de timbre‑poste...
Rappelons que : 200 000
francs‑or = 2,79
(1) x 200 000 = 558 000 €
(1) Un franc‑or vaut selon
l'indice INSEE 2,79 € en 2005. La valeur du franc‑or
ramené en euro est un sujet à polémique, car cette valeur dépend du type de
conversion effectué. En effet, tout dépend si l'on raisonne en poids d'or
équivalent, ce qui place le Franc‑or à environ 5 € (en 2008), ou si l'on
tient compte du coût de la vie et du pouvoir d'achat ce qui donne pour un
Franc‑or en 1900 environ 18 € en 2008... |
|
Le
4 avril 1911,
un autre responsable juridique attaque Saunière : Le chanoine
Charpentier qui exige une nouvelle fois des éclaircissements et des
faits précis. La comptabilité présentée par Saunière présente de
sérieuses lacunes et l'autorité judiciaire s'impatiente.
Comme l'exige sa
condamnation, Saunière est obligé de quitter Rennes‑le‑Château pour
quelque temps. Or, ce n'est pas au séminaire de Carcassonne
qu'il décide de méditer, mais au
monastère de Prouilhe, un lieu qui était cher à
Mgr Billard.
Saunière y séjournera quelques jours du
25 avril au 3 mai
et cette parenthèse permet au prêtre de prendre du
recul. Toutefois ce répit est de courte
durée. |

Mgr de Beauséjour |
|
Aussitôt rentré, il reçoit un
nouveau courrier du chanoine Saglio qui exige vouloir comprendre la différence des
montants qui n'est toujours pas justifiée.
La réponse que
prépare Saunière est alors collégiale puisque non seulement son
avocat y participe, mais également d'autres prêtres, comme
l'abbé Grassaud de Saint Paul de Fenouillé à qui il donna il
y a quelques années l'une de ses
découvertes : un calice en
vermeil.
La lettre
comportant de nouveaux justificatifs est envoyée le
14 juillet 1911 : |

L'abbé Eugène Grassaud,
l'ami de Saunière |
Achat de trois
terrains.........................................1.550
F
Restauration de l'église.....................................16.293
F
Construction du calvaire
..................................11.200 F
Construction de la Villa
Béthanie......................90.000 F
Construction de
la Tour Magdala......................40.000
F
Les jardins........................................................19.050
F
Aménagements intérieurs...................................5.000 F
Ameublement....................................................10.000 F
Total...............................................................193.093 Francs‑or
Soit
538 729,47 € si l'on
considère que 1 franc‑or = 2,79 €
|
|
Suite à ceci, la commission d'enquête rend son rapport à la fin
de l'été à Mgr de
Beauséjour et le résultat ne plaide pas
en faveur de Saunière. La
comptabilité est pleine d'incohérence et d'invraisemblance. Le
tribunal prévoit alors une nouvelle convocation le
30 octobre 1911, mais sur le
conseil de Huguet,
Saunière ne s'y présentera toujours pas.
Le
5 décembre
1911,
le
prêtre est à nouveau convoqué, et à nouveau, personne ne se
présente. Le
tribunal déclare alors Saunière indiscipliné et il est jugé comme tel.
La Cour confirme que 36 000 francs‑or sur 200 000 francs‑or ont été dépensés pour l'église
et le calvaire. Le reste aurait été dépensé pour des constructions
sans but utile et sur des terres qui ne lui appartenaient pas. En effet, une
partie de l'argent a été dépensée pour la
Villa
Béthanie construite sur une terre appartenant à
Marie Dénarnaud. Par
conséquent, Saunière pas plus que l'évêché est propriétaire, or
cet argent, d'après le tribunal, proviendrait du trafic de messes
et donc de la communauté religieuse. On comprend que le dossier
est juridiquement inextricable.
Saunière est
finalement déclaré coupable de gaspillage et d'abus de fonds à son bénéfice
personnel. Une nouvelle sanction tombe. il est
condamné pour dilapidation et détournement de fonds à une "Suspense a divinis" pour 3 mois qui
sera définitive s'il ne restitue pas tous les fonds détournés.
Notons que la peine est finalement légère comparée à la fraude
dont Saunière est accusé.
Cette nouvelle décision renforce l'idée pour
Huguet que la solution
se trouve à Rome. Son objectif reste toujours de démontrer à quel point les
procédés de Mgr de Beauséjour sont indignes et déplacés.
Or,
curieusement en février 1912,
le travail de Huguet semble porter ses fruits puisqu'un premier
rapport de Rome désapprouve les méthodes de l'évêque et ce
dernier est alors obligé de venir s'expliquer. Le vent
serait‑il en train de tourner ? |

Carte postale envoyée depuis
Rome par Huguet à Saunière |

Carte postale envoyée depuis
Rome par Huguet à Saunière |
|
1913 ‑ Bientôt la fin...
Comme pour
conjurer le sort, ou par nostalgie d'un passé heureux,
Saunière continue
malgré tout sa
vie étonnante. En 1913, alors qu'il est nettement dans
des difficultés financières, certaines factures montrent qu'il
commande encore du vin et du Champagne. Encore plus improbable,
on trouve trace de son souhait de commander un curieux kiosque
mauresque et une cage pour une salamandre, le tout pour son
Domaine. Alors que l'autorité judiciaire cherche par tous les moyens
de prouver l'enrichissement anormal du prêtre, ce dernier
continue les provocations... Que cherche‑t‑il ? |
|
Nous sommes en
1914
et la guerre des tranchées éclate. Après des années
insouciantes, le siècle
bascule lentement dans l'horreur. Saunière, malgré ses pires
ennuis, apporte son aide en
donnant quelques messes aux soldats et leur envoie de l'argent.
Cette tourmente entre deux peuples aurait elle permis de faire
oublier l'obsession de Mgr de Beauséjour ? Pas du tout. Le
3
juillet 1915, un article dans "La semaine religieuse"
porte des accusations contre Saunière, et un peu plus tard, une
nouvelle convocation en justice arrive à Rennes‑le‑Château. Sur le conseil de son avocat, Saunière boudera encore
une fois le
tribunal.
Le Vatican déboutera même Mgr de Beauséjour, mais un
contre recours par ce dernier décidera finalement du sort de
Saunière. Le 11 avril 1915, le prêtre ne peut plus exercer.
Pourtant, rien ne paraît faiblir la détermination de l'évêché. Agissant probablement pour Mgr de Beauséjour,
l'abbé de Caune demandera à Saunière de plaider coupable.
Le temps passe
alors jusqu'au
triste jour du 17 janvier 1917 où Saunière, saisi par un
vent glacé, s'écroule à quelques mètres de la
Tour Magdala. Il
succombera finalement le 22 janvier à 5h du matin après
avoir fait le ménage dans ses papiers avec l'aide de
Marie Dénarnaud.
|
|
Comble de l'ironie,
l'abbé Huguet enverra une dernière lettre à son client justement le
22 janvier où il signale que ses démarches à Rome
commencent à porter ses fruits.
Il aura fallu que le dernier
Seigneur de Rennes disparaisse pour que
Mgr de Beauséjour arrête
enfin ses poursuites. Jusqu'au bout, l'évêque aura persécuté Bérenger Saunière, sans
doute beaucoup plus animé par l'envie de savoir, plutôt que par
la simple volonté de stopper un supposé trafic de messes.
Le
5 avril 1930,
Paul‑Félix
Beuvain de Beauséjour
s’éteint à 5h30 du matin à Carcassonne après une longue
agonie. Le doyen de l’épiscopat français avait 91 ans et
venait d’écrire un ouvrage sur les Clermont‑Tonnerre de
Franche‑ Comté. |

Mgr de Beauséjour |
Ses obsèques
furent célébrées le jeudi 10 avril 1930 dans la cathédrale
Saint‑Michel sous la présidence de Mgr Binet, archevêque
de Besançon.
Coïncidence, celui qui oeuvra
dans l'ombre de Saunière disparut la même année, un mois
plus tard. Le R. P. Jean Jourde
devait effectivement décéder le 17 mai 1930 à Montolieu.
La dépouille mortelle de Mgr de Beauséjour repose aujourd’hui dans le chœur de la
cathédrale de Carcassonne aux côtés de son prédécesseur
Mgr Billiard. C’est son
coadjuteur, Mgr Emmanuel Costes
(1873‑1934) qui lui succédera pour une année, avant d’être
nommé à l’archevêché d’Aix‑en‑Provence. |

Le cortège funèbre de Mgr de
Beauséjour, le 10 avril 1930
place Carnot à Carcassonne |
| Que peut‑on
en déduire ?
Les recherches récentes montrent très largement que Bérenger Saunière a été manipulé
durant le vaste projet de rénovation et de construction du
Domaine. C'est‑il défendu en toute bonne foi ? Probablement
oui, mais en protégeant ses intérêts et ses amis. Cet
épisode juridique complexe continue en tout cas d'alimenter les
contradicteurs de l'affaire, persuadés que tout ceci n'est que
le résultat d'agissements frauduleux d'un petit curé de campagne
animé par l'appât du gain. Mais il
ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme. En fait,
la comptabilité de Saunière est complexe, car elle se divise en
deux périodes. L'une se déroule jusqu'en
1899 où le
prêtre est clairement financé. Ce sont les jours heureux d'une
vie mondaine où Saunière invite. La
seconde période démarre à la disparition de
Mgr Billard en 1901 et
sa protection s'arrête. Le projet du
Domaine se termine en
1904 et les fonds s'arrêtent. Saunière qui veut
continuer sa vie mondaine entre alors dans une démarche
toute différente, celle qui consiste à chercher des financements. Il va
continuer le principe du trafic de messes, mais à une autre
échelle. Saunière va alors procéder à un réel démarchage national et
international en utilisant un annuaire ecclésiastique
(1). Voici pourquoi l'origine des fonds
est complexe, car une partie a été programmée avant 1899 et une
autre a été poursuivie volontairement par Saunière.
(1) Se référer à "L'affaire des
carnets" par Franck Daffos
Saunière
était‑il seul dans cette entreprise ?
Sans aucun doute non.
Bérenger Saunière
n'a pas pu effectuer seul un trafic de messes d'une telle ampleur.
Les sommes déclarées et dépensées sont trop importantes et c'est ce qui
perturba le procès depuis le début.
Mgr de Beauséjour, un
homme certainement intelligent, avait parfaitement compris que de
simples versements de messes, même tous les jours, ne
suffisaient pas à expliquer la richesse du prêtre. Les ordres de
grandeur en francs‑or n'étaient pas respectés en comparaison des
sommes engagées. Enfin, les sous‑entendus utilisés dans certains
courriers de ses amis prêtres montrent une large complicité.
N'oublions pas non plus que le
Domaine respecte une
géométrie sacrée complexe servant à calquer un
plan. Saunière n'a pas pu réaliser ce projet seul, c'est
évident.
Saunière
a‑t‑il été manipulé ?
Sans doute oui. Tout montre
que dans la première période avant
1899, Saunière se comportait comme un trésorier et comme
l'exécutant d'une mission de grande importance qu'il devait
accomplir. Les hauts et les bas dans ses finances montrent
d'autre part que
des budgets variés lui étaient alloués pour la réalisation
des travaux. Beaucoup d'ombres résident dans l'origine exacte des
fonds, mais une chose est certaine : une partie de
la somme lui était envoyée sous la forme de mandats en provenance
de toute la France et par des communautés religieuses et
des prêtres. Saunière gardera le secret jusqu'à la fin, refusant de révéler les noms de ses commanditaires.
Quel était
l'objectif de ces fonds ?
Nous connaissons
depuis longtemps une partie de la réponse puisque les sommes
servirent à rénover l'église et à construire un vaste
Domaine.
Surtout, il fallait respecter un cahier des charges précis, car l'architecture, les peintures et les plans devaient répondre
à deux objectifs : attirer l'attention et laisser à la
postérité un message à qui saura le lire...
Saunière était‑il de bonne foi durant son procès ?
La réponse est mitigée.
Saunière se savait sans aucun doute manipulé, car comment
accepter autant d'argent pour la construction d'un Domaine dont
il ne maîtrisait même pas les plans, et sans
se poser de sérieuses questions. Rappelons que Saunière était un homme
intelligent et prévoyant. Il a donc certainement respecté avec
beaucoup d'honnêteté les missions qui lui étaient confiées avant
1899.
Ceci
explique son incompréhension face aux acharnements judiciaires.
Par contre, à partir de 1899, il entre dans un réel trafic,
motivé par la recherche de nouveaux financements, et son
principal souci sera de justifier toutes les sommes reçues. Malgré les
surfacturations et les erreurs grossières, les chiffres ne
convainquirent pas les enquêteurs. Saunière et ses avocats le
savaient. C'est pourquoi ils refusèrent toujours de présenter
une quelconque comptabilité précise et cohérente.
La
conséquence
est que Saunière apparaît comme un pitoyable comptable, ne conservant
aucun justificatif, se contredisant en permanence, et ayant
beaucoup de mal à présenter un état des comptes sur ses
travaux. Le fait de ne pas pouvoir révéler les noms de ses
commanditaires ou d'affirmer qu'il ne gardait pas sa
comptabilité alors que ses carnets sont connus aujourd'hui,
démontrent qu'il manipulait les juges.
Saunière ne livra jamais ses fameux carnets de comptabilité qui
remontèrent jusqu'à nous. Le prêtre
tenait‑il une comptabilité secrète ? Ou s'agissait‑il de pièces
fabriquées après coup pour préparer sa défense ? Soit ils
n'ont jamais servi, soit Saunière avait peur que ces carnets révèlent quelques
secrets ou quelques noms ? Les enquêteurs auraient‑ils pu
remonter jusqu'aux donneurs d'ordres ?
Que savait
exactement l'évêché de Carcassonne ?
Voici une question
réellement passionnante, car la réponse est pleine de paradoxes et d'incertitude. Nous savons par
exemple que Mgr Billard était impliqué dans l'affaire
et complice.
À
l'opposé, Mgr de Beauséjour voulait connaître la vérité
et la réelle source de financement. Nous
savons aussi que Saunière recevait des fonds, mais comment imaginer un
pareil montage sans une organisation bien instruite et
disciplinée. D'autre part et c'est un détail important, dans un
carnet de messe, on trouve une implication certaine de l'évêché
de Carcassonne dans les commandes de messes avant
1899
(2).
Tout montre en fait qu'au niveau de la hiérarchie
carcassonnaise, on connaissait certains secrets bien protégés et
partagés uniquement par quelques initiés. Enfin, et c'est
certainement le plus troublant, on retrouve à des postes clés
proches de l'évêché, tout un petit monde de prêtres qui se
connaissaient fort bien comme :
l'abbé Cantegril (1837‑1919),
vicaire à Saint‑Martin de Limoux et qui finira vicaire général
à Carcassonne, Joseph‑Théodore Lasserre (1833‑1897)
vicaire à Saint‑Martin de Limoux et copropriétaire à ND de
Marceille, etc.... Tous ces prêtres participèrent à des
transferts de fonds au profit de Saunière...
De nombreux détails nous
montrent que Bérenger Saunière conserva jusqu'au bout ses
convictions religieuses, et le combat qu'il mena sur dix ans, il
le fit contre un système juridique qui d'après lui était
incapable de comprendre les réels
enjeux. Saunière ne pouvait pas tout révéler, c'est un fait. Ses agissements bien qu'insolites
et contradictoires ont
été guidés par des intentions qui dépassent de loin un simple
procès et la volonté d'un évêque. Était‑il conscient de son
engagement ? Était‑il guidé par une mission qui l'a dépassé ? Savait‑il pourquoi
et pour qui il se battait ? Qu'elle était ce serment qu'il l'empêchait de révéler le
moindre détail ? Que savait exactement Saunière et que savait
l'évêché ? Avaient‑ils la même connaissance de l'affaire ? Très
probablement non et beaucoup de zones d'ombre existent encore...
(2) Se référer à "L'affaire des
carnets" par Franck Daffos p50 et p92 |
|
Un parfum de 17 janvier... |
|
C'est en janvier
2009 qu'un passionné,
Corjan de Raaf, Webmaster, signalait la présence d'un
nouveau
17 janvier
sur la pierre tombale de Mgr de Beauséjour située à la
cathédrale de Carcassonne. Longtemps passé inaperçu, car peu
visible dans le texte mortuaire, on peut lire à la
6ème ligne en guise de date de naissance : XVII
KAL . JANUAR . MDCCCXXXIX
Il n'y a bien sûr que les
passionnés de Rennes qui pouvaient réagir sur ces nombres très
symboliques :
XVII (17)
assorti de JANUAR (janvier) et
MDCCCXXXIX (1839)
KAL.
est l'abréviation de KALENDIS (latin) ou Calendes, ce qui
signifie que nous sommes en présence d'une date exprimée dans le
calendrier romain. |
|
HIC REQUIE . SCIT
ILLM . AO . RP . DD . PAULUS FELIX
BEUVAIN DE BEAUSEJOUR
CARCASSONENSIS EPISCOPUS
QUI VESULLI IN
SEQUANIA NATUS
XVII KAL . JANUAR . MDCCCXXXIX
CARCASSI OBIIT
NON . APRIL . MCMXXX
VIRTUTE PRAESUL EGREGIUS
AETATE PROVECTISSIMUS
CLERO POPULOQUE VENERANDUS
IN LABORIBUS PLURIMIS
ANNOS XXVIII
ET USQUE AD ULTIMOS VITAE DIES
SUAM STRENUE REXIT ECCLESIAM
IN SPE |

La dalle de Mgr de
Beauséjour
dans la cathédrale de Carcassonne |
| Que sont les Calendes ?
Par définition, c'est le nom que donnaient les Romains au
premier jour de chaque mois. Ainsi, le jour des
Calendes d'avril est le 1er avril. Mais la
curiosité ne s'arrête pas là, car les Romains comptaient aussi
les jours du mois à l'envers de notre calendrier actuel. Par
conséquent le dernier jour du mois était le premier avant les
Calendes du mois suivant. Par exemple, le 31 mars était
pour les Romains le premier avant les Calendes d'avril.
En
fait, il existe dans le calendrier romain 3 types de jours
particuliers que l'on retrouvent dans chaque mois :
 Les Calendes : Le 1er jour de chaque mois
Les Calendes : Le 1er jour de chaque mois
 Les Nones : Le 5ème jour du mois excepté pour
mars, mai, juillet et octobre où c'est le 7ème jour.
Les Nones : Le 5ème jour du mois excepté pour
mars, mai, juillet et octobre où c'est le 7ème jour.
 Les Ides : Le 13ème jour du mois excepté pour
mars, mai, juillet et octobre où c'est le 15ème jour
Les Ides : Le 13ème jour du mois excepté pour
mars, mai, juillet et octobre où c'est le 15ème jour
Règle : Hormis ces
jours particuliers exprimés en Calendes, Nones ou Ides, les
autres jours sont numérotés à l'envers et à partir de ces jours
repères, ces derniers valant 1. Le 17 janvier sera donc en
Romain le
16ème
jour avant les Calendes de février. Le
4 mars
sera le 3ème jour avant les
Nones de mars et ainsi de suite...
Note : Les CALENDES se dit aussi
de certaines assemblées des curés de campagne, convoquées par
ordre de l'évêque. |
Donc le
XVII KAL. JANUAR
se traduit par :
Le
17ème jour avant les Calendes de janvier
ce qui correspond au 16 décembre. Nous retrouvons donc bien la date de naissance de
Mgr de Beauséjour.
Voici
que l'un des indices récurrents dans l'affaire de
Rennes apparaît sur l'épitaphe de l'évêque qui a le plus
combattu pour connaître la vérité sur
Bérenger Saunière.
Avouons que, s'il s'agit d'une coïncidence, non seulement elle
mérite d'être citée, mais elle apparaît comme un superbe
clin d'œil de la part de son voisin pour l'éternité :
Mgr Billard. |
|

Ironie du
sort, devant l'autel, les sépultures de Mgr
Billard
et Mgr de Beauséjour sont côte à côte
|
 |
|



