|
|
Pour beaucoup, le mystère de Rennes‑le‑Château
se résume uniquement au petit village du même nom, voire à
Rennes‑les‑Bains
ou à ND de Marceille. Or
il faut savoir que toute la région du Razès est parsemée de
mystères qui sont autant de pistes à étudier.
Si une
part historique commence à être expliquée de façon certaine,
il reste des zones d'ombres et pas des moindres qui cadrent mal
avec les thèses reconnues. Probablement nous avons
plusieurs trames entrelacées dont seulement certaines commencent à apparaître. |

L'abbé Jean Rivière
|
|
L'église d'Espéraza et l'histoire de
son
abbé Rivière sont très significatives, car même si aujourd'hui
on peut proposer quelques explications à ce qui a pu perturber
cet homme d'Église en recevant les dernières confessions de
Saunière, sa réaction qu'il eut ensuite dans sa paroisse et sa
dépression restent pour le
moins étranges et tout à fait incompréhensibles...
 |
|
Espéraza, un village à priori comme les autres |
|
Espéraza, un village réputé pour ses chapeaux
Espéraza
est une petite commune traversée par l'Aude et située à
environ 2 km de Rennes‑le‑Château entre Couiza et Quillan. Elle compte aujourd'hui environ 2000 ha.
|
|
Son histoire commence, comme beaucoup
d'autres villages de la région, à l'époque de
Charlemagne
vers 813
où de nombreuses abbayes virent le jour. Espéraza
naquit ainsi autour d'un prieuré.
Sa destinée fut similaire à
Rennes‑le‑Château puisque le village se retrouva wisigothique et
carolingien.
|
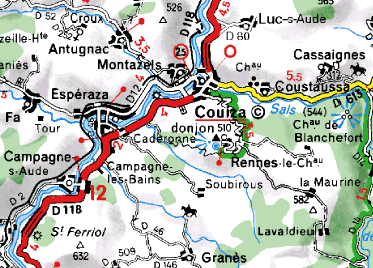 |
|
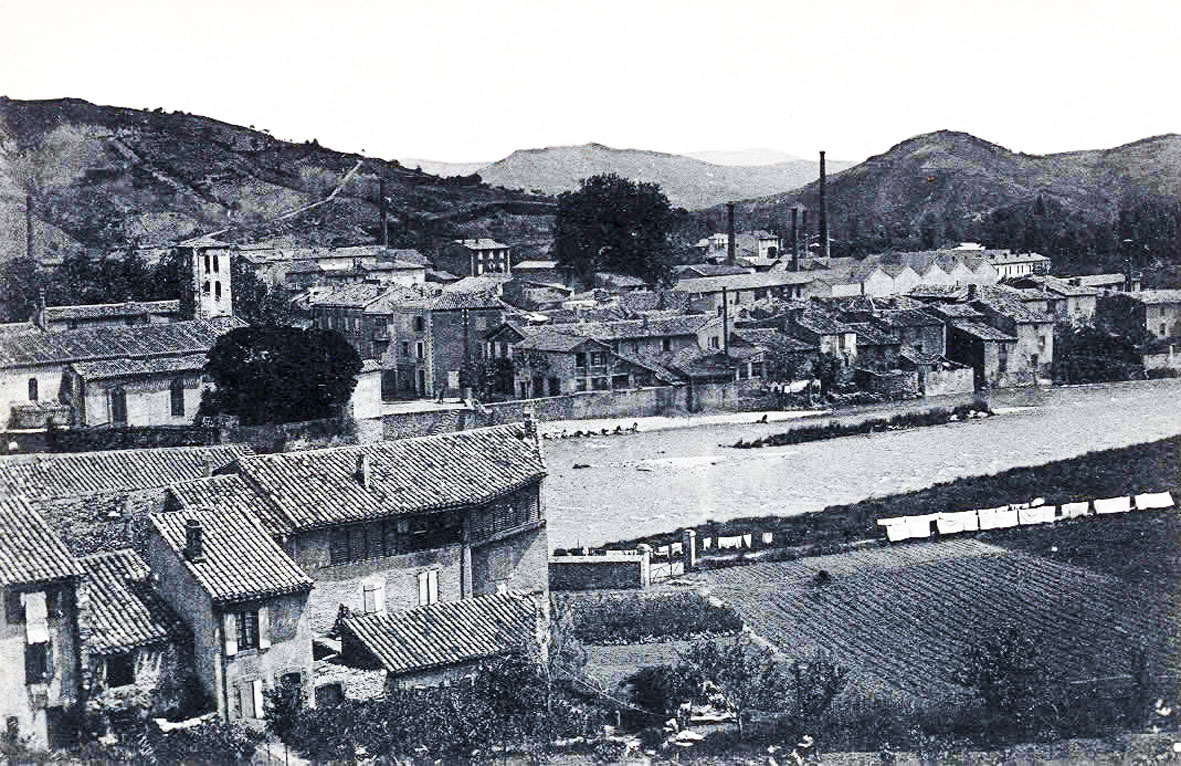
Le village d'Espéraza ‑ Ancienne carte postale |
|
Bien plus tard, vers
1815, le village connut un essor économique
considérable grâce aux chapeliers de
Bugarach
qui s'y installèrent. D'abord en
1830, puis en
1878,
Espéraza connut alors une période prospère dans la
chapellerie. L'arrivée de la voie ferrée à cette époque
favorisa certainement cet essor industriel.
Vers 1929, Espéraza comptait
3000
ouvriers et 14 usines, ce qui permit au village
d'atteindre le 2ème rang mondial des chapeaux‑feutre (derrière Monza en Italie). |
|
Mais la mode, phénomène
inconnu à l'époque, eut un impact terrible sur l'industrie
vestimentaire.
Le chapeau qui se portait de moins en moins
dans cette moitié du 20ème siècle plongea
le village dans une
déprime économique.
|
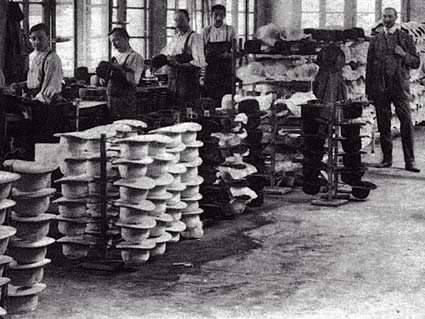
Fabrication de chapeaux Imperts
Usine Bourrel Frères
|
|

Ancienne carte postale d'Espéraza |
|
Licenciements et dépôts de bilan
devinrent fréquents et l'activité de la chapellerie faillit
disparaître. Seule une usine près de
Montazels résista et un musée témoigne
aujourd'hui de ce savoir‑faire.
Espéraza est aujourd'hui une petite ville
d'environ 2100
habitants et elle est connue depuis
1992 pour son centre européen de paléontologie.
|
|

Le vieux pont et Espéraza sur Aude aujourd'hui
|
|
Néanmoins, Espéraza est connue dans l'affaire de Rennes‑le‑Château pour d'autres raisons et notamment par
:
 Marie Dénarnaud qui naquit
à Espéraza le
12 août 1868. Comme son frère et
son père, elle y travaillait comme ouvrière du chapeau
à l'usine.
Marie Dénarnaud qui naquit
à Espéraza le
12 août 1868. Comme son frère et
son père, elle y travaillait comme ouvrière du chapeau
à l'usine.
 L'abbé Rivière qui fut le
confesseur des
derniers jours de Saunière.
Il y fit sa cure entre 1906 et
1920
et confessa
Bérenger Saunière le
21 janvier 1917 durant toute une
après‑midi.
L'abbé Rivière qui fut le
confesseur des
derniers jours de Saunière.
Il y fit sa cure entre 1906 et
1920
et confessa
Bérenger Saunière le
21 janvier 1917 durant toute une
après‑midi.
 Espéraza et son église sont au
centre d'un alignement topographique complexe.
Espéraza et son église sont au
centre d'un alignement topographique complexe.
L'église d'Espéraza
|
|

L'église d'Espéraza très sobre,
aujourd'hui
|
|
L'église romane d'Espéraza fut construite au
XIIIe siècle
et resta dans son état
initial jusqu'au XVIe siècle. Malheureusement, elle fut ravagée par les
incendies provoqués par les guerres de religion et on dut
refaire certaines parties.
L'entrée actuelle de l'église est sobre et inhabituelle. Son apparence très républicaine fait penser au
porche d'une mairie et nous remet en mémoire la loi sur la séparation de l'Église et de l'État promulguée le
9 décembre 1905, une séparation que craignaient
Bérenger Saunière et toute la communauté religieuse de l'époque.
Le porche de l'église aujourd'hui |
 |
|

L'église d'Espéraza en 1900, place
Rouget de l'Isle
du temps de l'abbé Jean Rivière |
|
Si l'entrée extérieure reste humble, l'intérieur dévoile une paroisse richement
décorée. Les peintures murales et les voûtes mettent en valeur un statuaire varié qui nous rappelle un autre lieu...
l'église de Rennes‑le‑Château et son statuaire...
|
|

L'église d'Espéraza reste aujourd'hui encore richement
décorée
|
|
La paroisse était d'ailleurs déjà très décorée en
1900 comme le témoigne cette photo ci‑contre...
L'église est dédiée à
Saint Michel, ce qui explique les deux représentations,
l'une avec un dragon, et la seconde avec
Lucifer en haut‑relief au‑dessus de l'autel...
Ces représentations équivalentes reflètent une tradition religieuse complexe qui s'est
développée au cours des siècles. |

L'église d'Espéraza en 1900 |
|
 |

Saint Michel contre Lucifer sur l'autel
et Saint Michel contre le dragon (ci‑contre)
|
|
Saint Michel terrassant le dragon ou le Démon
Saint Michel est très populaire en Europe occidentale et son origine remonte à la
nuit des temps puisqu'on le retrouve également en Orient. On
le reconnait surtout grâce à ses attributs que sont la lance ou une épée tenue à la main et terrassant un dragon ou le Démon. Michel signifie "Qui est comme Dieu"
(égal à Dieu) et son
personnage est issu de la Bible. Ange parmi les anges, il se caractérise par le fait qu'il est le
Chef des armées célestes et Grand Prince dans le Livre de Daniel (12,1)
d'où son titre d'Archange.
Dans la littérature judéo‑chrétienne, il existe quatre Archanges : Michel, Gabriel, Raphaël, et moins connu, Uriel, qui curieusement n'est jamais cité par l'Église. Saint Michel est représenté soit chevalier avec son armure, soit ange avec une balance face à Satan, et pesant les âmes lors du Jugement dernier. En tant que chevalier on le voit
alors terrassant un dragon qui n'est autre qu'une représentation de Satan, ou du Démon. Son bouclier est orné d'une croix.
Le combat de l'Archange
saint Michel
contre le Démon est évoqué dans l'Apocalypse
de saint Jean (12‑7). À l'issue de cette lutte contre les anges rebelles, le Démon se voit
terrassé et précipité sur la Terre. Cette scène fut reprise par l'Eglise pour symboliser la force du
bien contre le mal, le beau contre le laid, l'Archange puissant et d'une
grande beauté combat le monstre d'une grande laideur.
Il est l'ennemi de Lucifer (ange qui se veut l'égal de Dieu) et il doit sa majesté d'Archange à sa profonde humilité. Ce combat est
aussi issu de l'épître
de Jude (v. 9) où il combat Satan et l'expulse du Paradis,
en lui disant «
Quis ut deus » (Qui est Dieu
?) (en référence à l'orgueil de Satan qui voulait monter au plus haut des montagnes et se montrer ainsi
semblable au divin). L'Archange Saint‑Michel est donc pour les catholiques le premier saint à invoquer pour obtenir une protection contre les Démons. Il existe aussi
d'autres variantes. Le Livre d'Hénoch fait de Michel celui qui soutient l'univers et dans le Talmud, ses relations avec les autres
anges sont comparées à celle du grand prêtre avec Israël sur Terre; il est considéré comme le législateur direct qui s'adresse à Moïse
sur le mont Sinaï (Actes des Apôtres, VII, 38). |
|

Saint Michel terrassant le dragon et à droite terrassant le démon de Raphaël (1505)
Musée du Louvre |
 |
|
Saint‑Michel apparut à
Saint Grégoire le Grand le 8 mai
590 au sommet du
Château Saint‑Ange, à un berger au sommet du
Gargano, en
Pouille, au
Mont‑Saint‑Michel en
Normandie et à Jeanne d'Arc
à Domrémy.
Le premier sanctuaire fut édifié en
492 au sommet du Mont Gargan en Italie du sud. De nombreux autels et églises lui seront dédiés en Italie et en Europe jusqu'en Irlande à
partir du VIe siècle. Plusieurs pèlerinages autour des grands sanctuaires attireront des foules importantes dès le Moyen‑âge.
(Le terme ange vient du grec aggelos, "messager". Le mot démon vient d'un mot
grec ancien, daimon, qui désigne des êtres que leurs pouvoirs spéciaux plaçaient entre les humains et les dieux).
Il est aussi intéressant d'observer la similitude du mythe de Saint Michel terrassant le
dragon, avec une autre légende que les historiens diront ne connaître aucune connexion, celle de
Saint‑George combattant le dragon à cheval
avec aussi un bouclier et une croix... |
|
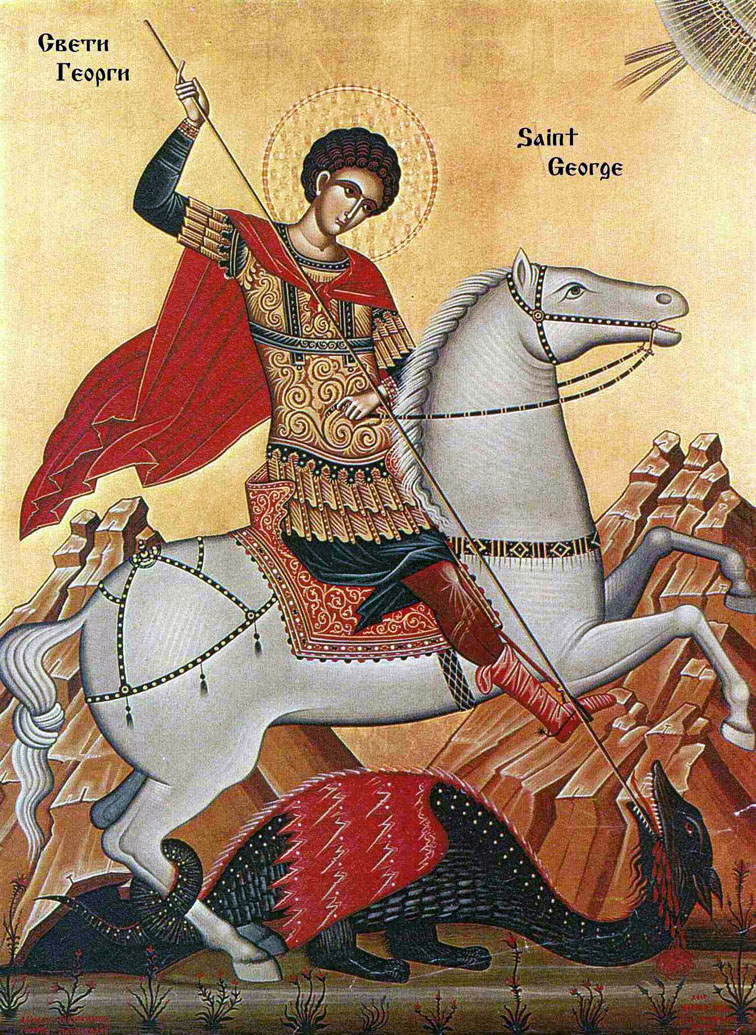
Saint‑George
Eglise orthodoxe Bulgarie |
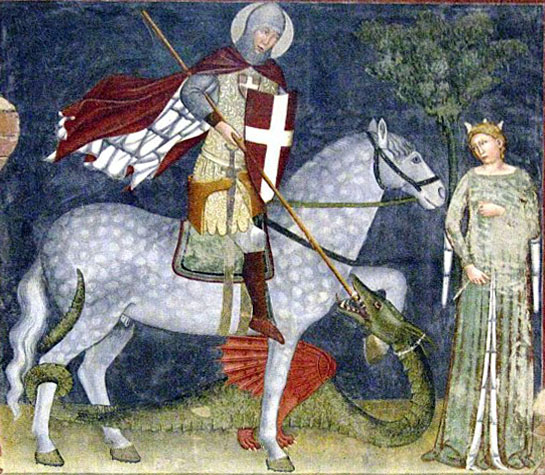
Saint‑Georges et la princesse
Fresque du XIIIe à Vérone église San Zeno |
|
La légende de Saint‑Georges
Au IVe siècle, tous les sujets de l'empereur Dioclétien
(empereur romain d'Orient vers l'an 300) sont invités à offrir des sacrifices aux dieux de l'empire. Cet ordre est tout spécialement
appliqué aux militaires, car il est le signe de leur fidélité. A Lydda, en Palestine, un officier, originaire de Cappadoce, refuse. Il
est exécuté pour refus d'obéissance, mais la popularité de son culte sera telle que la piété populaire ne pourra se contenter des
maigres données de l'histoire. On le fait couper en morceaux, jeter dans un puits, avaler du plomb fondu, brûler dans un taureau de
bronze chauffé à blanc, donner en nourriture à des oiseaux de proie. Chaque fois, Saint‑Georges ressuscite et en profite pour
multiplier les miracles. A ces fioritures morbides, s'ajoute au XIe siècle, la légende de la lutte victorieuse de saint Georges contre
un dragon malveillant qui symbolise le démon.
Ce dont on est sûr, c'est qu'au IVe siècle,
l'empereur Constantin fait
édifier à Saint‑Georges une église à Constantinople. Cent ans après, on en compte une quarantaine en Égypte. On les voit s'élever en Gaule, à Ravenne,
en Germanie. En France, 81 localités se placent sous sa protection et portent son nom. On ne compte plus le millier d'églises dont il
est le titulaire. Il est le patron céleste de l'Angleterre et de l'Éthiopie et le martyr de Palestine.
Les circonstances exceptionnelles de sa mort l'on fait appeler par les chrétiens d'orient "le grand martyr". Son culte s'est très
rapidement développé. Il est devenu le saint protecteur de la Géorgie qui porte son nom. Les croisades contribuèrent à donner au culte
de Saint‑Georges un grand éclat, notamment parmi les chevaliers français et anglais. Il était donc légitime que les cavaliers le
choisissent comme saint protecteur. |
|
Le mystère de l'abbé Rivière |
|
L'abbé Jean Rivière devint célèbre dans
l'affaire de Rennes‑le‑Château grâce à
Gérard de Sède
qui le mit en scène pour la première fois dans son livre "L'Or de Rennes" paru en 1967.
Le
17 janvier 1917, jour très symbolique,
Bérenger Saunière s'écroula au sol victime d'une
congestion cérébrale. C'était devant le sas d'entrée de
la
Tour Magdala.
Encore vivant, mais dans le coma,
Marie Dénarnaud le
transporta, aidée par deux villageois. On l'installa au
presbytère dans sa chambre. Lentement, Saunière revint à lui,
mais il prit aussi conscience que sa fin était proche. Il
chargea alors Marie de détruire certains papiers, et
surtout, il convoqua un prêtre,
Jean Rivière pour écouter sa confession et
administrer les derniers sacrements.
|

L'abbé Jean Rivière
|
|
Le premier fait curieux est que Saunière
ne fit pas appel à un ami prêtre. Il fit plutôt venir un curé
qu'il n'appréciait pas particulièrement, mais qu'il respectait. Peut être
voulait‑il régler ses comptes avec une hiérarchie qui
l'avait abandonné, ou peut‑être voulait‑il ainsi confier son
secret à un homme d'Eglise non initié. Nous ne le saurons
probablement jamais.
C'est alors que les villageois
assistèrent à une scène remplie de mystère. Le
21 janvier,
l'abbé Rivière s'entretint donc avec
Saunière
mourant et la rencontre dura une bonne partie de
l'après‑midi. Non seulement la confession fut anormalement
longue, mais le prêtre sortit d'un coup sec de la chambre,
le visage figé et horrifié. Certains diront qu'il paraissait avoir vu le
diable. Il n'en fallut pas plus pour faire naître une
rumeur et consolider la légende du dernier Seigneur de Rennes.
L'incompréhension dominait. Alors que ces
deux prêtres
se respectaient, comment purent‑ils en arriver là ? Par quel motif grave ou par quelle
révélation
Saunière déclencha‑t‑il chez
Rivière une réaction aussi violente ? Si l'humeur révoltée de Rivière peut paraître anecdotique, il ne reste pas moins
qu'un fait existe, concret et indiscutable :
l'abbé Rivière ne donna pas les derniers Saints Sacrements...
Bérenger Saunière mourut
finalement le
22 janvier 1917 et la cérémonie religieuse eut
lieu le 24 en présence de trois prêtres. Autre surprise, l'abbé Rivière
revint toutefois donner les Saints Sacrements, mais après le
décès, ce qui est interdit par le code religieux. Était‑il
pris de remords ? Ou bien tout simplement, devait‑il préalablement aviser
sa hiérarchie ? Avait‑il reçu des ordres ? Les questions sont nombreuses...
Mgr George Boyer,
Archevêque de l'Évêché de Carcassonne, devait écrire plus tard : "Que
l'Abbé Saunière puisse avoir reçu les derniers Sacrements
deux
jours après sa mort est absolument incroyable..." Feignait‑il de ne pas être au courant ? Ou existait‑il au sein de
l'Évêché de Carcassonne une conspiration du silence ?
Quoi qu'il en soit, après cet épisode de
nombreux témoins, y compris sa nièce, diront que
l'abbé Rivière changea entièrement de comportement. D'un caractère
habituellement gai et bon vivant, il devint dépressif, taciturne,
renfermé, ne souriant plus. L'abbé Rivière semblait pris d'une furieuse dépression, mais qu'elle en est la cause ? Surtout, il entreprit deux
constructions inhabituelles dans son église...
|
|
Les transformations de son
église d'Espéraza
Ce fut après la mort de Saunière que
l'abbé
Rivière entreprit des modifications au sein de sa paroisse, et le plus troublant est qu'il existe un étrange
parallélisme avec les aménagements de Saunière dans
l'église Marie‑Madeleine et dans son
jardin près du calvaire...
Le statuaire
Non seulement on retrouve les statues
de Saint Roch et de
Sainte Germaine se faisant face, mais aussi Saint Joseph
et la Vierge Marie, chacune portant l'Enfant
Jésus. Tout comme dans l'église de Saunière, voici que
l'abbé Rivière semble lui aussi insister sur une
étrange symbolique.
|
|

Saint‑Joseph à Espéraza
|

La Vierge Marie à Espéraza
|
|

L'église de Rennes‑le‑Château, Joseph
et Marie au fond
portant chacun l'Enfant Jésus
|
|
La grotte de Lourdes
L'abbé Rivière ne s'arrêta pas là. Il entreprit aussi deux
constructions peu courantes. Il édifia d'abord une
représentation réaliste de l'apparition de la Vierge à
Bernadette Soubirou à
Lourdes en
1858. La petite chapelle à droite de l'entrée fut
transformée en une grotte sombre faite de pierres de rivière identiques à celles utilisées par Saunière pour ses fausses grottes.
|
|

L'apparition de Lourdes à Espéraza reconstituée par l'abbé Rivière
|
|
Jésus dans une grotte
Encore plus passionnant et plus troublant, il édifia
une seconde construction. Juste en face de la fausse grotte de
Lourdes, l'abbé Rivière élabora une seconde grotte artificielle en guise de
Station XIV et y glissa
Jésus dans son linceul...
Cette représentation est étonnante
dans une église, surtout de la part d'un prêtre
conventionnel comme l'était Rivière. Selon la tradition officielle, la
station XIV doit représenter la mise
au tombeau du Christ par
Joseph d’Arimathie, Marie,
Marie‑Madeleine et Jean.
La
représentation de
Jésus dans un tombeau en forme de grotte est rare. Non seulement selon les Évangiles c'est un épisode transitoire,
mais ce symbole est en parfaite contradiction avec le
principe de Résurrection (Il ne peut y avoir de corps post
mortem puisque Jésus est fils de Dieu et qu'il a
ressuscité).
|
|

La sépulture du Christ construite par
l'abbé Rivière dans une grotte artificielle
|
|

Le Christ est représenté mort, mais les
yeux entrouverts...
|
|
Pour continuer dans les symboles, la grotte est surmontée d'une
autre représentation christique. Cette fois‑ci, Jésus est debout dans une position
saint‑sulpicienne, la main montrant le sacré cœur.
Jésus vivant
veut‑il nous indiquer qu'une partie de lui est sous ses
pieds ? Ou bien sommes‑nous en présence de
deux Jésus différents, l'un spirituel et le second
mortel ? Il est en tout cas indéniable que
l'abbé Rivière n'a pas voulu mettre à l'aise ses
fidèles.
|
|

La grotte construite
par l'abbé Rivière
|

Le Christ sur la grotte
|
|
Et comme si cela ne suffisait pas, une autre décoration face à la grotte interpelle.
Il s'agit en fait d'un autel orné d'une tête de mort.
Le signe macabre rappelle celui gravé sur le portail du
petit cimetière de Rennes‑le‑Château.
Décidément on a le sens des symboles chocs dans la
petite église d'Espéraza...
L'autel en face de
la grotte christique |
 |
|
Analogie avec Saunière
De nombreuses analogies existent entre
les aménagements de Rivière et ceux de Saunière dans son
jardin. La plus troublante est bien sûr l'une des
fausses grottes de Saunière. Cette construction valut au prêtre
de nombreuses heures de marche dans la campagne afin de
remonter dans sa hotte des pierres
venant probablement du ruisseau des
couleurs.
L'analogie continue puisque l'on
trouve aussi non loin de la grotte, la statue de
ND de Lourdes
sur le pilier inversé. Décidément
ces deux prêtres ont des obsessions communes.
|
|

La grotte principale de Saunière
reconstituée
à Rennes‑le‑Château
|

La statue de Notre Dame de Lourdes
posée sur son pilier inversé
|
|
Que devint l'abbé Rivière ?
Contrairement à certaines rumeurs,
Jean Rivière
ne décéda pas six mois après
Saunière suite à une dépression. Il resta en fait à
son poste d'Espéraza jusqu'en
1920, soit
3 ans après la disparition de
Saunière. Il lui fallut en effet 3 ans pour mettre en place ses nouveaux emménagements
dans l'église. Il partit ensuite d'Espéraza pour aller à
Coursan
où il prit une nouvelle cure comme doyen jusqu'à la fin de
sa vie en
1929.
|
|

Sa plaque commémorative dans l'église
d'Espéraza
|
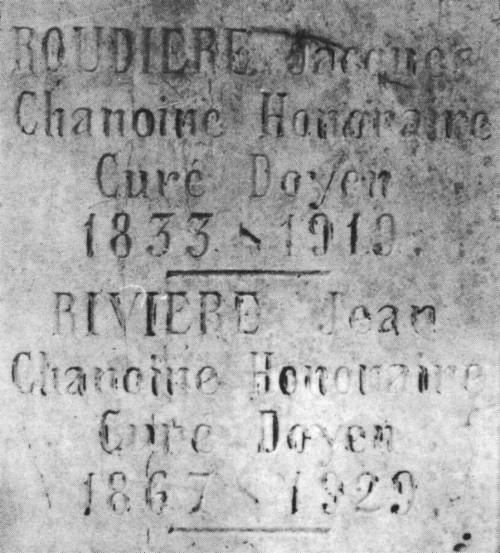
La stèle de l'abbé Rivière
|
|
Existe‑t‑il d'autres exemples d'un Christ gisant
?
Une première réaction face à cette
grotte christique est tout simplement de se poser la
question si nous sommes en présence d'un cas unique ou bien
si dans l'histoire religieuse, des représentations
semblables sont apparues. Il est évident impossible de fournir une liste exhaustive de cas
semblables, mais la première impression est que cette
représentation est extrêmement
rare. Voici toutefois un autre cas se trouvant d'ailleurs dans
la région. Il manque tout de même la grotte :
|
|
Languedoc Roussillon à Marquixanes
(canton de Vinça)
Église paroissiale de Sainte‑Eulalie et
Sainte‑Julie
Christ gisant dans une châsse en bois
taillé
(17e ou 18e
siècle)
|
 |
|
Si ce Christ est bien gisant, il n'est
pas représenté dans une grotte et les
recherches montrent que la
représentation n'est pas banale...
|
|
Une confession effrayante !
Parmi toutes les hypothèses concernant la dépression
soudaine de
l'abbé Rivière,
il existe une version crédible. L'explication pourrait être fournie par une autre affaire retentissante : le mystérieux
assassinat de
l'abbé Gélis. En effet, si
l'on prend l'hypothèse que les frères Saunière,
Bérenger et
Alfred
participèrent à ce meurtre, il semble tout à fait
naturel que la confession de
Bérenger Saunière dût
quelque peu effrayer le pauvre
abbé Rivière.
Il faut rappeler que, bien que cet
assassinat n'ait jamais été résolu, il est possible à partir des comptes‑rendus d'enquête de déduire un ensemble de faits qui
tendent à montrer qu'il s'agit d'un meurtre entre prêtres
(se
reporter au Forum "Le meurtre de l'abbé Gélis")
La conséquence de cette
confession, si elle eut lieu en ces termes, aurait alors créé un énorme trouble chez
Rivière qui ne devait
certainement pas être préparé à ce type d'annonce. Car
comment gérer une telle situation ? Comment donner les
Saints Sacrements à un prêtre qui avoue s'être rendu
coupable ou complice d'assassinat ? D'ailleurs,
l'abbé Rivière avait‑il la possibilité d'accorder les
Saints Sacrements à
Saunière sans en référer à sa hiérarchie ?
Si cette thèse est intéressante, elle n'explique pas tout. Comment
expliquer le désir obsessionnel de Rivière de construire dans son
église des représentations religieuses inhabituelles. Il est
évident que si le meurtre de
l'abbé Gélis est un des
aspects, il reste toute la vie secrète de
Saunière
qui pouvait être susceptible d'être confessée.
L'abbé Rivière
aurait‑il donc entendu tout ou une partie de ses
secrets ? Si le secret était incroyable, pourquoi
Rivière devint perturbé au point de vaciller
dans la dépression ? Une telle confession de nos jours
aurait certainement diagnostiqué l'état du mourant comme
proche de la folie. Saunière
aurait‑il fourni des arguments si convaincants que
l'abbé Rivière n'eut d'autres choix que de se sauver en
laissant le prêtre à son propre sort ?
Voici autant de questions qui montrent
combien le mystère de Rennes‑le‑Château a encore de beaux
jours devant lui...

Comme
Bérenger Saunière,
Marie Dénarnaud ou
Antoine Gélis,
l'abbé Jean Rivière disparut en emportant avec lui son
secret. Dommage, car quel chercheur de Rennes n'a pas rêvé un jour
d'entendre cette fameuse confession du
24 janvier 1917
qui valut à
Bérenger Saunière, prêtre, de ne pas recevoir de son vivant
ses derniers Saints Sacrements...
|
|
|



