|
Lorsque l'on évoque les tableaux
liés à Rennes‑le‑Château, la première œuvre qui vient à
l'esprit s'intitule "Les Bergers d'Arcadie" de
Nicolas Poussin. Or, il faut savoir qu'il existe non seulement deux
versions du maître, mais aussi une multitude de déclinaisons
arcadiennes réalisées postérieurement par des artistes
peintres ou graveurs, plus ou moins connus
et à différentes époques. Ainsi, le tableau culte de Poussin
fut reproduit à Shugborough Hall en Angleterre, sur
le mausolée du maître des Andelys
à Rome dans l'église
San Lorenzo in Lucina, un mémorial dressé par
René de Chateaubriand.
Cette constatation ne s'arrête pas là puisqu'il existe
également un tableau arcadien remarquable de Guercino
antérieur à Poussin.
Fascinant à plus d'un titre, d'une
intelligence exceptionnelle, conçu sur la base d'un support géométrique complexe et sacré, le tableau
de Poussin possède plusieurs codages imbriqués
et plusieurs niveaux de lecture. On sait aujourd'hui
grâce à son histoire et le profil montagneux en
arrière‑plan (représentation de trois sommets célèbres :
le Cardou,
la Pique Grosse et le sommet du
Bézu) que la toile est directement liée au Secret des deux Rennes et à un secteur précis du Haut‑Razès,
le Bézis... |
|

"Les Bergers d'Arcadie" (Version II)
par Nicolas Poussin
faussement daté entre 1638 et 1640, plus vraisemblablement
peint
vers 1655
|
|
Que n'a-t-on pas écrit, analysé ou décodé sur
les Bergers d'Arcadie II de
Nicolas Poussin ?
On ne compte plus les chercheurs du monde
entier qui se passionnèrent pour ce tableau. Nettement
moins connue du public que la Joconde de Vinci, la toile renferme
pourtant des merveilles insoupçonnées.
Ses degrés de lecture
et d'interprétation sont multiples. Son histoire est hors norme. Mieux encore, le tableau
cache une géométrie sacrée et une topographie inégalée ouvrant vers le Secret des deux Rennes. Ce tableau est l'héritage que nous a transmis
Nicolas Poussin... |
|

Les Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin dans un pentacle
Essai de géométrie d'après Henry
Lincoln
(couverture
Le Temple retrouvé ‑ édition Pygmalion)
|
|
Mon naturel
me contraint à chercher et aimer les choses bien ordonnées,
fuyant la confusion qui m'est contraire et ennemie comme est
la lumière des obscures ténèbres...
Correspondances de Nicolas Poussin
|
|
On ne compte plus les études, les écrits,
les analyses et les hypothèses élaborés à propos des
Bergers d'Arcadie de
Nicolas Poussin. Chaque auteur, chaque chercheur y
voit une interprétation et un décryptage différent. Tout y passe, de la
position des personnages à la forme des ombres, de
l'allégorie mythologique à la géométrie sacrée, en passant
par l'alchimie ou les sciences occultes. De même, les déductions visuelles
ne trouvent aucune limite : certains croient voir une forme improbable sur un rocher, d'autres une gourde dissimulée
dans les replis d'un vêtement. L'analyse d'une image numérisée offre parfois des surprises qu'il faut impérativement vérifier sur la peinture
originale. Un exemple est celui de cette petite pyramide qui fit l'objet d'un article très officiel publié par un
spécialiste américain. La petite pyramide n'était en fait qu'un malheureux coup de pinceau comme j'ai pu le constater en allant observer de très près
l'œuvre originale exposée au Louvre.
Pourquoi une telle frénésie ? Simplement
par ce que ce tableau est une énigme à lui seul et
qu'il renferme des propriétés incroyables. Sans doute aussi
parce que, nous en sommes sûr aujourd'hui, la toile détient
plusieurs clés liées à l'énigme de Rennes‑le‑Château. Nous avons aujourd'hui la preuve en image que le fond montagneux est celui
du Haut‑Razès.
La difficulté est donc de trouver une cohérence dans les différentes lectures. Mais surtout, le
premier problème que le chercheur doit surmonter est celui de travailler sur des bases
objectives et correctes. Les copies transformées, colorisées, ou déformées par la numérisation ne manquent pas et il faut avoir
constamment en
tête les mesures exactes avant de procéder à une quelconque étude. Il faut aussi prendre en compte non
seulement l'histoire du tableau, mais également sa restauration et ses repeints. Il faut enfin savoir que certains travaux parus depuis plusieurs années
se sont construits sur une méconnaissance totale des contraintes liées à la peinture et des manipulations qui furent introduites
sur la toile au siècle dernier... |
|

Exemple d'étude montrant jusqu'où il
ne faut pas aller...
|
|
Beaucoup de questions restent encore sans réponse. D'ailleurs, le
domaine d'investigation n'est pas limité aux
Bergers d'Arcadie (version II) puisque
Nicolas Poussin
avait composé une réelle série des Bergers allant du
Roi Midas à la source du Pactole
jusqu'au paisible tombeau arcadien...
Avant d'aborder les constatations et les
analyses concernant la restauration du tableau, il est intéressant d'observer quelques radiographies officielles. Elles sont à mettre en
parallèle avec ce qui suit...
Je tiens bien sûr à remercier Patrick Merle
pour son excellente analyse
et sa riche contribution...
Patrick Merle est spécialiste
dans la restauration des peintures avec 30 années d'expérience
professionnelle et finaliste de la XVIIe Exposition
Nationale du travail (Paris 1986) section Rentoileur |
|
Les Bergers d'Arcadie sous la lumière |
|
Comme pour d'autres tableau d'exception, les Bergers de Poussin eurent aussi droit à leurs
photos médicales. Ces quelques clichés étonnants sont peu connus
du public, mais ils sont classiques pour les experts. Ils
montrent les Bergers d'Arcadie selon des analyses photographiques
différentes : par Infra Rouge, en lumières rasantes, ou par
radiographie. |
|

Radiographie qui montre au delà de l'Infra Rouge,
en particulier la marque de la
collection royale (en bas à gauche), certainement peinte au
pochoir sur le dos, et donc non
visible avec le rentoilage, et le bâton peint avant le
tombeau (Photo P. Merle)
|
|

Photo Infra Rouge montrant les
sous‑couches de la peinture, et donc sous
certains repeints ; remarquez le tronc en haut, le paysage
et le ciel à droite,
l'ombre du bras sur le tombeau...
(Photo
P. Merle)
|
|

Photo noir et blanc prise en lumière
rasante
On voit nettement les bandes de toile ajoutées en haut et
en bas...
(Photo P. Merle)
|
|

Photo sous fluorescence UV datant de
1960 et qui montre en sombre les repeints
récents
posés sur le vernis ancien, qui renvoie la
fluorescence
(Photo P. Merle)
|
|

Photo sous fluorescence UV datant de
1993 qui montre en sombre les repeints récents
posés sur le vernis ancien qui renvoie la fluorescence.
On peut ainsi bien voir la nouvelle restauration
(Photo P.
Merle)
|
|
La photo sous fluorescence UV de 1993
montre les repeints très récents qui servent à corriger les
repeints plus anciens qui ont viré, ce qui posait problème
puisqu'ils devaient rester visibles. Observez sur la droite la
bande noire qui illustre cette opération, ainsi que la bande horizontale en haut nettement marquée.
Il faut aussi noter que par rapport à la photo de
1960 il y a eu des
allègements de verni à certains endroits et pas à d'autres.
Nous allons aussi voir ci‑dessous que la version des Bergers du Louvre comporte sous son cadre deux bandes horizontales masquées
en haut et en bas alors qu'une bande verticale à
droite est restée visible. |
|
Les Bergers d'Arcadie, un tableau
défiguré... Par Patrick Merle, restaurateur
d'art |
|
Quelques notions de restauration
Avant de s'occuper de la remise en
état esthétique, l'objectif étant de remettre la peinture
dans un état aussi proche que possible de ce qu'avait
réalisé l'artiste, il faut vérifier la solidité structurelle
du tableau et sur ce point il est possible d'intervenir de
diverses façons.
La consolidation matérielle ‑ L'encollage
Un tableau est constitué d'un support
toile ou bois (je n'aborderai pas les problèmes du bois qui
sont très spécifiques), d'un encollage, d'un enduit, d'une
couche picturale et d'un vernis. Avec le temps, tous les
supports bougent : le bois dans un sens en travers des
fibres, la toile dans les deux sens à cause des échanges
hygrométriques. Pendant ce temps, l'ensemble enduit
peinture perd sa souplesse et devient cassant. Quand
celui‑ci ne peut plus suivre les mouvements du support, il
se faïence en formant des écailles souvent en "cuvettes" si
la toile se rétracte.
Le jour où l'encollage ne joue plus
son rôle, l'écaille tombe. C'est l'enduit qui lâche, et il
entraîne la peinture qui est fixée dessus. Dans ce cas,
l'opération de base consiste à faire passer de l'adhésif à
travers la trame de la toile pour reconstituer l'encollage
et remettre à plat les écailles par pression.
|
|

1‑ châssis, 2‑ toile,
3‑ encollage,
4‑ enduit,
5‑ couche picturale, 6‑ vernis
|

Exemple de châssis en bois à clés
et toile de lin de rentoilage
|
|
La consolidation matérielle
Le rentoilage
S'il y a des trous, des
déchirures, des bords de tension affaiblis, ou une mauvaise
résistance mécanique de la toile, on pratique alors un
rentoilage qui est l'opération classique de
consolidation générale.
On utilise pour cela un bâti (sorte de châssis
très solide, sans traverses, plus grand que le tableau à
restaurer) sur lequel on monte une toile neuve que l'on
traite pour casser sa nervosité.
La préparation du tableau consiste alors à coller sur la peinture
un cartonnage de protection, puis à refixer les fonds par encollage. Enfin, s'il y a des déchirures on colle une
tarlatane de rigidification (sorte de gaze aux dimensions
stables). Cet ensemble est enfin collé sur la toile neuve
tendue sur son bâti.
|

Un exemple de rentoilage sur bâti
d'un tableau complètement déchiré
|
|
Après mise à plat par pression et
séchage, la toile neuve est coupée avec une marge pour la
tension, et il ne reste plus qu'à monter le tout sur le
châssis normal du tableau qui doit être solide et à clés
(coins de bois qui permettent de régler la tension).
Cette marge peut être plus
grande que nécessaire. Si on veut agrandir le tableau, il
suffit de couper une ou plusieurs bandes sur une vieille
croûte dont la toile est plus ou moins similaire, puis de
les coller sur la toile neuve en prolongement de celle
d'origine au moment du rentoilage. De ce fait, on aura
compensé l'épaisseur, et l'état de surface ressemblera
beaucoup à celui de la peinture d'origine. Il ne restera
plus qu'à monter l'ensemble sur un nouveau châssis, adapté
aux nouvelles dimensions, et à passer à la phase esthétique.
C'est à ce stade que les vraies difficultés commencent...
Cette description correspond au
rentoilage classique français à la colle de farine. Dans les
pays nordiques (Hollande, Angleterre, ...), celle‑ci étant
trop sensible à l'humidité, c'est un mélange cire résine qui
est utilisé depuis longtemps. Aujourd'hui, on utilise
des résines synthétiques éventuellement misent en
œuvre avec une table chauffante sous vide.
Pour mémoire il est possible, si la
résistance mécanique de la toile le permet, d'éviter le
rentoilage en posant des bandes de tension sur la périphérie
pour un remontage solide ; et si les trous et déchirures sont
petits et peu nombreux, en posant des pièces. Il s'agit là
d'un pis‑aller économique, mais qui a l'avantage de
conserver le tableau dans un état au plus proche de
l'origine. L'agrandissement est dans ce cas impossible.
Il existe aussi une technique radicale
qu'on appelle
transposition. Après la pose d'un cartonnage très
solide sur la peinture, on supprime le support toile ou
bois. On ne conserve alors que la couche picturale et
l'enduit sur lequel elle est fixée. On reprend l'enduit, on
colle dessus une double tarlatane qui remplacent le support
d'origine (un bois peut se transformer en toile), et enfin on rentoile l'ensemble. Un agrandissement est là tout à
fait possible. Cette technique que l'on pensait définitive
s'est avérée avec le temps ne pas l'être. Elle ne se
pratique plus aujourd'hui excepté dans des cas très
particuliers.
|
|
"Les Bergers d'Arcadie" du
Louvre
a été rentoilé...
Pour comprendre les conclusions qui vont
suivre, il faut au préalable comparer le tableau original avec son cadre, puis le même tableau sans son cadre. Pour cela, il
existe fort heureusement une photo d'archive sans cadre prise par le Louvre lors d'une séance de nettoyage. C'est grâce à cette image
déposée furtivement sur le Web que de nombreuses constations purent être tirées.
La comparaison est édifiante, et le plus
visible est cette bande horizontale noire en haut. Le cadre
d'origine cache en effet dans sa feuillure une importante partie du dessin qui a noirci avec le temps. La première réaction est de
se demander pourquoi une partie du tableau a été occultée... En fait
cette bande n'est pas d'origine...
|
|

Les Bergers d'Arcadie II de Nicolas Poussin dans son cadre ‑ Musée du Louvre
Date officielle 1639 ‑ 1640 ‑ date beaucoup plus probable 1655
|
|

Les Bergers d'Arcadie II sans son cadre ‑ Photo
d'archive du Louvre
La marge de 7cm en haut et qui a noirci est nettement visible
(Nous verrons que cette bande haute a été ajoutée et sert à modifier les dimensions
d'origine
du tableau afin de casser la composition de l'œuvre)
|
|
On ne peut exclure une transposition et seul le musée du Louvre saurait dire ce qu'il en est
réellement. Un autre constat est important à retenir : la toile a été renforcée par un rentoilage provoquant son agrandissement.
Ce procédé qui a pu être décidé officiellement pour la consolidation de l'œuvre reste incompréhensible du point de vue de la taille du
tableau qui s'est vu modifiée. Le vrai objectif aurait été alors de pratiquer l'agrandissement pour perdre définitivement les
dimensions d'origine définies par Poussin.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, observer le dos du tableau ne servirait à rien ! La toile arrière
est continue jusqu'aux retours sur les bords du châssis.
L'opération était‑elle justifiée
par l'état du tableau ? Ou bien, s'agissait‑il d'une restauration pour permettre ce fameux agrandissement ? Nous l'ignorons.
Faisons maintenant l'exercice du superposer avec précision
l'image des Bergers du Louvre sans son cadre sur le tableau avec son cadre d'origine. Ceci permet de se rendre compte des parties dissimulées. La
première remarque est évidente : si les marges, gauche, droite, et basse, semblent compatibles avec la feuillure, la marge haute ne l'est pas du
tout. Le tableau agrandie n'est visiblement plus adapté à son cadre d'origine. Cet agrandissement aurait‑il finalement échoué ? Aurait‑il été abandonné ?
Il est clair qu'aujourd'hui personne ne peut ce douter de la malversation tant que le cadre d'origine est conservé et la marge haute
reste discrètement dissimulée. |
|

La limite rouge montre la dimension actuelle de la toile dans son cadre d'origine
La bande de 7 cm en haut est cachée par le cadre |
|
La présence d'une marge horizontale de
7 cm en haut de la toile est un fait, et il ne s'agit nullement
d'une supposition. De plus, le sujet ne peut être ignoré des
spécialistes qui se gardent bien de l'aborder
officiellement, et la raison est cinglante : cet agrandissement avéré est une aberration totale qui ne trouve
aucune explication rationnelle, que se soit en matière de technique, de déontologie, ou
d'histoire de l'art. Car il faut savoir que transformer un tableau du XVIIe siècle relève pour tous les
professionnels de l'art d'un pur sacrilège, surtout sous la direction d'un musée aussi prestigieux que le Louvre.
Il existe un moyen de vérifier que cette transformation est parfaitement connue des
experts. Pour cela, il suffit de se référer aux notices de Nicolas Poussin
sur le site Utpictural18 et de lire la légende concernant les Bergers d'Arcadie
version II :
Dimensions : Hauteur 85 cm * Largeur 121 cm
La toile a été agrandie de 7 cm en hauteur,
de 4,5 cm à
droite
et de 2 cm en bas
Surprise : non seulement une bande de 7 cm a été ajoutée en haut de la toile, mais également à
droite et en bas. Ce cas est‑il isolé ? Pas du tout, car "Les Bergers d'Arcadie" version I (version
anglaise) a aussi fait
l'objet d'un agrandissement.
On peut ainsi lire dans la base d'archive :
Dimensions : Hauteur 101 * Largeur 82
cm
Une bande de 8 cm environ a été ajoutée sur la gauche,
ainsi
qu'une autre non mentionnée de 2,5 cm en haut
|
|

Les Berger d'Arcadie I par Nicolas Poussin ‑ 1638‑1639
Version anglaise
|
|
Il faut savoir que le procédé d'agrandissement ne pose à priori aucun problème technique particulier
au niveau structurel. Le travail reste toutefois long,
complexe, et par conséquent coûteux. Cette technique connue depuis
au moins 250 ans n'est donc pas bénigne, et il faut de bonnes raisons pour se lancer dans une telle opération.
Pour avoir une idée de l'époque
à laquelle ce travail fut réalisé, il faudrait examiner les
caractéristiques de la nouvelle toile, le modèle des
semences de montage, et le type du châssis. C'est encore une
fois le Louvre qui connaît la réponse.
La question
reste donc posée :
Pourquoi avoir réalisé sur ces deux
tableaux jumelés un travail complexe et coûteux qui de plus est considéré par tous
les spécialistes et les amateurs de l'art comme une lourde
faute professionnelle ? La déontologie du métier interdit
formellement en effet de modifier le format d'origine d'un tableau, et encore plus celui d'un maître du XVIIe siècle.
|
|
La remise en état esthétique |
|
Après la consolidation, il faut tenter de ramener la partie visuelle du
tableau dans un état aussi proche que possible de ce
qu'avait voulu le peintre dans la limite de son évolution.
L'action se déroule en 3 phases :
1 ‑ Enlèvement de tous les apports
intempestifs dus au temps et surtout :
‑ la crasse
grise qui se dépose. Elle se retire en général facilement
‑ le vernis qui vire jaunâtre et se
décompose, qui peut être soit enlevé, soit
allégé
‑ les repeints des anciennes
restaurations ou des bidouillages qui sont
souvent très délicats à supprimer.
Suite à ce travail, on retrouve tout ce qui reste de
l'origine de la peinture dans la limite de
l'évolution de ses différents composants.
Ces opérations peuvent être très simples
comme très complexes. Mal maîtrisées, elles
sont parfois dangereuses pour
l'intégrité de l'œuvre, mais sans cette restauration un tableau du
XVIIe
siècle serait totalement illisible.
|
|

|
Sur cet exemple, le rond sombre
est constitué par de la crasse
Le jaune brun est dû au vernis
qui a viré. Là où il a été enlevé la vraie couleur apparaît
Les stries grisâtres
horizontales sont des repeints qui ont noirci et qui
servaient à noyer une balafre verticale
|
|
2 ‑ Masticage :
Une fois la peinture dégagée, il faut mastiquer les manques, c'est à dire les
endroits où l'ensemble enduit‑peinture écaillé a lâché, ainsi que les accidents mécaniques comme les trous ou les déchirures.
3 ‑ Réintégration esthétique :
Il reste ensuite à réintégrer les manques et les usures. Ces retouches
s'appellent aujourd'hui des "repiquages",
car elles se font avec un tout petit
pinceau, de façon illusionniste si
l'ensemble du sujet est présent. Par contre,
sur des tableaux très abîmés avec des
manques importants, la retouche reste
visible volontairement.
Officiellement, cette méthode aurait été mise au point pour
que l'amateur sache ce qui est d'origine et
ce qui ne l'est pas. En réalité, la vraie raison est
qu'il est totalement impossible de
reconstituer des surfaces importantes de
façon satisfaisante.
Une peinture ancienne
subit de multiples évolutions. Les
pigments se modifient avec le temps et interagissent
dans les mélanges à l'huile de lin qui
sert d'agglomérant, se transformant par
oxydation en brunissant. De ce fait, une
peinture neuve ne pourra jamais donner le
même effet qu'une peinture ancienne. Il est
possible de créer une certaine illusion sur des
endroits ponctuels, mais pas sur des grandes
surfaces. Dans le passé, le restaurateur débordait
largement sur l'original, mais aujourd'hui
c'est totalement exclu pour préserver l'œuvre originale au maximum.
Depuis
l'entre deux guerres, les retouches à l'huile
les plus proches en théorie de l'original ont
été abandonnées pour deux raisons :
‑ Elles deviennent très
solides avec le temps et donc très difficiles à
enlever sans abîmer la peinture ancienne
‑ Elles se transforment de façon très sensible,
si bien que même correctement réalisées,
elles se désaccordent au bout de quelques
décennies.
Les couleurs utilisées en
restauration sont donc spécifiques de manière à rester stables et facilement réversibles. Par
contre, elles ne permettent pas d'obtenir des effets aussi lumineux que dans la peinture à l'huile.
4 ‑ Vernissage :
Pour finir, l'ensemble du tableau est
reverni pour le protéger. Cela permet aussi de
redonner toute leur valeur aux tonalités, aux contrastes et à
la lumière.
|
|
Les mésaventures des Bergers du Louvre |
|
Reprenons les mesures
Maintenant que la technique de
restauration a été abordée, voyons les
explications qui en découlent autour du chef d'œuvre arcadien, et sur lequel on
a écrit tout et son contraire.
La notice du Louvre (base Joconde et
Utpictural18) annonce une taille du tableau de
85 cm x 121 cm. Cette taille est celle que l'on observe dans son cadre. Pour obtenir la dimension hors tout il faut ajouter environ
1 cm sur tous les bords
de la toile permettant ainsi le recouvrement de la feuillure.
On obtient alors les
dimensions approximatives suivantes :
87 cm x 123 cm
Celle taille est d'ailleurs confirmée par la
gravure de Bernard Picart (1663‑1733)
réalisée en 1696
et qui annonce : 2 pieds 8 pouces x 3 pieds 9 pouces
soit très exactement :
86,624 cm x 121,815 cm ou :
87 cm x 122 cm
Ceci prouve que le tableau a bien été
agrandi puisque si on ajoute la bande haute de
7 cm on obtient une hauteur hors cadre de
87 cm + 7 cm = 94 cm
Il faut d'ailleurs noter que cette
bande horizontale n'est pas parallèle. Elle mesure 6,5 cm à gauche et 7,5 cm à droite.
Qu'en est‑il des autres bords ?
Contrairement a ce qui est écrit,
la
bande basse n'a pas été ajoutée. Elle compense uniquement une partie abimée par la poussière et l'humidité. Car il faut savoir
que les tableaux anciens souffrent souvent d'un même mal : la crasse s'accumule au bas de la toile provoquant sous le cadre avec
l'humidité un pourrissement très localisé.
Il n y a pas de bande droite ou
gauche ajoutée. Sur le bord droit, un phénomène de tension de la toile fait par contre croire à une bande.
Finalement et en tenant compte de
l'agrandissement haut, la toile possède aujourd'hui les dimensions suivantes :
94 cm x 122 cm
...ce qui est très différent de la taille notée par Bernard Picart, et encore moins celle qu'avait choisie Poussin.
Une chose est sûre, le Louvre ne
fournit
aucune information précise à ce sujet, rendant cet agrandissement parfaitement énigmatique. L'objectif serait‑il de semer le doute ? ou bien s'agit‑t‑il d'une
restauration malheureuse qui aurait été abandonnée ? Décidément ce tableau exceptionnel cumule les
anomalies et les incohérences aussi bien dans ses dimensions que sur sa date de réalisation officielle....
|
|
Œuvre |
Dimensions |
Rapport |
|
Dimensions arrondies indiquées sur la gravure de Bernard Picart
(référence) et définies par Nicolas Poussin |
87 cm x 122 cm |
1,40 |
|
Dimensions précises indiquées sur la gravure de Bernard Picart
(référence) |
86,624 cm x 121,815 cm |
1,41 |
|
Dimensions du tableau original (Louvre) partie visible (avec cadre) |
85 cm x 121 cm |
1,42 |
|
Dimensions du tableau original hors cadre avec l'agrandissement |
94 cm x 122 cm |
1,30 |
|

La bande haute a été ajoutée provoquant l'agrandissement
La bande basse n'est pas un rajout, mais compense une partie abimée
La bande droite n'est pas un rajout, mais est provoquée par une tension de la toile
(Photo sans cadre extraite de la base archive du Louvre)
|
| Faisons maintenant l'exercice de reporter sur le tableau original les marges
dues à l'agrandissement. Si la bande horizontale haute est restée cachée par le cadre, les bandes droite et basse sont restées en partie
visible. |
|

Le tableau agrandi dans son cadre d'origine (version du Louvre)
La bande haute (agrandissement) est cachée par le
cadre
La bande basse est en partie visible
|
|
Une hérésie programmée ?
Du point de vue déontologique,
modifier une œuvre est une faute grave qui ne peut être
justifiée. D'autant que, dans ce cas précis, il semble que l'on ait voulu dénaturer
VOLONTAIREMENT
le tableau alors que l'on est censé travailler
pour le conserver sur le long terme dans un état aussi
proche que possible de l'origine. Il faut savoir d'autre part qu'en
restauration agrandir un tableau crée sur le long terme des
problèmes sérieux de conservation. C'est donc aussi absurde
qu'impensable.
De plus, nous parlons d'un tableau
important, réalisé par un peintre majeur du XVIIe siècle, appartenant à
l'État, et conservé par les meilleurs spécialistes depuis la
Révolution.
EN CLAIR, C'EST INCOMPREHENSIBLE ! Pourtant les faits sont là...
Une seule explication est envisageable : des ordres sont venus d'une autorité supérieure auxquels les
hauts responsables du Louvre ne pouvaient se soustraire. Pour un professionnel, aucune autre explication n'est envisageable.
Reste la partie esthétique. Il est impossible de reconstituer valablement une
partie manquante importante, de même pour
un ajout. On se contente donc de repeints d'ambiance qui sont
visibles, mais qui permettent d'avoir une vision générale de
l'œuvre avec la composition voulue par l'artiste. Les
responsables du Louvre savaient fort bien que la partie
rajoutée se verrait, quelque soient l'habileté et le talent
des intervenants.
C'est une nouvelle preuve que la
décision est venue d'une hiérarchie supérieure, de responsables
habitués à donner des ordres et à les faire exécuter, mais
incompétents en matière de restauration d'art. Ils pensaient sans doute s'adresser aux meilleurs, et
qu'avec le temps et une pression suffisante, le résultat
serait conforme aux attentes. Comme à l'impossible nul
n'est tenu, le résultat fut médiocre ce qui était
prévisible.
Le but de l'opération était de
casser la composition du tableau, mais le remède fut
pire que le mal. En voulant éloigner les curieux, ils attirèrent plutôt les projecteurs sur une œuvre qui devait rester
discrète. Le regard de l'amateur
sur une invraisemblable incongruité ne pouvait qu'amener
inéluctablement des questions gênantes tout en attirant l'attention sur ce que l'on voulait cacher
!
Il n'y avait plus qu'une seule solution : camoufler ce dérapage au plus vite. Le tableau fut donc remonté dans son cadre d'origine, mais après avoir
creusé la feuillure du haut de 7cm, agrandissement oblige. Ni vu, ni connu... on avait dépensé une fortune pour rien.
|
|
Pourquoi la bande haute de 7 cm est‑elle noirâtre ? |
|
D'autres
phénomènes entrent en jeu et participent au vieillissement de la toile : notamment l'absence de rayons lumineux qui
renforce de façon considérable le brunissement naturel de
l'huile.
Ce double phénomène, absence de lumière et brunissement de l'huile, donne à terme un résultat
sombre et noirâtre comme celui donné en exemple ci‑contre.
|

Exemple de repeint qui a
viré noirâtre,
comme la fameuse bande de
7cm
des Bergers d'Arcadie II
|
|
C'est ce qui s'est probablement passé sur la bande horizontale de 7 cm. Après avoir été rajoutée, cette bande s'est retrouvée contre le bois de la feuillure, d'où un mauvais échange avec
l'oxygène de l'air et l'absence de lumière.
Cette bande est restée cachée par le cadre ce qui l'a rendue noirâtre, et c'est bien la masse de la couche picturale qui a cette couleur.
On ne peut donc retirer que la crasse et le vernis,
éventuellement des repeints posés sur la peinture originale. Malheureusement, si la masse de la peinture est de cette
teinte, aucune restauration n'est possible.
De toute façon, ce nettoyage n'aurait aucun intérêt puisque ce rajout n'est pas d'origine. La
seule possibilité concevable serait de tout démonter afin de revenir à la taille initiale voulue par Nicolas Poussin. Mais ce serait ébranler l'ensemble du tableau, sans
raison valable au niveau de sa conservation. Il est donc tout à fait logique et normal que le Louvre le laisse dans cet état tant
que des raisons techniques sérieuses n'imposent pas de reprendre le rentoilage d'ici un siècle ou deux.
|
|
Un scandale qui date de plus
d'un siècle...
Vous l'avez compris, il s'agit tout simplement d'un scandale
majeur difficile à avouer à un tel niveau, même s'il date
aujourd'hui de plus d'un siècle. D'autant qu'il faudrait
aussi répondre à la question :
Pourquoi ?
Il ne faut bien sûr pas compter sur le
Louvre pour avouer et expliquer une faute aussi lourde, d'autant que donner des explications tendrait aussi à expliquer
officiellement l'embryon de l'affaire.
D'autres anomalies ?
En dehors de cette bande il existe de
nombreux repeints sur la partie d'origine. Certains sont
liés à l'état de la couche picturale et servent
à restaurer les niveaux d'usures et de manques. D'autres sont clairement abusifs, revenant à dire
que certains repeints couvrent des parties en bon état, ce qui
est tout à fait anormal et invraisemblable
sur un tableau du XVIIe siècle.
Le but serait donc cette fois‑ci de masquer
des détails. Nous disposons d'une photographie en noir et blanc de
la fin du XIXe
siècle qui présente cette partie d'origine en bon
état. Elle est aujourd'hui ignoblement badigeonnée, ce qui prouve qu'il n'était pas question de restauration, mais bien d'une
modification. D'autre part, toutes les données disponibles
confirment que le sacrilège daterait des
années 1900, après la prise de la photo et la
réalisation des copies et des interprétations, et avant la
guerre de 1914 du fait du renforcement des règles
déontologiques et surtout de la diffusion en nombre de
reproductions semi industrielles. Cette période est
confirmée par l'état de l'évolution des retouches.
|
|

Photo ancienne des Bergers d'Arcadie
sans les repeints
|
|
Depuis la Révolution française, des
règles précises ont été élaborées pour la conservation et la
restauration des œuvres d'art des musées nationaux. Le
choix des interventions et des techniques à utiliser pour
remettre en état un tableau important est choisi en
commission, en présence des responsables du musée, du
rentoileur, du restaurateur, et depuis une période beaucoup
plus récente, des scientifiques spécialisés. Rien ne peut se
faire sans une concertation générale aboutissant à un
consensus. Dans le cas des Bergers du Louvre, la seule
explication possible est donc
une intervention supérieure qui a donné
des ordres à exécuter sans concertation.
Fait troublant,
les Bergers d'Arcadie I (version anglaise) ont subi le
même sort. Ce tableau jouerait‑il un rôle
identique ou similaire dans cette affaire ? Tout permet de le penser...
Bien sûr, il existe au Louvre un
dossier technique très complet, avec des radiographies, des
photos infrarouge en lumière rasante, en macro, et des analyses scientifiques. Pour donner une
idée, le dossier de documentation générale sur les Bergers
d'Arcadie II fait 15 cm d'épaisseur.
|
|
Le bâton du berger
Une radiographie célèbre montre que le
bâton du berger de droite a été peint AVANT le tombeau,
ce qui est absurde dans la mise en place des éléments du
tableau... A moins bien sûr que ce bâton ne joue un rôle
crucial dans la composition géométrique.
En réalité, et
on le sait maintenant grâce aux différentes études de lumière, tous les bâtons étaient déjà dessiné et littéralement gravés
pour qu'ils ne se perdent dans le montage du dessin et des huiles. Ceci est aujourd'hui connu et admis des spécialistes. Il reste
néanmoins que ce constat gène profondément ces mêmes experts puisqu'ils sont dans l'incapacité d'expliquer les vrais raisons de
cette aberration artistique, surtout venant d'un maître comme Poussin.
Comment sur une radiographie, peut‑on affirmer qu'un bâton a été peint avant le tombeau ? Pour voir au delà de la surface
apparente d'une peinture, on peut faire une photo sur
pellicule infrarouge. Selon les circonstances, on peut ainsi
détecter des sous couches et mieux comprendre comment le
peintre a travaillé.
Mais si les couches picturales sont
vraiment opaques, seule une radiographie permet de voir les
strates de fond. Dans le cas qui nous occupe, la peinture de
fond du bâton vertical est interrompu par la ligne
horizontale du tombeau. Cela veut dire que le bâton a été
positionné au début du travail, et que le tombeau ne l'a été
qu'après. Au niveau de la réalisation, c'est évidemment une absurdité.
On commence toujours par les masses principales, ciel,
paysage, tombeau, puis on place les personnages, la
végétation, et enfin les détails comme les bâtons.
... A moins bien sûr que ces bâtons n'aient une
importance particulière !
|
|

Radiographie qui montre au delà de l'Infra Rouge la marque de la
collection royale (en bas à gauche), certainement peinte au
pochoir sur le dos, et donc non
visible avec le rentoilage, et le bâton peint avant le
tombeau
(Photo P. Merle)
|
|
Les Bergers d'Arcadie,
version anglaise... |
|
Tout comme les Bergers du Louvre (version II), la version
anglaise a subi exactement le même sort, c'est à dire un net
agrandissement asymétrique :
8 cm à gauche et 2,5 cm en haut.
Mais à la différence de la version
du Louvre, les modifications n'ont pas été masquées.
Il faut dire que ce tableau étant dans le domaine privé, son propriétaire peut en faire ce qu'il veut. La situation est d'autant
plus
absurde que peu de personnes sont capable de détecter la moindre modification.
Le restaurateur a
débordé allègrement et de façon non continue sur la partie
originale ce qui a "noyé le poisson". Les parties
reconstituées étaient de ce fait beaucoup plus discrètes à
l'époque, contrairement à la bande du Louvre qui ne débordait
pas. Bien sûr, ces repeints ont subit les même évolutions vues précédemment, ce qui se perçoit très bien sur les
photos actuelles (jaunissement et assombrissement). Il existe aussi des retouches liées à l'usure, en
particulier au niveau du tombeau et de la main au doigt
pointé vers le texte.
Pour ce tableau, une donnée
technique permet de dater la période où
l'intervention a été réalisée. Sa dimension officielle est
de 101 cm x 82 cm. Cette mesure prise par devant intègre
les retours des bandes de tension sur les côtés qui sont
épais de plusieurs millimètres, puisqu'il y a la toile d'origine,
l'adhésif, la toile de rentoilage, et les semences de montage.
La taille du châssis est de 100 cm x 81 cm ce qui correspond à un format normalisé 40 figure (40F).
Ce type de châssis industrialisé n'est apparu qu'à la fin du
XIXe siècle. D'autre part, l'évolution des
repeints correspond à un vieillissement de l'ordre d'une
centaine d'années. Enfin, il aurait été très délicat de
faire cette intervention après la première guerre mondiale,
car ce tableau était connu et des photos existaient déjà. Tout
comme pour la version du Louvre, la période de transformation est
donc aussi vers les années
1900 d'après les éléments disponibles.
Sa taille d'origine était de 3 pieds
de haut par 2 pieds 3 pouces de large
ce qui fait 97,5 cm x 73 cm
Ne disposant pas d'une photo fiable du tableau il est difficile de juger
des repeints. Par contre,
le tableau est proche de sa composition d'origine, un peu
comme celui du Louvre avec son cadre. Ceci peut être facilement vérifié en comparant le tableau avec une esquisse sous forme de dessin
du
XVIIIe siècle et réalisée bien avant la transformation.
En
plus de la photo générale, la fiche du tableau montre des détails concernant les repeints
et les usures du tombeau. A noter également qu'il manque
curieusement une bande d'environ 4 cm à droite sur
TOUTES les photos disponibles, y compris sur
celles qui se trouvent dans la documentation interne du
Louvre concernant les Bergers d'Arcadie version II
|
|

En vert les bandes ajoutées au tableau d'origine
qui faisait 97,5 cm x 73 cm
Les dimensions officielles du tableau sont aujourd'hui 100 cm x
81 cm (40F)
|
|
Si l'on compare la version actuelle des
Bergers d'Arcadie version I ci‑dessus et une esquisse faite par
Poussin ci‑contre, l'agrandissement du bord gauche est très net.
Les Bergers d'Arcadie version I
dessin anglais
du XVIIIe siècle
|
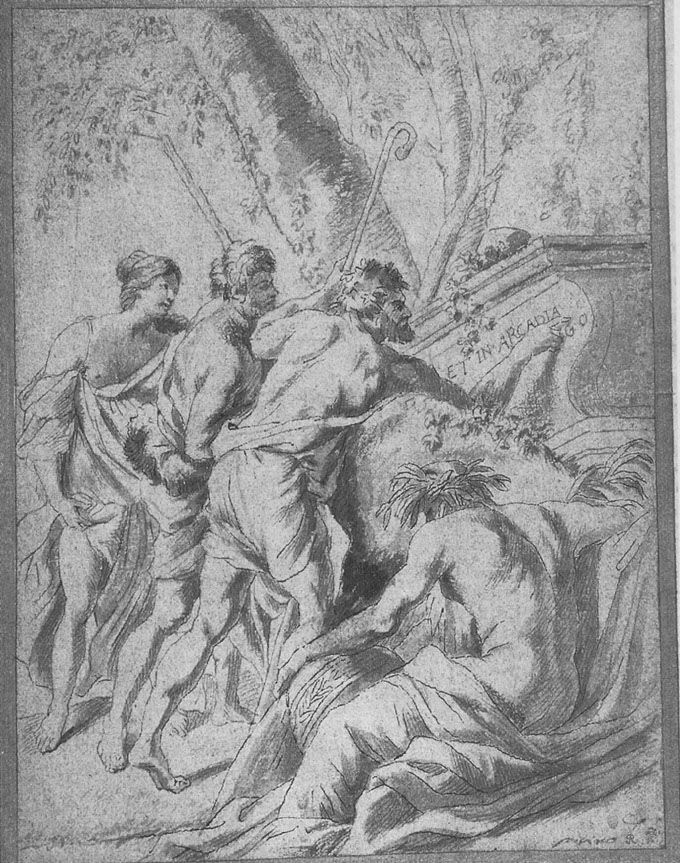 |
|
Le tableau est composé de
deux toiles...
Un autre sujet méconnu doit
impérativement être pris en compte. La version anglaise des
Bergers d'Arcadie, dont la date de réalisation est généralement estimée entre 1627 et 1630 est le second d'une paire de tableaux. Le
premier peint en 1624 à l'arrivée de
Poussin à Rome s'intitule "Le Roi Midas se lavant à la
source
du Pactole".
Ces deux tableaux associés sont séparés
depuis longtemps, mais ils se trouvent toujours dans le
monde anglo‑saxon. "Le Roi Midas" est au Métropolitain de New
York depuis 1871, et il est le premier Poussin acheté
par les Etats‑Unis.
Au départ, ils avaient le même
format, si bien qu'aujourd'hui "Le Roi Midas" est plus petit
que les Bergers anglais, la version américaine étant dans son état d'origine. C'est
pourquoi personne ne pense à les associer. J'ai eu la
chance de pouvoir l'examiner en détail l'été dernier, car il
était en Suisse. Il est en très bon état de conservation.
A noter qu'il ne s'agit pas de pendants classiques, avec des
compositions complémentaires. Les deux tableaux sont
similaires, avec pour "Le roi Midas" un effet zoom. La raison
est simple bien qu'invraisemblable : la composition des
Bergers anglais est le développement de celle du Roi Midas, mais avec une échelle réduite de 50 % pour que
les deux tableaux aient le même format ! Un cas unique dans les
annales de l'Histoire de l'Art...
Une autre information est qu'il
existe un double de cette paire. Elle se trouve à Rome, dans
le Palazzo delle Colonne. Elle est toujours associée,
et d'un format un peu plus grand. Il n'existe malheureusement pas de reproduction pour les comparer, et on ignore si cette paire
est contemporaine ou postérieure à l'originale.
Enfin, il existe un autre tableau traitant du
Roi Midas se lavant à la Source du Pactole. Il est
considéré comme une œuvre de jeunesse de Poussin, mais il
ne lui est pas formellement attribué. Le plus surprenant,
c'est que sa composition est horizontale et son traité est très
sage l'apparentant aux Bergers du Louvre; en
opposition avec la paire anglo‑saxonne, verticale et beaucoup
plus primesautière. Son rapport largeur / hauteur est le
même que les Bergers du Louvre. Si ce tableau n'estas officiellement attribué à Poussin, une expertise de Rosenberg admet
aujourd'hui que cette hypothèse est plus que probable.
|
|

Le Roi Midas se lavant à la source du
Pactole ‑ Poussin ‑ Version I vers 1624
(Œuvre non officiellement attribuée à Nicolas Poussin) |
|
Une question essentielle
Pourquoi avoir défiguré deux
tableaux d'un même thème et d'un peintre fondamental tel que Nicolas Poussin en effectuant
volontairement un travail aussi bien complexe qu'absurde et contre toutes les règles de l'art ?
Les
deux agrandissements sont
asymétriques, ce qui fausse complètement la composition
voulue par Poussin, alors même que ce
peintre était justement obsédé par la composition. Elles
étaient tellement élaborées qu'il lui arrivait de
confectionner des sortes de mini scènes de théâtre avec des
figurines habillées, à l'aide desquelles il faisait des
effets de positions, de tissus, d'éclairages, de jeux
d'ombre et de lumière. C'est dire le travail de conception
auquel s'astreignait ce maître avant de commencer un
tableau, et sans compter les esquisses préparatoires. Rien
n'était laissé au hasard ! comme il le disait lui‑même...
Quand Henry Lincoln
proposa son pentagone sur le tableau, il donnait en fait une
triple information :
1 ‑ Le tableau est une clé de l'affaire RLC
2 ‑ Cette clé est liée à sa composition
3 ‑ La clé se présente sous la forme d'un
pentagone
Ce troisième point ne
correspond à rien dans la composition, et il n'a donc pas de
sens. C'est un des mystères de ce livre, "Le Temple
Retrouvé", car les points 1 et 2 sont par contre très réels,
et d'une importance capitale.
Les informations que Poussin voulait, ou qu'on lui a
demandé de transmettre, sont liées à ses compositions très
complexes. En cassant celles‑ci, on a voulu cacher l'accès
aux informations qui leur sont liées. Ceci est vrai pour
les deux versions d'Arcadie.
La version anglaise est
totalement incompréhensible si elle n'est pas recadrée
exactement à son vrai format. La version française,
plus complexe, mais aussi plus précise, est plus
facile à comprendre, car elle fonctionne comme une mécanique
d'horlogerie. Le plus gros de ses modifications a été
masqué.
Tous les éléments sont positionnés selon une logique précise, mais il faut séparer le principal, le
secondaire, et l'accessoire. Ils sont gérés par des
structures différentes, si bien que l'ensemble est très
complexe. C'est pourquoi, contrairement à la relative
liberté des Bergers anglais, ceux du Louvre sont figés dans
un carcan particulièrement contraignant. Il a fallu tout le
talent de Poussin pour réaliser une œuvre de cette qualité,
malgré les énormes contraintes imposées.
Par contre, depuis la fin du
XIXe
siècle la situation changea et ceci pour deux
raisons :
D'une part, l'agitation
soulevée par les curés de la région avait attiré
l'attention, si bien que des petits malins risquaient de
faire la relation entre des particularités du Haut‑Razès et leur
références présentes sur les deux tableaux. C'est
pourquoi on tenta à cette époque de couper l'herbe sous le
pied d'éventuels gêneurs à la curiosité intempestive en
cassant la composition des tableaux. Ceci devait empêcher
d'établir correctement leurs structures sous‑jacentes. La curiosité des chercheurs s'est avérée à terme plus forte que la
tentative de brouillage des pistes.
D'autre part, un fait peu évoqué dans cette affaire est apparue à
cette époque : La mise en œuvre de la NTF et l'arrivée de la nouvelle triangulation française. Pour établir des cartes
précises, il fallut mettre en place un système de
triangulation. Le premier de l'époque moderne a été
élaboré par les Cassini
dans la première moitié du
XVIIIe siècle. Mais vers 1850,
les avancées scientifiques et techniques rendirent ce
système obsolète. Entre
1850 et 1870, les militaires durent donc étudier la
Nouvelle Triangulation Française dite
NTF qui fut mise en place sur le terrain
dans les années
1880 / 1890. Compte tenu de sa précision, la NTF est
toujours utilisée, les données aériennes,
satellites et GPS ne servant qu'à peaufiner les détails.
Et Boudet dans
tout ça ?
Que
Boudet ait fait sa découverte au milieu des
années 1880
n'est pas un hasard. Il avait à sa disposition des
informations transmises par ses pairs comme l'a démontré
Franck Daffos, mais il disposait aussi de moyens
techniques inédits, qui avaient fait défaut à ses
prédécesseurs.
Ceux‑ci permirent également à d'autres personnes
"non autorisées" de comprendre où était le lieu
tant recherché, sans avoir besoin des informations Boudet,
rien qu'à l'aide des tableaux.
C'est la raison pour
laquelle il a été jugé impératif à cette époque de les
maquiller pour les rendre illisibles, avec succès pour la
version anglaise, et avec maladresse pour la version française. Il est d'ailleurs
intéressant de constater que malgré cet échec, personne
officiellement du moins n'a compris ce que
véhicule ce tableau et pourtant, ce n'est pas faute de
recherches... !
|
|
Tout est important !
Finalement, c'est aux tableaux de
parler et non l'inverse. Il faut tout observer, aussi bien la
mise en place générale de la scène que les détails. La position des
personnages, celle des bâtons, la longueur de ceux‑ci, les
jeux des mains et des pieds. Tout compte sans exception
! L'ensemble est géré par des figures géométriques
interconnectées, mais pour les construire de façon précise, il
faut d'abord trouver et caler correctement les cercles dans
lesquels elles s'inscrivent.
Attention au piège : il y a
deux strates
dans les Bergers du Louvre qui semblent intégrées, alors
qu'en réalité, elles sont indépendantes. C'est le plus
fabuleux tour de passe‑passe de Nicolas Poussin !
Patrick Merle

La suite page suivante |
|
|



