|
|
Il existe
une multitude de
richesses méconnues à Limoux, et nombreuses sont celles qui trouvent
un lien avec l'affaire de Rennes‑le‑Château. Il ne faut
donc pas hésiter à s'y rendre pendant qu'il en est encore temps. Ces
chefs d'œuvres sont encore visibles, mais pour combien d'années
encore ?
Vue de l'extérieur, la
façade de pierre paraît bien triste et bien fragile, écrasée entre deux
bâtiments modernes. Cette petite église des Augustins semble
résister à des années d'oubli. Pourtant, il faut aller la
visiter, car vous serez émerveillé par son charme et ses riches
décorations.
Le fronton sculpté date de
la fin du XIVe siècle. Au centre, porté par deux
anges, un blason célèbre la couronne christique et deux cœurs
enflammés. Nous sommes devant l'une des paroisses de
Limoux, celle dédiée aux Augustins. |

Le fronton de pierre de l'église
de
l'Ordre des Augustins à Limoux |
|

Détail du fronton avec au centre la Couronne d'épines
et les deux Cœurs |

|
L'église fut construite au
XIVe siècle. À l'intérieur, le retable, le
maître autel et la chaire datant de
1695, sont classés monuments
historiques depuis 1970.
Limoux, comme d'ailleurs
de nombreuses communes du Razès, possède un passé riche et
tourmenté. Son histoire religieuse passe d'abord en l'an 1000 par
l'abbaye de Saint‑Hilaire. La région est alors sous le règne du
Vicomte de Carcassonne Roger 1er. Mais d'autres épisodes vont
marquer la population avec la crise albigeoise. Alors que Limoux
dépend du Comte du Razès, elle est prise au
XIIIe siècle par
Simon de Montfort lors de la croisade contre les Albigeois et
rejoint la couronne en 1296. Durant cette guerre
sanglante, Dominique de Guzman prie avec ses compagnons dans
le monastère de Prouilhe fondé en
1206. Les églises de
Saint‑Martin et de
ND de Marceille
vont naître à cette période. En
1317 le Pape
Jean XXII crée un siège épiscopal à Limoux, mais il est déplacé à
Alet après l'opposition des religieuses de Prouilhe. Limoux va
alors accueillir des couvents mendiants : en
1270 les frères
mineurs, en 1306 les Augustins et en
1325
les
Dominicains.
Mais les troubles
continuèrent. Ce fut au XIVe siècle, le
Prince Noir,
qui dévasta la ville. Puis au XVIe siècle, les catholiques et
les calvinistes s'opposeront, entraînant 30 ans
de guerre civile et un ralentissement de son essor industriel.
Ce n'est qu'au XVIIe siècle que Limoux retrouve le calme et la
prospérité. Les Doctrinaires arrivent en
1640 et la
Révolution ferme les couvents et vend leurs biens.
ND de Marceille échappera par
miracle à ce sort. |
|
Une fois franchie l'arcade
de pierre, un porche nous attend avec un second fronton. Une
inscription latine l'accompagne :
DOMUS MEA
DOMUS ORATIONIS EST
Il est
amusant de retrouver ici une phrase que les passionnés
connaissent déjà puisqu'il s'agit d'une formule existant sur
le porche de
l'église de Saunière :
DOMUS MEA DOMUS
ORATIONIS VOCABITUR
En fait il s'agit de la même
référence, mais extrait de deux évangiles différents. |

Sous le porche un second fronton |
|
Traduction :
«Ma maison sera appelée maison de prière».
Ce sont les paroles prononcées par Jésus
lorsqu’il chasse les marchands du Temple, selon l'Évangile
de Marc au chapitre 11, verset 17. Et Jésus poursuit : « mais vous en avez fait
une caverne de brigands » |
|
Qui étaient
les Augustins ?
Les Augustins était un
Ordre catholique que l'on
nomme aussi "Ordre de Saint‑Augustin"
et qui rassemble
des mendiants religieux. Il fut approuvé définitivement au
concile de Lyon en 1274. Bâti sur le modèle dominicain,
c'est avant tout un ordre mendiant qui sera confirmé comme tel
en 1567 par le
pape Pie V.
L'Ordre se décline en
familles regroupant des croyants aux affinités différentes. On y
trouve
par exemple des chanoines réguliers, les ermites de Saint‑Augustin créés en
1256, les ermites Récollets créés en
Espagne en 1588, les Augustins pieds nus créés en
1574, ou
les Dominicains.
Les Augustins pieds nus
(Augustins déchaussés) se répandirent en Italie et en France où
ils formèrent une Congrégation répondant au nom de "Petits pères". Prêchant la pauvreté, la chasteté et
l'obéissance ils se consacraient essentiellement à la
prédication comme d'ailleurs les autres familles. Cet ordre
disparaîtra à la Révolution.
La vie de l'ordre de Saint
Augustin est organisée selon un principe communautaire
classique, mais les préceptes sont issus de Saint‑Augustin.
L'ordre sera reconnu officiellement lors du
IIe
Concile de Lyon en 1274.
Les Augustines sont la
branche féminine de l'ordre. Dédiées entièrement aux malades et
aux hôpitaux, on les trouve à l'Hôtel‑Dieu à Paris. Les
Ursulines ou les Sœurs de la Visitation sont des déclinaisons de
cet ordre.
Les Augustins
arrivèrent donc à Limoux vers 1306 et comme beaucoup
d'ordres mendiants à cette époque, il était riche, possédant une
église, un couvent et même une école.
Pierre d'Assalit,
augustin du couvent de Limoux, deviendra même évêque d'Alet en
1421.
|
|
Les guerres
de religion et la Révolution signeront la fin de l'ordre. Un
incendie violent va aussi contribuer à leur déclin à Limoux.
Une
toile située à ND de Marceille témoigne de la violence des
flammes. L'incendie eut lieu le 15
septembre 1685 et ravagea la ville.
|

Tableau sur l'incendie du 15 sept 1685 de Limoux
à ND de Marceille |
|
Pourquoi
l'Ordre des Augustins est‑il lié à l'affaire ?
Il existe de nos jours 4
raisons essentielles (ce qui ne veut pas dire que ce sont les
seules) :
 Ambroise Frédeau
(1589‑1673) ‑ Il fut moine ermite peintre de l'Ordre
des ermites de Saint‑Augustin. Il travailla au couvent
des augustins de Toulouse et fut un excellent ami de
Poussin. Mais surtout il est
habilement cité par
Gasc
dans l'un de ses opuscules comme étant l'auteur du
Saint Antoine à ND de Marceille.
Ambroise Frédeau
(1589‑1673) ‑ Il fut moine ermite peintre de l'Ordre
des ermites de Saint‑Augustin. Il travailla au couvent
des augustins de Toulouse et fut un excellent ami de
Poussin. Mais surtout il est
habilement cité par
Gasc
dans l'un de ses opuscules comme étant l'auteur du
Saint Antoine à ND de Marceille.
 Mathieu Frédeau ‑ Très probablement le
frère de lai
de Ambroise Frédeau et son ainé. Également moine augustin et
peintre itinérant. On retrouve mystérieusement sa signature sur
le Saint Antoine contrairement à ce qu'affirme
Henri Gasc dans
son opuscule.
Mathieu Frédeau ‑ Très probablement le
frère de lai
de Ambroise Frédeau et son ainé. Également moine augustin et
peintre itinérant. On retrouve mystérieusement sa signature sur
le Saint Antoine contrairement à ce qu'affirme
Henri Gasc dans
son opuscule.
 Saint‑Augustin ‑
Considéré
aujourd'hui comme le père de l'Église catholique, il était avant
tout un philosophe chrétien. Le fait essentiel de
sa biographie qui nous occupe est qu'il assista au
pillage de Rome par
Alaric chef des
Wisigoths le
24 août 410.
Saint‑Augustin ‑
Considéré
aujourd'hui comme le père de l'Église catholique, il était avant
tout un philosophe chrétien. Le fait essentiel de
sa biographie qui nous occupe est qu'il assista au
pillage de Rome par
Alaric chef des
Wisigoths le
24 août 410.
 Le
mystère de Valcros ‑ Initialisé par
Alfred Weysen
après la découverte d'un Saint‑Augustin bien mystérieux
Le
mystère de Valcros ‑ Initialisé par
Alfred Weysen
après la découverte d'un Saint‑Augustin bien mystérieux
Pour plus de détails sur cet
épisode passionnant, se référer à l'aventure du tableau
Saint Antoine à Notre Dame de
Marceille. |
|
À l'intérieur, un écrin de couleur |
|
À
l'intérieur de la chapelle des Augustins, le spectacle est au rendez‑vous. Derrière
le
portail grisâtre se cache un écrin richement décoré. Malgré le
temps et l'humidité qui attaquent les murs et les plafonds, les
décorations des voûtes ont conservé tout leur éclat. |
|

La nef |

L'entrée |
|
On peut alors admirer ces
peintures décoratives qui rappellent
ND de Marceille. Elles nous
donnent ainsi un échantillon de ce que pouvaient être ces lieux il y a
plusieurs siècles. |
|

Les voutes peintes |
|
Cette église cache
un autre lien fort avec
Notre Dame de Marceille. La chaire possède
en effet une extrême ressemblance avec celle dessinée sur la gravure célèbre de Reynié et Certain datée de
1830. |
|

La chaire de l'église Saint‑Augustin
à Limoux |

|
|
La gravure de qualité exceptionnelle détaille
l'intérieur de
ND de Marceille en
1830. Or un mobilier très important a
été remplacé lors des rénovations engagées par
Henri Gasc. Il s'agit de la chaire qui n'existe plus aujourd'hui sous cette
forme.
|
|
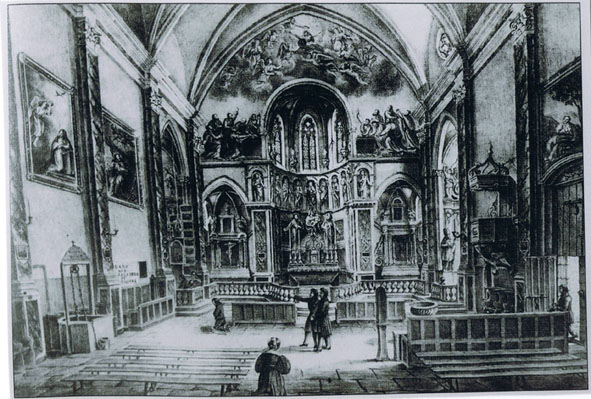
Gravure de Notre de dame de Marceille
vers 1830 (de
Reynié et Certain)
et la chaire à droite
|
|
La chaire
était à l'origine suspendue au mur à une
légère hauteur. On la retrouve positionnée ainsi dans
l'église
des Augustins à Limoux. D'ailleurs
Gasc la décrit
de façon très imagée en la nommant "La lanterne des anciens palais de
justice".
En la remplaçant, Henri Gasc avait certainement un plan précis. En construisant à ND de Marceille une chaire constituée d'une
niche encastrée dans le mur plutôt qu'une corbeille suspendue, il
pouvait aménager plus facilement un accès très discret à une pièce fermée située en sous‑sol. Cette cache aurait contenu un dépôt découvert des années auparavant par hasard par
Gaudéric Mèche. Il est à noter que ce local existe bien puisqu'il a été confirmé par un chercheur,
l'ayant visité. Son accès est malheureusement aujourd'hui condamné. |
|

La chaire de la gravure de 1830
à ND de Marceille |

La même chaire retrouvée à Limoux
église des Augustins |
|
Admirez comme le
dessinateur prit un soin extrême à détailler ce mobilier. Ceci
permet de mesurer quel niveau d'exactitude nous pouvons
accorder à cette gravure artistique. Il ne s'agit pas
d'un banal dessin issu de l'imagination de l'artiste, mais plutôt
d'un réel instantané de l'époque. |
|

La chaire dans l'église Saint Augustin à Limoux |
|
La paroisse est dédiée à l'ordre des
Augustins. Il est donc normal de trouver une représentation de
Saint‑Augustin. En fait, tout le retable est dédié à la vie du
Saint.
Il est par
exemple représenté à gauche de l'autel sur un bas relief en
plein ravissement.
S'il fallait une
confirmation, nous retrouvons la même scène et le même
personnage à Notre Dame de Marceille sur
la
peinture
au‑dessus de l'entrée principale.
Le ravissement de Saint‑Augustin représente
l'apothéose du Saint devant le mystère
de la Sainte Trinité. |
 |
|
À la XIIe station du chemin de croix, on peut admirer une belle
représentation de Marie‑Madeleine qui complète la scène.
Remarquez sa
façon de croiser les doigts... un grand classique dans
les représentations de la sainte. |
 |
|
Le retable
et ses décorations murales sont le clou du spectacle. Son aspect
est imposant avec les colonnes de marbre blanc, les bas reliefs
et les sculptures gracieuses.
Toute cette décoration semble avoir été construite pour mettre en valeur deux
scènes. L'une est en haut sous la forme d'une peinture, la
seconde est juste en dessous dans un immense bas relief.
La toile, à
elle seule mérite l'attention. La peinture anonyme trône
largement en hauteur comme si elle était portée aux anges.
Le
haut du retable |
 |
|
En haut,
Saint‑Augustin évêque porte une auréole et s'agenouille
devant le Christ. À sa gauche, une femme donne le
sein à un enfant. Il s'agit de la Vierge Marie
allaitant l'Enfant Jésus. Au fond, un paysage
imaginaire est visible au travers une ouverture accompagnée d'une inscription latine :
HINC LACTOR AB VBERE
Il s'agit d'une
inscription mariologique qui se traduit par : « je
m'approche de sa poitrine ». Saint Augustin est agenouillé devant le
miracle de la vie et de la mort. La Vierge Marie est représentée
ici comme une simple mère allaitant son enfant. L'allégorie va
jusqu'à ne pas la représenter auréolée... Étonnant pour un lieu
hautement religieux.
La mariologie est une branche de la
théologie chrétienne qui étudie la place qu'il faut donner à
Marie, mère de Jésus, dans le mystère du Salut du monde. |
|
 |
Saint‑Augustin évêque est agenouillé face à la
mort et à la vie
Peinture anonyme |
|
Au‑dessous, un bas‑relief en marbre blanc de
taille imposante évoque l'extase mystique de l'évêque Saint‑Augustin. |
|
En haut
d'un mur latéral, isolé et inaccessible, un curieux blason orne
la paroisse.
Ce signe
est en fait un chrisme intégrant un "quatre de chiffre", mais il
est plus difficile de dire à qui appartient cette signature.
Serait‑on en présence d'un
symbole de reconnaissance ésotérique lié aux bâtisseurs de la
paroisse ? C'est fort probable puisqu'il s'agit sans doute de la signature des compagnons qui participèrent à sa construction... |
 |
|
Combien de temps ce témoignage de notre histoire résistera‑t‑il encore ?
Impossible de répondre, mais une chose est sûr : la piste de
ND de Marceille et des frères
Frédeau nous oblige à reconsidérer cette petite paroisse qui conserve toujours la mémoire de l'ordre des Augustin...
 |
|
|



