|
|
Je me rappelle encore mes premières escapades autour des deux Rennes. Le
Cardou
représentait déjà une
montagne mythique où les spéculations des chercheurs allaient de bon train. Tantôt cache aux trésors, tantôt cache aux tombeaux, les hypothèses
et les rumeurs ne
manquent pas autour du Pech. Il faut dire que son emplacement est particulier, ouvrant la voie vers
Rennes‑les‑Bains et
ayant comme voisin direct le château ruiné de
Blanchefort. C'est aussi la deuxième montagne sacrée du Haut‑Razès après le
Bugarach.
Pourquoi le
Cardou fascine‑t‑il autant ? Son emplacement privilégié sur une terre
ancestrale en face de Blanchefort et sa forme
arrondie très caractéristique sont certainement des raisons importantes. Aisément décelable à l'horizon, il permet de s'orienter
sans risque d'erreur. Une autre raison est celle de la présence d'anciennes mines, favorisant les légendes au‑delà des
siècles.
Pourtant ces explications ne suffisent pas. Le Cardou participe aussi à un repérage
topographique exceptionnel qui était connu depuis très longtemps par nos ancêtres. Les caprices de la nature ont favorisé des
propriétés d'alignements qui furent très tôt remarquées. Le Cardou est important dans le système de codage de l'énigme et
Boudet le savait...

|
|

Le Cardou et sa forme arrondie très
caractéristique |
|
Le Cardou près de Rennes‑les‑Bains ‑ Google maps |
|
Une montagne que l'on ne peut pas rater
|
|
Le
Cardou est très facile à observer
et à découvrir. Prenez la D613 en direction de
Serres, puis tourner à droite pour prendre la D14 vers Rennes‑les‑Bains. En entrant dans le vallon, le Pech Cardou se trouve à gauche et le
château de Blanchefort haut perché, à droite. Vous êtes à la porte de Rennes‑les‑Bains, l'une des entrées du Cromlech de
Boudet.
Au pied du Cardou deux rivières longent la montagne: le Rialsesse au Nord et la Sals à
l'Ouest. C'est aussi à la porte de Rennes que le
Rialsesse rejoint la
Sals
après avoir caressé la bute du
Tombeau des Pontils. |
|

Le Cardou à l'Est et le château de Blanchefort à l'Ouest ouvrent la porte
de Rennes‑les‑Bains (extrait carte IGN Quillan 1/25000) |
|

Le Cardou, à la fois majestueux et mystérieux
|
|
Le nom "Cardou" aurait pour
origine "Chardon", ou "Carlina Acanthifolia" une plante connue pour sa résistance en moyenne altitude et qui pousse
en grande quantité sur l'un de ses versants, mais rien ne confirme cette étymologie. Le fait est que le Cardou était nommé au 19e
siècle "la montagne de Cardon" ou plus simplement "le Cardon".
Culminant à
795 m, il constitue
l'une des extrémités ouest du massif des
Corbières, une région de moyenne montagne aux terrains calcaires et schisteux.
Rappelons que le point haut des Corbières est
le
Pech de Bugarach
avec ses
1231 m d'altitude, les autres sommets importants étant le
Serre de Bec avec 1037 m, le mont Tauch avec 917 m, et la montagne
d'Alaric avec
600 m.
C'est pour cette raison que le Cardou
peut‑être rapproché du Bugarach, ces deux montagnes faisant partie d'un même pli des Corbières. Quant à leur géologie, elles sont
très voisines, essentiellement composées de calcaire déposé sur des marnes.
La carte géologique montre d'ailleurs les natures différentes de calcaire entourant le Cardou
et qui laissent présager une chimie complexe et variée. |
|
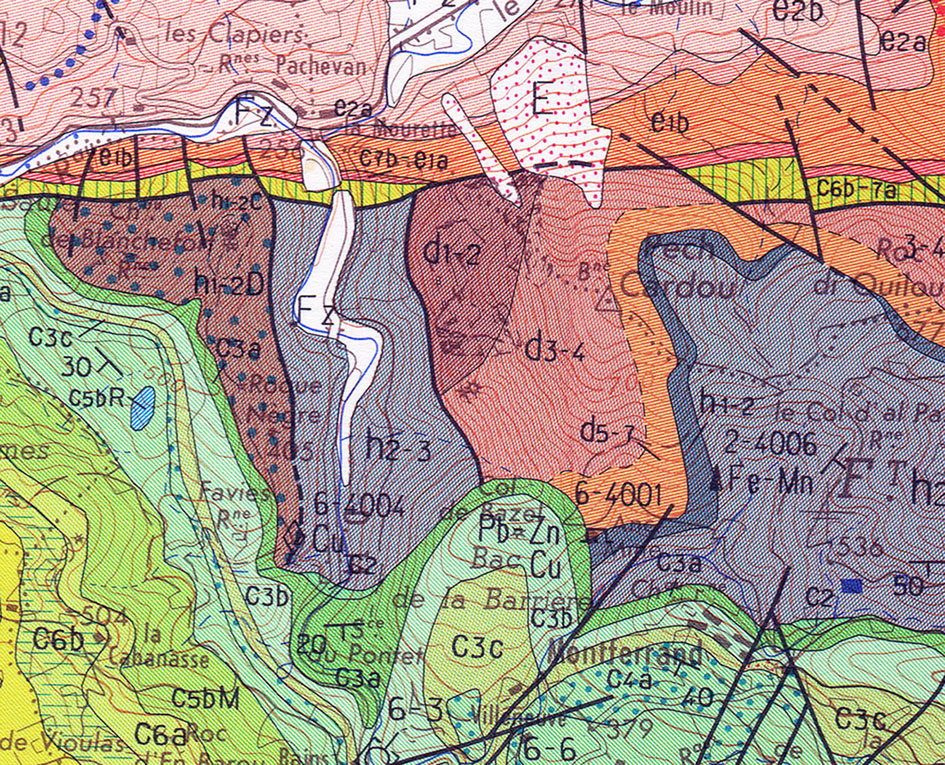
La géologie autour du Cardou
[d1‑2] dévonien inférieur (dolomies grises ou
verdâtres) [d3‑4] dévonien moyen (calcaires gris plus ou moins argileux)
[h2‑3] viséen (re sédiments calcaires)
[d5‑7]
dévonien supérieur (jaspes noirs ou gris) [h1‑2] tournaisien à Viséen supérieur (Lydiènnes noires à nodules phosphatés
calcaires) |
|
Le Cardou, promenade ou escalade ? |
|
Contrairement au
Bugarach qui reste l'objectif majeur des randonneurs
et des curieux, le Cardou
a su conserver toute sa discrétion, et c'est sans doute l'absence de médiatisation qui l'a préservé. Pourtant, les chemins de promenade sont tout aussi exceptionnels.
Son ascension démarre à Serres à la hauteur du cimetière. Un panneau signale
la présence de trois randonnées : « Sentier des Terres Rouges, Tour du Pech Cardou, et Circuit de la Méridienne ».
Il faut alors rejoindre un pont du XVIIe siècle depuis restauré qui traverse le Rialsesse. De
là, le Cardou est extrêmement imposant par sa forme massive et luxuriante. Un autre panneau prend le relais indiquant le Pech... |
|

Le pont de Serres et le Cardou (photo
Khadir Marie‑Andrée) |
|
200 m plus loin, deux nouvelles indications affichent : « Cardou
par Montferrand » et « Cardou direct ». Ces
deux chemins
balisés sont simplement les deux manières de contourner le Cardou pour arriver à son sommet, le premier par l'Ouest, le second par
l'Est. Chacun offre des vues très différentes, et je conseille aux courageux d'explorer les deux solutions.
Par l'Ouest le chemin
offre une vue imprenable sur la vallée de la Sals, et en face sur les roches de
Roque Nègre. Puis loin, on peut voir
Rennes‑les‑Bains et tout le domaine qui entoure
les Roulers. Par l'Ouest, le chemin
est tout aussi pittoresque, ouvrant au loin sur
les Pontils, la
Pierre Levée et la stature carrée
du magnifique château de Serres.
La végétation du Cardou est épaisse et très variée, sans doute favorisée par une terre rouge et
blanche à la géologie complexe. Une forêt dense recouvre par endroit la montagne, et cette végétation est faite d'immenses pins noirs d'Autriche, de pins Laricio, de
pins Sylvestre, de conifères
tels que des cèdres ou des sapins. La forêt protège aussi une faune discrète et bien implantée.
La montée jusqu'au Pech se fait par un chemin au dénivelé important, mais la récompense est
bout avec une vue impressionnante à 360°. Attention, ne vous trompez pas ; il existe au Sud un second sommet moins haut à
552 m,
tout près du col de Bazel, et surplombant
le Bac de la Barrière.
Le Cardou est aussi un site d'escalade réputé.
C'est sur le versant sud, au
Bac de la Barrière que l'on rencontre une falaise
calcaire découpée en plusieurs secteurs et surplombant la rivière. La paroi est assimilable à une dalle très appréciée des experts
en escalade et qui peuvent y grimper en adhérence ou dans les fissures.
Située à une altitude de 400 m la paroi offre une cinquantaine de voies allant du plus facile au niveau professionnel. |
|
Il faut l'admettre, il existe très peu d'indices factuels
reliant directement l'énigme au Cardou. Certaines traces historiques existent, notamment autour de la production minière, mais
c'est encore Boudet qui cite la montagne le mieux.
|
|
Que nous dit Boudet ?
Si l'étymologie officielle de "Cardou" nous explique que le nom provient
d'une plante, le "Chardon",
Boudet donne une autre racine bien plus pertinente dans
son livre culte
La Vraie Langue Celtique.
Selon son exercice préféré qui consiste à jouer avec les phonèmes de la langue
anglaise, le nom "Cardou" proviendrait de la juxtaposition de deux mots : "to cart"... voyager dans un char... et "how"...
comment ? Ceci donnant :
Cart how... Évidemment, pour comprendre son raisonnement il faut relier ceci avec les
Celtes
et leur moyen de locomotion peu adapté aux dénivelés importants du Cardou...
Cette explication étymologique est évidemment
surprenante. |
|
A l'ouverture du cromleck, sur la rive droite
de la Sals, apparaît une montagne appelée
Cardou :
vers le sommet, commencent à se dresser des pointes
naturelles, connues dans le pays sous le nom de Roko
fourkado. Au temps des Celtes, l'accès de la gorge
était sans doute fort difficile, parce qu'une longue
barrière de roches plongeant dans la rivière en
défendait l'entrée. De plus, déclivité extrême des
pentes des montagne devait inspirer une certaine
crainte aux membres savants du Neimheid, chargés de
donner un nom à cette partie du terrain d'un aspect
si sauvage. Aussi, se sont‑ils demandé comment et de
qu'elle manière il pourraient voyager en chariot, en
s'engageant dans ce défilé presque inaccessible ?
Ils ont laissé à leurs descendants le souvenir exact
de leurs pensées et de leur embarras momentané, en
appelant cette montagne Cardou, –
to
cart, voyager dans un char, –
how
(haou), comment ? de quelle manière ? –
carthow –. Ils n'étaient point trop en retard dans la civilisation, ces bons gaulois des premiers temps de
l'occupation, puisqu'ils se préoccupaient ainsi de voyager en chariot sur des flancs de montagnes à pentes très
dangereuses.
Extrait
"La Vraie Langue Celtique" p 229 |
|
La carte des frères Boudet "Rennes celtique" est aussi intéressante à
observer autour du Cardou. On y découvre le nom d'un ensemble de roches pointues sur sa face ouest :
Lampos.
Ces pointes rocheuses sont
signalées par des points rouges sur la carte.
Elles font face aux Roque Nègre (Roco‑Negro) au sud du château de Blanchefort.
Ce nom que l'on ne retrouve pas sur d'autres cartes semble avoir été rapporté par
Boudet... |
|

Le Cardou vu sur la carte des frères Boudet "La
Rennes celtique" et les Lampos
À gauche sur l'autre versant de la Sals, le
Roque Nègre (Roco Négro) |
|
Et les incohérences continuent puisque
Boudet nous donne encore une fois une
étymologie bien à lui à propos de ces
Lampos. Le nom proviendrait de "lam" agneau, ou mieux de "to
lamb" mettre bas. À vrai dire, c'est un très curieux parallèle qui permet d'introduire un animal devenu familier dans l'énigme: la
brebis et qu'il faut peut être associer à celle du berger
Ignace
Paris. Cette étymologie est si absurde qu'elle mérite une pause... |
|
En suivant ces roches du regard, l'œil est
bientôt arrêté par un ménir isolé, dont la pointe se
montre au‑dessus des chênes verts qui l'entourent.
Il porte dans le cadastre le nom de Roc Pointu : il
fait face à une autre roche naturelle fixée sur
le
flanc de Cardou et ornée de plusieurs aiguilles très
aiguës. Cette dernière roche, séparée de Cardou et
offrant plusieurs pointes réunies par la base, a
présenté à nos ancêtres l'idée des petits êtres
composant une famille et retenus encore auprès de
ceux qui leur ont donné le jour, et ils ont nommé
poétiquement ces aiguilles
Lampos.
Ce mot dérive de lamb, agneau, ou de
to lamb, mettre bas, en
parlant de la brebis.
Extrait
"La Vraie Langue Celtique" p 232 |
|

À droite, les Lampos situées sur la face Sud‑ouest
du Cardou |
|
L'exemple montre à quel point Boudet manipule de temps à autre les mots pour
leur donner un sens caché et suggérer une idée ou une allégorie bien différente du contexte de départ. En effet, il aurait été
beaucoup plus naturel de rapprocher le nom
Lampos de
Lampe qui se traduit en italien
Lampo, en espagnol
Lámpara, et même en occitan
Lampa.
La racine vient du latin
Lampas (ref Gaffiot: Flambeau ou torche) et du grec
Lampas. Quant au mot anglais :
Lamp
Ces roches à la
forme pointue, et détachées du versant furent très certainement comparées par la tradition populaire à des torches, ou à des lampes accrochées à la falaise,
d'où le nom de Lampos... ou Lampes.
Comment Boudet, expert en plusieurs langues, agrégé et spécialiste des lettres
anciennes, a‑t‑il pu passer à côté de cette racine si évidente ? Pourquoi Boudet s'est‑il livré ici à une pirouette audacieuse et peu
convaincante ? Car il faut bien reconnaître que relier des roches à un agneau ou à la mise bas d'une brebis a de quoi surprendre.
L'une des techniques Boudet est maintenant bien connue: amener le lecteur dans un raisonnement absurde pour le faire
réagir. On comprend facilement l'irritation et le rejet de la part de ses collègues de la S.E.S.A. qui ne comprirent rien à de
telles divagations.
Boudet savait ses études linguistiques fortement critiquées, mais l'objectif du prêtre était tout autre.
Entrons dans son jeu et repérons les mots essentiels:
Lampos,
agneau,
mettre bas,
brebis.... Puis transposons‑les dans le contexte de l'énigme. Nous avons respectivement les mots: "torches",
"Christ" (l'agneau est un symbole christique), "descendre", "la brebis d'Ignace Paris"...
L'assemblage de ce nouveau vocabulaire dans une même phrase ne peut que laisser perplexe...
 |
|
Le Cardou est un excellent moyen
de découvrir l'entrée du Cromlech de Boudet. La vue à son sommet permet en effet d'apprécier la magnifique étendue du Haut‑Razès, mais
ceci n'est que le décor apparent. Derrière la scène se cache un codage topographique extraordinaire...
Comme pour le
Bugarach ou le
château
du Bézu, nos ancêtres ont profité
des propriétés naturelles du Cardou pour
servir de repère
à une certaine
Géométrie sacrée
La
suite page suivante... |
|
|



